Noël
La perspective de téléphoner à sa femme, surtout pour lui parler de la réunion familiale de Noël, accrut sensiblement la dépression de Gerald.
Angus Wilson, Attitudes anglo-saxonnes
(Anglo-Saxon Attitudes, 1956). Traduction de Claude Elsen.
Stock, 1957. Rééd. 10/18, 1984.
— Oh ! Noël…
Viola soupira, car elle devait passer les vacances avec ses parents à Sydenham. Elle considérait comme son devoir d’aller les voir, tandis qu’eux, de leur côté, avaient le sentiment qu’ils se devaient de l’inviter, alors qu’ils auraient mille fois préféré être seuls. À Noël, pensa Dulcie, c’était comme si les gens perdaient leur statut d’individus de plein droit et, pour ainsi dire, diminuaient d’envergure, devenant de simples unités dans leurs familles, quand, le reste de l’année, ils étaient audacieux et originaux, et souvent des personnes qu’il était impossible d’imaginer rattachées à quelque chose d’aussi banal que des parents.
Barbara Pym, les Ingratitudes de l’amour
(No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff.
Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
La vie des colloques
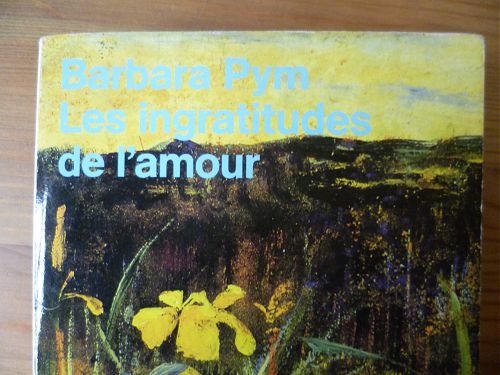
Il existe plusieurs façons de réparer un cœur brisé, mais se rendre à un colloque savant compte sans doute parmi les plus insolites.
Vingt-cinq ans avant Un tout petit monde de David Lodge, il y eut Barbara Pym. Les deux premiers chapitres des Ingratitudes de l’amour se déroulent dans un colloque de province, petit monde en vase clos où circulent les commérages, où se jaugent sans aménité les réputations, où se nouent des idylles. On y trouve en germe tout ce qui fera le sel des romans de Lodge et de tant d’autres campus novels.
Quoi de plus singulier qu’une foule de grandes personnes, la plupart d’un certain âge ou carrément âgées, rassemblées dans un pensionnat de jeunes filles du Derbyshire afin de débattre de subtilités savantes qui, pour la majorité des gens, ne signifiaient rien ? Même les chambres — par bonheur on n’allait pas les entasser dans des dortoirs — semblaient un peu irréelles, avec leurs lits jumeaux en fer et la perspective de passer plusieurs nuits si près de quelqu’un d’inconnu.
[…]
L’autre article important que contenaient ses bagages — le dossier de notes pour la conférence qu’il devait faire sur « Les problèmes d’un directeur de revue » — il le plaça sur la chaise à côté de son lit. […]
Les pas feutrés de la femme dépassèrent sa porte et s’arrêtèrent, lui sembla-t-il, à la chambre d’à côté. C’est alors qu’il se rappela qu’il s’agissait de Miss Faith Randall, conférencière comme lui. En imagination, il vit le titre de la conférence qu’elle allait donner : « Les problèmes de l’établissement d’un index ». Est-ce que toutes les interventions allaient traiter des « Problèmes de quelque chose » ?
Barbara Pym fut éduquée à Oxford. Elle gagna sa vie, trente ans durant, comme secrétaire de rédaction de la revue Africa, publiée par l’International African Institute. Elle se trouvait aux premières loges pour observer les travers du monde académique (voir par exemple Moins que des anges, qui présente un assortiment d’étudiants et de professeurs d’anthropologie diversement pittoresques) et son plus fin exégète français, René de Ceccaty, a pu rapprocher son regard de celui d’un ethnologue, « avec pour objet d’étude, non pas des tribus africaines, mais une assemblée d’intellectuels, de secrétaires frustrées, de vieillards passionnés ». Sa peinture de l’ennui de la vie de bureau, des mesquineries entre collègues, de l’attente impatiente de l’heure du thé sentent, comme on dit, le vécu (voir Jane et Prudence ou Quatuor d’automne). Et si David Lodge met en scène des universitaires flamboyants imbibés de déconstruction et de French theory (l’inoubliable Morris Zapp, dans Changement de décor et Un tout petit monde), Pym est le seul écrivain, à ma connaissance, à avoir élevé au rang d’héroïnes romanesques les « petites mains » de l’édition : relectrices d’épreuves, compilatrices de bibliographies et d’index de publications savantes… Métiers mal payés et peu considérés, donc généralement féminins, exercés par des fourmis invisibles vouées à des tâches ingrates et nécessaires, vivant par procuration dans l’ombre de leurs grands hommes qui récolteront seuls les lauriers de la gloire académique.
 Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
La vie en société
— Ma chère Charlotte, je n’aurais pas survécu en société pendant deux années entières si je n’avais pas appris à parler de tout, sauf de ce que je pense réellement.
*
— Il n’y a pas grand-chose à raconter, commença Christina aussitôt. Les jardiniers creusaient la terre pour planter une espèce d’arbuste quand ils ont découvert ces cadavres de bébés. Naturellement, ils ont appelé la police.
— Comment le savez-vous ? s’enquit Emily.
— Mais par les domestiques, ma chère ! Comment se tient-on informé de ce qui se passe en général ?
*
Augusta soupira.
— Quelquefois, Brandon, j’ai l’impression que vous affectez d’être obtus uniquement pour me contrarier.
*
Un instant, elle craignit qu’il ne recoure à la flatterie. […] Il ne semblait manifester aucun penchant pour la tromperie, ce qui était déjà singulier en soi. La vie en société voulait qu’on se dupe mutuellement, d’un commun accord.
*
— Ne soyez pas ridicule, s’exclama Emily. Ça n’a rien à voir avec son physique, c’est sa langue. On ne peut l’emmener nulle part : elle dit toujours ce qui lui passe par la tête. Demandez-lui son opinion sur un sujet et, au lieu de choisir une réponse appropriée, elle vous dira ce qu’elle pense réellement. Sans le vouloir, elle se saborderait au bout d’un mois, et ne parlons pas de nous ! Et puis Pitt n’est pas un gentleman. Il est beaucoup trop intelligent, pour commencer.
— Je ne vois pas pourquoi un gentleman ne serait pas intelligent, Emily, répliqua-t-il, acerbe.
— Mais tout à fait, mon cher, fit-elle avec un sourire. Seulement, il devrait avoir le bon goût de ne pas le montrer. Vous le savez très bien. Ça indispose les gens et ça implique un effort. Or il ne faut jamais avoir l’air d’accomplir un effort.
Anne Perry, le Mystère de Callander Square
(Callander Square, 1980).
Traduction de Roxane Azimi. 10/18, 1997.
Les conquêtes de Norman

The Norman Conquests est une trilogie théâtrale d’Alan Ayckbourn écrite en 1973. Le titre repose sur un joli jeu de mots : non pas la conquête des Normands, mais les conquêtes de Norman ; conquêtes sentimentales, il va sans dire. Les trois pièces racontent la même histoire : le week-end raté de six personnages réunis dans la maison familiale (plus un septième, la mère tyrannique et alitée, dont il sera beaucoup question mais qu’on ne verra jamais 1). Chaque pièce est située dans un lieu différent : Table Manners se déroule dans la salle à manger ; Living Together dans le salon ; Round and Round the Garden dans le jardin. Chacune est autonome et on peut les voir dans l’ordre qu’on voudra. Mais il faudra les voir toutes les trois pour assembler toutes les pièces du puzzle et obtenir une vue complète des événements s’étant déroulés durant ces quarante-huit heures (tandis que les personnages, ne pouvant être à la fois dans la salle à manger, le salon et le jardin, n’en auront jamais qu’une appréhension partielle). Pourquoi, dans Table Manners, tout le monde fait-il la gueule à Norman le dimanche matin au petit déjeuner ? On le découvrira dans Living Together 2.
Les pièces d’Alan Ayckbourn sont à la fois tristes — en raison du caractère déprimant des existences dépeintes, de leur portrait peu reluisant de la vie conjugale et familiale — et comiques — en raison de la férocité des dialogues et des accès de folie délirante qui s’emparent ponctuellement des personnages, en dépit ou à proportion de leur éducation profondément anglaise (il faut sauver la face et behave coûte que coûte, même dans les situations les plus scabreuses). The Norman Conquests n’échappe pas à la règle. On y croise des personnages frustrés par la vie, prisonniers d’existences étroites, des hommes faibles, infantiles ou stupides caressant des rêves puérils, des femmes coincées ou maniaques en proie à des coups de sang hystériques. Tout ce petit monde gravite autour de Norman comme autour d’un aimant tour à tour attirant et repoussant ; Norman, séducteur impénitent, homme des sincérités successives (il fait du gringue à ses deux belles-sœurs tout en tentant de reconquérir le cœur de sa légitime), égocentrique et pourtant désireux de complaire à tous, insupportable au quotidien mais cependant seul membre de cette famille dysfonctionnelle à être doué de fantaisie spontanée et à n’avoir pas abdiqué toute aspiration au bonheur.
Auteur de quatre-vingts pièces, Ayckbourn a le goût des paris impossibles, du jeu sur les structures narratives, de la manipulation du temps dramatique ; le désir aussi de ne pas se répéter. Son art est à la fois savant — en raison de son caractère expérimental — et populaire — il s’appuie volontiers sur les conventions du théâtre bourgeois ou du théâtre de boulevard. Toutes choses qui ne pouvaient que séduire Alain Resnais, qui l’a porté trois fois à l’écran (et préparait, au moment de sa mort, une quatrième adaptation). Vous connaissez la structure arborescente d’Intimate Exchanges (alias Smoking/No Smoking), construite autour d’une série d’embranchements : à chaque embranchement, la décision d’un personnage de faire ceci ou de faire cela aiguillera l’action dans deux directions possibles, pour aboutir à un total de seize dénouements possibles à partir d’une même situation de départ. Dans le diptyque House and Garden, Ayckbourn poussera encore plus loin le principe de The Norman Conquests. Les deux pièces racontent la même histoire, dans deux décors contigus, le salon d’une grande maison de campagne et le jardin. Mais cette fois, elles sont conçues pour être jouées simultanément, dans les deux salles d’un même théâtre, devant deux publics différents, les comédiens passant continuellement d’une scène à l’autre.
The Norman Conquests a été filmé en 1975 par Herbert Wise pour la télévision anglaise (production disponible en DVD non sous-titré). C’est de l’excellent théâtre filmé, servi par une distribution épatante : Tom Conti, Penelope Keith, Richard Briers, David Troughton, Fiona Walker et une toute jeune Penelope Wilton, qu’on a revue depuis dans Downton Abbey.
Je voudrais m’arrêter sur le générique de ces téléfilms, puisque c’est lui qui m’a donné l’envie d’écrire ces notes désordonnées. La caméra y décrit un lent mouvement circulaire autour de la maquette du décor des pièces : une maison de campagne entourée de son jardin. Suit un mouvement ascendant, tandis que le toit de la maison se soulève pour nous en révéler l’intérieur, façon maison de poupée. Mais, mais, mais ! C’est typiquement une idée à la Resnais ! (On songe aux maquettes de Jacques Saulnier, à ces décors filmés comme des décors, et aussi à tel mouvement d’appareil ascendant sur la maison des Herbes folles.) L’auteur inspiré de ce générique ne pouvait évidement y avoir songé en son temps. Mais, quelque vingt ans avant la réalisation de Smoking/No Smoking, il indiquait à son insu la parenté d’univers entre Ayckbourn et Resnais.


Sur la relation entre le dramaturge et le cinéaste, on lira avec intérêt le témoignage aussi pénétrant qu’émouvant d’Alan Ayckbourn, issu d’un entretien avec François Thomas. La traduction française en a paru dans un copieux dossier Resnais de Positif, no 653-654, juillet-août 2015. L’original anglais est disponible sur le site d’Alan Ayckbourn. « Vous écrivez, lui disait Resnais, des films pour le théâtre, je réalise des pièces pour le cinéma. »
1 À l’instar du père grabataire d’une autre pièce d’Ayckbourn, Private Fears in Public Places. Il y a aussi un personnage absent au centre de la pièce Life of Riley, George, qui n’est pas sans parenté de caractère avec Norman.
2 J’ignore si Lucas Belvaux connaissait The Norman Conquests lorsqu’il imagina son triptyque Un couple épatant / Cavale / Après la vie, dont la structure est analogue.
Brocantes et collections

Il se publie régulièrement des ouvrages sur le monde de la brocante et des collectionneurs. Aucun ne surclasse à mon avis les deux amusants petits livres publiés par Philippe Jullian en 1966 et 1975 1. Je les rouvre de temps à autre à la recherche d’un détail ou d’une anecdote et me surprend à les relire de la première à la dernière page. Jullian a pour lui l’érudition piquante, l’allant et l’élégance du style, le sens du petit fait parlant épinglé avec humour. La sûreté du trait et du coup d’œil rappelle qu’il fut aussi un excellent dessinateur (voir par exemple les Styles, Plon, 1961, rééd. Le Promeneur, 1992, délicieuse histoire illustrée de la décoration d’intérieur, des modes et des snobismes afférents).
Un demi-siècle, grosso modo, nous sépare de la parution de ces livres. Ils sont devenus datés au sens exact du mot. Ils offrent la photographie d’une époque à la fois proche et éloignée de la nôtre. On peut en dire autant de deux bons romans de Jullian situés dans le monde de l’art, des mécènes et des collectionneurs, Scraps (Plon, 1959) et Apollon et compagnie (Fayard, 1974).
1 Hors concours, Quelques collectionneurs de Pierre Le-Tan, Flammarion, 2013. Lire le billet de l’Éditeur singulier.
Les Anglais qui pendant trois siècles ont ramené d’Italie et d’Orient des navires chargés d’antiques, de tableaux et de porcelaines, qui ont acheté la grande liquidation de Versailles, en sont maintenant à la liquidation de leurs trésors. Depuis soixante ans, l’énorme appétit d’objets d’art des milords le cédait à la contemplation des esthètes. Il n’y a vraiment que les Anglais à savoir vivre tous les jours avec les chefs-d’œuvre comme lady Aberconway parmi les impressionnistes, ou Mr. Brindsley Ford parmi ses dessins de Tiepolo et d’Hubert Robert. Ils ont un goût quasi chinois qui mêle le beau, le rare et le singulier, qui offre des pièces délicieuses là où on attendait une galerie. Il y a un dandysme chez les amateurs, une certaine nonchalance qui laissera un chef-d’œuvre dans un coin et s’engouera de quelque bizarrerie, un goût de l’understatement qui dit « quite nice » là où un Français crierait au sublime. « Encore un Van Dick, soupire la duchesse de Northumberland dans le salon où elle sert le thé, mais le Dürer est amusant, n’est-ce pas ? » Les Anglais ont une autre qualité, inconnue en France, le goût du nonsense. Nous avons attendu le surréalisme pour en découvrir les joies. […]
À côté des grandes maisons qui restent vivantes, il y a, dans ce pays tourné vers le passé, une multitude de petits collectionneurs que j’appellerai des miss Havisham, du nom de ce personnage de Dickens, abandonné par son fiancé le matin des noces, qui refuse de quitter sa robe blanche, arrive à la vieillesse sous des lambeaux de tulle parmi les préparatifs d’une fête tombés en poussière et les cadeaux jamais ouverts. La bourgeoisie anglaise en est restée aux plus beaux jours de son histoire, le règne de Victoria. L’incroyable pullulation de bibelots due à la combinaison de la sentimentalité et de l’industrie permet aux amateurs de s’entourer de mille objets dont la signification commence à devenir mystique. Coussins brodés de perles, seaux à charbon ornés d’une vue de Windsor, pelotes à épingles, carnets de bal, souvenirs de Brighton ou de Hong Kong, cadres d’argent ou de peluche autour d’aïeuls imaginaires et de royalties oubliées ; paravent de scrap, couvre-lit de patch, chiens de faïence et cats of roses, presse-papiers en lave du Vésuve ou en granit d’Écosse, sabots d’un cheval qui a failli courir le Derby et bois d’un cerf qui a failli être tué par le prince de Galles, ces symboles de richesse, de pouvoir et de tranquillité s’entassent dans de minuscules appartements. Les épaves de cent châteaux néogothiques, de mille villas Tudor, italiennes ou rustiques garnissent les centaines de boutiques de Chelsea ou de Kensington, les souks aux antiquaires de Portobello Road, et les antiquaires de province, maintenant plus nombreux que les tea shops autour des cathédrales.
Ainsi le marché est différent du nôtre, supérieur pour les très belles choses, plus amusant pour les petites grâce aux miss Havisham ; les excentriques se trouvent dans les châteaux et non en banlieue comme chez nous. Le bouleversement de la vie bourgeoise, plus rapide en Angleterre qu’en France, a avancé la promotion du vieux en ancien ; on collectionne dès maintenant des souvenirs édouardiens, ou même des twenties.
Philippe Jullian, les Collectionneurs. Flammarion, 1966.
Au grand poncif moderne

The ABC Murders (BBC 1). Tentative caricaturale de moderniser Agatha Christie en tirant son univers vers le crépusculaire glauque. Filtres pisseux et verdâtres, lenteur poseuse, peinture sociale forçant la note du sordide, abus d’inserts, souffles et ronflements en fond sonore : tous les poncifs du néonoir télévisuel y sont. Malgré un accent ridicule, John Malkovitch tire son épingle du jeu en campant un Hercule Poirot vieillissant, haï de la nouvelle génération de Scotland Yard. Mais convention pour convention, on préfère de loin l’esthétique Art déco proprette de la série Poirot avec David Suchet.
Trollope par lui-même
Que je puisse lire et être heureux en lisant, c’est pour moi une grande bénédiction. Aurais-je pu me rappeler, comme d’autres, ce que je lisais, j’aurais pu me dire instruit. Mais je n’ai jamais possédé cette faculté. Quelque chose subsiste toujours — quelque chose de vague et d’imprécis, mais tout de même suffisant pour me conserver le goût de continuer. J’incline à croire qu’il en va ainsi pour la plupart des lecteurs.
Anthony Trollope, Autobiographie (An Autobiography).
Traduction de Guillaume Villeneuve.
Aubier, « Domaine anglais », 1994.
 Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
C’est à l’âge de dix-neuf ans, après une enfance pénible (déboires familiaux ; scolarité très malheureuse), que Trollope décroche un emploi modeste à la Grand Poste de Londres. À force de culot, d’abord, puis d’assiduité et de détermination, il parviendra à s’élever dans la hiérarchie jusqu’au grade d’inspecteur. Ces nouvelles fonctions lui vaudront d’être affecté en divers coins d’Irlande et d’Angleterre, puis de voyager en tournée d’inspection aux quatre coins de l’Empire britannique. Au passage, il mettra sur pied quelques réformes utiles destinées à améliorer la distribution du courrier : on lui doit notamment l’installation des fameuses boîtes aux lettres rouges, toujours en usage au Royaume-Uni. La quarantaine venue, il écrit et publie son premier roman, sans éveiller grand écho. Il lui faudra dix ans pour connaître le succès et devenir un des romanciers les plus lus de l’ère victorienne.
Si Trollope a entrepris, à la toute fin de sa vie, de rédiger son autobiographie professionnelle, c’est entre autres choses pour être utile aux jeunes aspirants romanciers. Il y va donc de ses conseils de vieux routier, ce qui nous vaut des remarques intéressantes sur la narration, la construction des personnages et l’art du dialogue. Il y insiste à plusieurs reprises, il fait peu de cas de l’inspiration et ne croit qu’à la régularité du travail. Lui-même s’astreignait à une discipline de fer en écrivant dix pages par jour en toute circonstance, qu’il se trouve à domicile ou en déplacement inconfortable pour une de ses tournées d’inspection postale. S’il terminait un roman au cours d’une de ses séances d’écriture quotidiennes, il commençait le suivant dans la foulée, pour remplir son quota de dix pages.
Dans le même ordre d’idées, il détaille par le menu ses négociations avec les éditeurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et va jusqu’à fournir, en fin de volume, la liste complète de ses œuvres avec en regard le montant des droits d’auteur perçus pour chacun de ses livres. On pourra froncer les sourcils et juger qu’il s’agit là d’une attitude de petit boutiquier ; mais on pourra tout au contraire trouver cette approche des plus rafraîchissante, en regard du cliché romantique de l’artiste travaillant pour la gloire dans sa tour d’ivoire, qui avait cours en son temps et n’a pas disparu de nos jours.
Trollope considère son travail avec un mélange d’orgueil pour sa réussite et de modestie (il se dépeint comme un artisan en se plaçant sur le même pied qu’un ébéniste ou un cordonnier). S’il n’est pas toujours tendre avec ses confrères dont il discute dans un chapitre les mérites et les faiblesses, c’est avec le même détachement lucide qu’il analyse les qualités et les défauts de ses propres livres, ne dissimulant pas plus ses ratages que ses réussites. Au surplus, il ne se fait aucune illusion quant au sort que la postérité réservera à son œuvre aussitôt qu’il aura quitté ce monde.
La postérité, en l’occurrence, lui a joué un tour à sa façon. Il y a deux manières pour un écrivain de tomber dans l’oubli. La première est de n’avoir connu aucun succès de son vivant : inconnu vous étiez, négligé vous serez. La seconde est d’avoir eu trop de succès, si bien que la génération suivante de lecteurs vous remise illico au grenier comme une chose poussiéreuse, au même titre que les meubles et les vêtements démodés de ses parents. C’est cette aventure qui est arrivée à Trollope, dont le purgatoire aura duré trois bons quarts de siècle, avant sa réhabilitation au premier rang des écrivains victoriens.
Anthony Trollope dans Locus Solus

Installée à Guernesey vers 1852 sur la recommandation d’Anthony Trollope, une des plus anciennes boîtes aux lettres encore en service au Royaume-Uni.






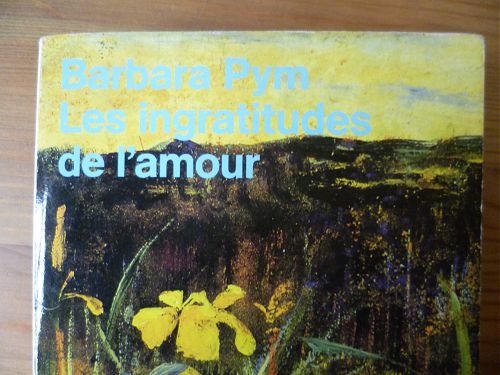
 Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.




 Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.