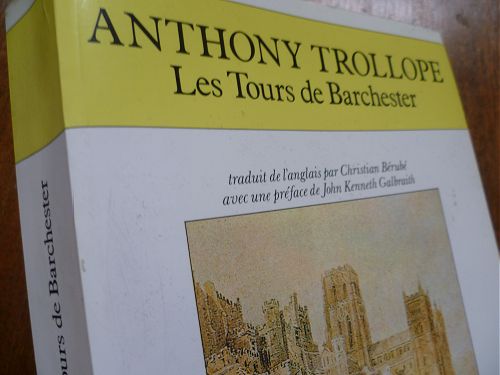
Ses vertus étaient trop nombreuses pour être décrites,
et pas assez intéressantes pour mériter de l’être.
On se régale à la lecture des Tours de Barchester, second des six romans d’Anthony Trollope situés dans le comté rural imaginaire du Barsetshire. Autour d’un événement microscopique, la nomination du nouveau directeur d’un hospice pour vieillards, Trollope déploie une réjouissante comédie humaine : querelles de presbytère, conflits de loyauté assaisonnés de quiproquos, luttes de clans et guerres d’influence entre conservateurs et réformistes de l’Église anglicane, dont les répercussions aussi bien sentimentales qu’économiques et politiques vont toucher plusieurs familles, à tous les échelons de la société. Ce gros livre riche en intrigues et en rebondissements, détaillés avec une minutie gourmande, séduit dès l’abord par sa variété de registres. La satire sociale, le sens du portrait et la finesse d’observation y entrent sans crier gare en collision avec le plus franc comique, suscitant fréquemment de grands éclats de rire.
Trollope est le plus renoirien des romanciers victoriens. Envisageant son petit monde avec une ironie bienveillante, il n’a pas son pareil pour illustrer l’adage de la Règle du jeu suivant lequel « tout le monde a ses raisons » et montrer « à quel point l’aspect de toute chose dépend de l’angle sous lequel on le regarde », du point de vue partiel, partial, de chaque personnage. Henry James, dont l’esthétique se situe aux antipodes et dont l’appréciation de Trollope était des plus mitigées, avait néanmoins vu juste en pointant combien ce dernier « sentait, en même temps qu’il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l’immédiateté ». Par exemple, si Trollope excelle à montrer le rôle moteur de l’argent et de l’ambition dans la vie sociale, il le fait sans tomber dans le déterminisme écrasant de Balzac ou de Zola. Au contraire, il s’emploie à maintenir son intrigue ouverte sur d’autres directions possibles, en suggérant qu’il s’en faudrait souvent d’un rien — d’un caprice comparable à la décision de Sabine Azéma de fumer ou de ne pas fumer dans Smoking/No Smoking — pour que l’enchaînement des péripéties et le jeu des forces en présence prennent une tout autre tournure.
Ce qui réjouit aussi, c’est la placidité bonhomme avec laquelle Trollope contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en difficulté… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. James, encore lui, reprochait vivement à Trollope ces entorses intempestives à l’illusion réaliste ; mais elles font justement toute la singularité de notre romancier. Paradoxal Trollope : voici un conservateur éclairé et pétri de gros bon sens qui excelle à démonter les préjugés d’une société dont il est un parfait représentant ; un brave ouvrier des lettres qui noircissait consciencieusement ses dix feuillets quotidiens entre ses tâches de fonctionnaire des Postes anglaises dans le but avoué de produire des romans à succès (il en écrivit quarante-sept en moins de quarante ans), et se révèle sans l’avoir cherché d’une étonnante modernité.
 Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.
Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.





