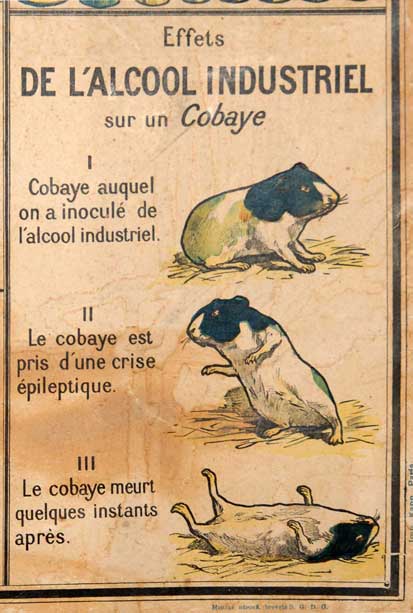La bonne dose
Jake, qui est à la fois plus sportif et plus hédoniste que moi, m’a appris ce qu’on dit au sujet des martinis : « Un, c’est parfait. Deux, c’est trop. Et trois, ce n’est pas assez. »
Julian Barnes, Pulsations.
Traduction de Jean-Pierre Aoustin.
Mercure de France, 2011.

Harry’s Bar
Entre ceux qui se faisaient remarquer par leur mutisme, je signalerai spécialement notre brave ami, l’Américain Harry Covayre.
Harry Covayre employait, pour le moment, toute son énergie à se confectionner des grogs au wiskey, compositions où il entrait relativement peu de sucre et, pour ainsi dire, presque pas d’eau.
Alphonse Allais, Vive la vie !
Compensation
— Que voulez-vous boire ?
— Moi, tu connais mes vices. Whisky-Vichy. Ça te dit, Frédéric ?
— Ah oui, tiens, c’est… c’est amusant. Jamais goûté.
— Une idée à moi. Le whisky n’est pas idéal pour le foie. Alors je compense avec du Vichy.
Luc Dellisse, Foudre. Éditions nocturnes, 1989.
L’absinthe suffit
La société des Rougon-Maquart, en effet, offrait bien des raisons de désespérer aux pessimistes ; ainsi la bohème Fin de Siècle fut-elle plus amère, plus dramatique que la bohème romantique. Le choix des boissons souligne assez bien la différence : les Décadents furent des buveurs d’absinthe, la « fée verte », placée sous le signe de l’eau et du froid :
« Par son ivresse verte aux lacis de lianes
Bois l’absinthe éployant des forêts et des mers. »
Iwan Gilkin
La génération de 1830, au contraire, buvait du punch. Un peu plus tard l’opium avait eu des adeptes, souvent sous forme de laudanum, avec Nerval ou Rossetti. Les drogues firent leur apparition vers 1880 ; un temps la morphine fut à la mode, puis l’éther qui rend fou assez rapidement, mais, le plus souvent, l’absinthe suffisait.
Philippe Jullian, Esthètes et Magiciens. L’Art fin de siècle.
Perrin, 1969.
Faulkner au travail
En rentrant à l’hôtel, je rencontrai Faulkner, qui, momentanément séparé de sa jeune compagne, semblait tout esseulé. Il me prit gentiment par le bras pour me diriger vers le bar :
« Jeune homme, je vais vous montrer un exemple de force de caractère… Hier soir, j’ai bu un peu plus que je n’aurais dû ; j’ai juré de m’abstenir aujourd’hui. Eh bien… malgré tout, je trouve en moi la volonté nécessaire pour surmonter cet obstacle et aller boire un coup… Garçon, un double dry Martini, s’il vous plaît ! Qu’est-ce que vous prenez ? »
Noël Howard, Hollywood-sur-Nil
… où l’on verra aussi Faulkner s’enfiler imperturbablement quatorze cocktails pour se remettre des émotions d’une arrivée à Paris quelque peu mouvementée, et convaincre le sommelier d’un hôtel de Saint-Moritz de mettre de côté pour sa consommation personnelle la réserve de chassagne-montrachet 1949. Mis au courant, l’impassible Howard Hawks laisse écouler un de ces silences interminables dont il a le secret, avant de commenter simplement : « Je crois que notre ami Bill aime assez boire un petit coup de temps en temps. »
Du peu de réalité
La réalité est une hallucination provoquée par le manque d’alcool.
Proverbe irlandais