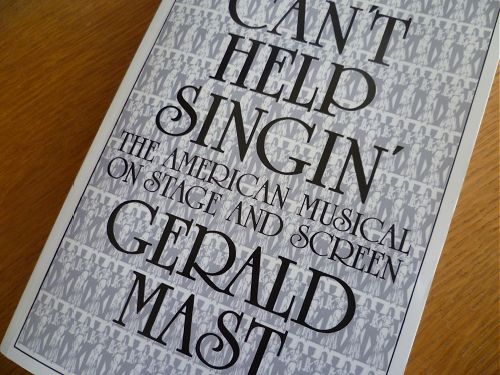Le détail qui cloche
Hommage, souvenir involontaire ou pure coïncidence ? Voici un moment hitchcockien dans un roman qui ne l’est aucunement.
Dès le lendemain matin, et tous les jours suivants, Objat a entrepris d’arpenter la région, s’étant procuré des cartes IGN au 1/25 000e. Quelque chose lui disant que Constance, disparue de la ferme sans laisser aucune trace de sa présence, ne pouvait pas se trouver très loin, il a systématiquement exploré le périmètre, voie par voie, écart par écart, pendant près d’une semaine, cochant ces lieux l’un après l’autre, sans aucun résultat. Jusqu’au moment où ces investigations lui ont paru vaines, qu’il n’a pas été loin de se décourager – ni de se demander comment il allait expliquer les choses au général Bourgeaud.
Jusqu’au moment où, passant pour la dixième fois sur une départementale dont il avait prospecté chaque dérivation, il a longé un vaste pré au fond duquel, déjà, sa vision périphérique avait enregistré un champ d’éoliennes alignées, tournant paisiblement. Mais un déclic a dû se produire cette fois dans son organisation perceptive, comme la prise de conscience floue d’un détail qui clochait, car il a soudain freiné, s’est arrêté, repartant en marche arrière jusqu’à stopper encore en plein milieu de la route à hauteur de ces aérogénérateurs dont il a considéré plus attentivement le tableau, sous un beau soleil d’arrière-saison. Il lui a fallu peu de temps pour constater que l’hélice d’une des éoliennes tournait en sens inverse des autres et, à nouveau, il a souri.
Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Minuit, 2016.
Impossible de ne pas penser à la scène de Foreign Correspondent d’Hitchcock, située aux Pays-Bas, où Joel McCrea remarque un moulin dont les ailes tournent dans le sens contraire de la direction du vent – signal adressé à un avion espion. Motif hitchcockien par excellence du détail qui cloche, de l’anomalie qui fait accroc dans une réalité jusque-là stable et désigne la présence du mal au cœur de l’ordre naturel. C’est le grand mouvement d’appareil qui va isoler tout au fond de la salle de danse, comme on épingle un papillon, le visage du batteur de l’orchestre affecté d’un clignement anormal des yeux (Young and Innocent). C’est le point rouge d’une cigarette grésillant dans un appartement plongé dans l’obscurité, qui accuse l’assassin (Rear Window). C’est l’avion anodin survolant le désert dans North by Northwest, petit point qui grossit dans le ciel, jusqu’à ce que quelqu’un remarque : « C’est curieux, voilà un avion qui sulfate des cultures, et pourtant il n’y a pas de cultures. »
D’où l’importance, pour Hitchcock, d’établir fermement au préalable le caractère conventionnel et rassurant de la réalité. L’un de ses trucs préférés, on le sait, consiste à recourir sans vergogne aux clichés touristiques nationaux. En Suisse, ils font du chocolat, alors le repaire des espions sera une chocolaterie (Secret Agent). Aux Pays-Bas, il y a des moulins et, confie Hitchcock à Truffaut, si Foreign Correspondent avait été filmé en couleur, il aurait ajouté une scène de meurtre dans un champ de tulipes qui se serait conclue par des gouttes de sang tombant sur des fleurs rouges. Et qu’est-ce que North by Northwest, sinon un travelogue nous baladant dans un certain nombre de lieux emblématiques des États-Unis, depuis le siège de l’ONU à New York jusqu’aux têtes géantes du mont Rushmore, en passant par une maison à la Frank Lloyd Wright ?
Je me demande si Joe Dante ne s’est pas souvenu de la leçon hitchcockienne dans la scène de la cuisine de Gremlins où les diablotins verts attaquent sauvagement une mère de famille. Quoi de plus rassurant, de plus domestique qu’une cuisine ? Mais voici que les appareils électroménagers, le grille-pain, le broyeur à légumes, le couteau électrique, se changent en instruments de mort, comme l’avion sulfateur de North by Northwest. Le confort du foyer se retourne contre lui-même.

Foreign Correspondent
L’auberge des pirates

Réalisé en 1939, Jamaica Inn est la dernière production anglaise d’Alfred Hitchcock avant son départ pour Hollywood, et la première de ses trois adaptations de Daphné du Maurier. Dans ses entretiens avec Truffaut, Hitchcock n’est pas tendre pour le film. Il s’entendit mal avec Charles Laughton et juge le scénario absurde et mal construit. On peut trouver cette sévérité excessive. Le côté Moonfleet du film est séduisant 1 ; la tenancière de l’auberge, obstinément loyale à son brigand de mari, est un beau personnage ; la sûreté de la mise en scène fait passer le dialogue verbeux et les incohérences de la trame. Bel emploi signifiant du décor, opposant deux intérieurs – et, à travers eux, deux classes sociales –, la demeure patricienne du juge dévoyé et l’auberge des pirates. L’espace à deux niveaux de l’auberge, ordonné autour d’un escalier (un de plus dans la filmographie hitchcockienne), avec ses paliers, ses corridors, ses chambres closes, ses percées (fenêtres et vasistas), ses secrets derrière la porte, est particulièrement bien exploité. Le motif du voyeurisme y circule discrètement. Maureen O’Hara passe son temps à écouter en cachette des conversations qui ne lui sont pas destinées et surprend, à travers un trou ménagé dans le mur de sa chambre, une tentative de meurtre. Ce plan est en quelque sorte le double inversé de celui de Psycho où Anthony Perkins épie Janet Leigh : Mary Yellard empêchera un meurtre tandis que Norman Bates en prépare un.


On pourrait citer bien d’autres détails d’exécution : le couteau qu’un tueur essuie en sifflotant (ce meurtrier qui sifflote est-il un souvenir de M le maudit ?) ; le feu accidentel qui, en se substituant à une lanterne éteinte, sauvera un navire du naufrage. Jamaica Inn est typiquement le genre de film où l’invention visuelle est plus riche que le scénario, sans pour autant se faire valoir à ses dépens. Hitchcock se montrait légitimement fier des prouesses techniques du tournage, à savoir les scènes de tempête et de naufrage entièrement reconstituées en studio. Elles sont effectivement impressionnantes et crédibles. Mais ce qui m’a le plus étonné, ce sont les premiers plans, qui paraissent sortis d’un film muet et ont presque un air de Murnau. Cet effet « cinéma muet allemand » reparaît ponctuellement par la suite et met en évidence le savoir-faire acquis par Hitchcock lors de son passage dans les studios de la U.F.A. Jamaica Inn – qui n’est pas pour rien coproduit par Erich Pommer – est finalement l’un de ses films où l’on aperçoit le mieux l’empreinte de l’esthétique expressionniste sur son cinéma.
1 À l’instar du jeune John Mohune dans le film de Fritz Lang, Mary Yellard est une orpheline initiée à l’existence du mal dans un repaire de pirates, tenu par des parents qui voient son arrivée d’un mauvais œil.


Hitchcock ou Murnau ?
Le dernier des indépendants
Diffusion lundi soir sur Arte de Charley Varrick, petite perle des années 1970 à ne pas manquer 1. Une des compositions les plus épatantes de Walter Matthau, un des meilleurs films de Don Siegel. Donald Westlake n’eut rien à voir de près de loin avec cette entreprise (le scénario est tiré d’un polar de John Reese) ; et pourtant, il m’a toujours paru que ce film était d’esprit plus westlakien que bien des adaptations de ses livres ; esprit sensible dans l’astuce des péripéties, l’humour sardonique et le pittoresque des personnages. Jean-Patrick Manchette avait noté que l’inscription Last of the independents, qu’arbore Charley Varrick au dos de sa combinaison de travail, pourrait désigner aussi bien le Parker de Westlake 2. C’était bien vu. Varrick n’est pas un braqueur professionnel à l’instar de Parker, mais il fait preuve des mêmes qualités : sang froid, intelligence, réactivité stratégique et capacité d’adaptation au cœur des pires pétrins. Et il se retrouve, comme Parker, seul contre tous, poursuivi à la fois par la police et la mafia. La manière dont il s’en tire rappelle d’ailleurs les premiers romans de la saga Parker, Comme une fleur et la Clique.
Il est des films criminels où nous en savons autant, ni plus ni moins, que le héros: nous progressons en même temps que lui dans les ténèbres de l’intrigue. D’autres où nous avons un temps d’avance sur lui : je sais qu’un tueur t’attend derrière cette porte, mais toi, personnage, tu l’ignores encore ; nooon ! n’entre paaas ! D’autres enfin où nous avons un temps de retard sur le protagoniste, parce qu’il est plus rapide et plus malin que nous. Charley Varrick appartient à cette dernière catégorie et c’est de ce ressort qu’il tire son pouvoir euphorisant. Constamment, nous assistons sans y rien comprendre aux manœuvres de Walter Matthau, dont la raison tactique ne se dévoilera qu’après coup.
L’autre intérêt du film est d’être un polar de province où le décor est doté d’une grande présence. L’intrigue se déroule au Nouveau-Mexique, bien que le tournage ait eu lieu dans le Nevada. Quoi qu’il en soit, Don Siegel tire le meilleur parti d’extérieurs soigneusement repérés, des bleds paumés aux étendues sauvages, en montrant une prédilection pour les « non-lieux » : parkings, terrains d’aviation désolés, casses automobiles, campings de caravanes sédentarisées, motels miteux et bordels improbables dressés au milieu de nulle part. Il court ainsi en filigrane de Charley Varrick une critique du décor nord-américain, marqué par la laideur anonyme et la dégradation des paysages. À l’appui de ce constat, Siegel pose çà et là des touches ironiques : un générique alignant des vues pastorales idylliques, en total contraste avec le climat de corruption généralisée qui suivra ; un plan sur une poubelle de rue portant une inscription invitant les bons citoyens à garder leur ville propre. Au milieu du film, une scène étonnante voit deux banquiers corrompus et aux abois discuter devant un enclos où paissent quelques aimables bovidés, dont ils en viennent à envier le sort paisible. Plus d’ironie, tout à coup, ou plus seulement de l’ironie, mais des sentiments mêlés. Après tout, même les gangsters les plus minables peuvent éprouver fugitivement du vague à l’âme élégiaque.
1 Le film est disponible en DVD, éditions Bac Vidéo.
2 Ainsi d’ailleurs que Don Siegel, pendant qu’on y est. En Charley Varrick, artisan futé de la cambriole luttant contre les professionnels du crime organisé, il est loisible de voir une projection du maverick Siegel, artisan de cinéma en butte au système hollywoodien.
Trop tôt, trop tard

Hollywood éclairé par Vittorio Storario : Café Society de Woody Allen
Woody Allen est tellement maître de son petit monde édifié film après film qu’il peut se permettre d’y flâner en remixant nonchalamment ses figures, ses thèmes et motifs familiers : New York et Hollywood, les occasions manquées, le mauvais timing du désir (un coup trop tôt, un coup trop tard), le regret de ce qui aurait pu être et qui ne sera pas, les mères juives et leurs familles nombreuses, les gangsters du jazz age, les conversations métaphysiques de comptoir sur le silence de Dieu et l’absurdité de la mort. Comme plusieurs de ses films, Café Society se déroule sur une année et s’achève par un réveillon de Nouvel An doux-amer. Au terme de ces douze mois, les personnages ont changé, il y a eu des morts et des naissances, la vie continuera. C’est peut-être dans ce registre de la libre chronique – animant au passage une foule de personnages épisodiques en procédant par apartés et bifurcations sans pour autant perdre son fil – qu’Allen est à son meilleur (on songe bien sûr à Hannah et ses sœurs). La voix off achève de donner un caractère de nouvelle filmée à cet opus aimable où les amours déçues ont un parfum fitzgéraldien.
La poursuite du bonheur

Road Show est le dernier musical en date de Stephen Sondheim. Sa genèse fut longue et compliquée. Il fallut quatorze années de réécritures et de remaniements, quatre versions du livret sous quatre titres différents (Wise Guys, Rush, Gold ! et Road Show) et trois metteurs en scène pour que l’ouvrage trouve sa forme définitive. Il s’agit, après Pacific Overtures et Assassins, du troisième musical de Sondheim écrit avec John Weidman. Les trois spectacles ont en commun d’évoquer une tranche d’histoire des États-Unis et d’interroger les ratés du rêve américain, l’obsession de la réussite et de la pursuit of happiness.
Inspiré de l’histoire vraie des frères Mizner, qui défrayèrent la chronique au début du XXe siècle, Road Show met en scène le destin de ces deux frères, Wilson et Addison, unis par une relation dominant-dominé du genre « ni avec toi ni sans toi ». Partis chercher fortune sur l’injonction de leur père mourant, ils se lanceront dans diverses entreprises qui se solderont toutes par un échec. Wilson, séduisant beau parleur, est l’escroc-aventurier type, jamais à court de discours enjôleurs pour embobiner les commanditaires gogos et les riches héritières qu’il convainc de financer ses arnaques successives. Addison, doté d’une sensibilité artistique et d’un demi-talent, finira par s’accomplir comme architecte d’horribles villas pour nouveaux riches de Palm Beach, en découvrant son homosexualité au passage. Comme il arrive souvent dans les meilleures familles, c’est le « mauvais » frère flamboyant qu’on traite en chouchou et qu’on cite en exemple au « bon » frère malchanceux. La narration, procédant par juxtaposition de vignettes rapides, traverse au pas de charge trente ans d’histoire américaine, de la ruée vers l’or du Klondike au boom immobilier de la Floride des années 1920, en passant par le monde du théâtre new-yorkais des années 1900. Et comme dans d’autres Sondheim, on découvrira aux toutes dernières minutes que le spectacle était en fait une histoire de fantômes rejouant leur vie dans un espace-temps imaginaire.
L’équilibre du livret se ressent sans doute de sa gestation difficile et de ses couches d’écriture successives. Il lui manque un je ne sais quoi pour se hisser au sommet de l’œuvre de Sondheim, à côté d’Assassins avec lequel il présente de nombreuses parentés. Néanmoins, Road Show demeure une œuvre brillante et tonique. Sondheim fait de nouveau des prouesses dans le mélange des tons – de l’ironie sarcastique à la pure délicatesse, d’autant plus poignante qu’elle survient sans crier gare –, l’invention harmonique et mélodique, la circulation et la paraphrase des thèmes, le ping-pong d’un parler-chanter virtuose exigeant des interprètes une précision sans faille.

La reprise du spectacle à l’Union Theatre de Londres, dans une production à tout petit budget, est enthousiasmante de dynamisme et d’énergie. Cette salle de béton brut est un théâtre de poche de cinquante places, d’aspect quasi underground, enkysté au pied d’un pont ferroviaire du South Bank de manière si discrète qu’on est passé une première fois devant sans le voir. La mise en scène de Phil Willmott tire un parti constamment inventif de l’exiguïté des lieux et d’une scénographie réduite au minimum vital : un bureau, une table de bar, des chaises et divers accessoires, un miroir sans tain dressé au fond d’une scène de plain pied où les protagonistes peuvent surgir à tout moment de partout quand on les attend le moins, des côtés de la salle comme de derrière les spectateurs. Des cinq premiers rôles aux choristes, tous les interprètes sont formidables et se donnent à fond. Les comédiens anglais nous épatent toujours, ils savent tout faire : jouer, bouger, changer de rôle à vue, chanter et danser. Citons-les tous : Howard Jenkins, Andre Refig, Cathryn Sherman, Steve Watts et Joshua LeClair ; Cameron Hay, Amy Perry, Amy Reitsma, Phil Sealey, Laura Jade Clark, Damian Robinson, Sam Sugarman, Alexander McMorran, Jonny Rust et Christian Thornton.

Shakespeare en abyme

Éblouissante reprise de Kiss Me, Kate (1948) au Théâtre du Châtelet, devenu sous la direction de Jean-Luc Choplin le temple parisien de la comédie musicale américaine. Ce backstage musical fut le plus gros succès critique et public de Cole Porter, à une époque où sa cote était à la baisse. Le livret de Sam et Bella Spewack propose un brillant exercice de théâtre dans le théâtre. Un comédien engage son ex-femme pour jouer une version musicale de la Mégère apprivoisée. Rivalisant de cabotinage et de muflerie, le couple se querelle autant en coulisses que les personnages qu’ils interprètent sur scène 1. Comme dans les comédies de Shakespeare, ce couple vedette est redoublé par un second couple du type valet et soubrette — ici, une comédienne volage et un danseur ayant la passion funeste des cartes. Et comme chez Shakespeare encore, un troisième tandem plébéien fournit un contrepoint burlesque — ici, une paire de gangsters incompétents venus encaisser une dette de jeu, qui s’invitent dans la représentation et finissent par prendre goût au théâtre.
Enfant des années folles, Cole Porter resta longtemps fidèle au musical de type revue, où l’on empile les numéros sans souci de cohérence narrative, et ne vint que tardivement au musical à livret, dont Kern et Hammerstein avaient imposé le modèle avec Show Boat. Tout en adoptant cette forme nouvelle dans Kiss Me, Kate, où tous les numéros sont en situation, il conserve ses vieux réflexes de revuiste procédant par morceaux de bravoure en variant les ambiances musicales pour maintenir son public en éveil. Il y a ainsi un hymne au show business et au trac des premières qui lorgne vers Irving Berlin (Another Op’nin’, Another Show), des pastiches de valses viennoises, une béguine émouvante (So in Love), du jazz cuivré qui swingue… et beaucoup, beaucoup de chansons à listes dont Porter s’était fait une spécialité (Gerald Mast parle à leur sujet de catalog songs), où il fait preuve d’une verve inépuisable dans l’énumération et la fausse fin à répétition (quand on croit que c’est terminé, il en vient encore). Les paroles sont un feu d’artifice verbal où les rimes acrobatiques et les paronomases font bon ménage avec le name dropping sarcastique et les sous-entendus sexuels2. L’humour chez Porter naît de la collision inattendue des registres. Le lexique soutenu se rencontre avec le slang déluré, les allusions culturelles chics et les clins d’œil pour initiés se heurtent sans crier gare à des références totalement triviales.
Kiss Me, Kate est un spectacle euphorisant parce qu’il procure trois heures durant le sentiment d’être au spectacle, tout en jouant avec les conventions de la représentation : l’enseigne lumineuse du théâtre se détraque, l’action des coulisses interfère avec la pièce dont elle perturbe le cours, en franchissant ponctuellement le quatrième mur au passage. De la distribution homogène — où l’on détachera Christine Buffle et David Pittsinger, aux voix superbes, et le tandem bouffon Martyn Ellis-Daniel Robinson — à la direction musicale de David Charles Abbel — qui a effectué un travail de recherche approfondi pour établir une édition critique de la partition originale —, en passant par les chorégraphies enlevées de Nick Winston, tout est épatant. La mise en scène de Lee Blakeley joue du contraste entre le monde de la scène et celui des coulisses. Au kitsch d’opérette assumé avec éclat de la pièce dans la pièce s’oppose l’ambiance nocturne années 1940 de la vie backstage (régie, loges et entrée des artistes, toit du théâtre où la troupe, écrasée par la chaleur des spots, monte se rafraîchir durant l’entracte, le temps d’un Too Darn Hot endiablé). En parfaite osmose, la scénographie de Charles Edwards ménage des transitions souples entre ces différents espaces au moyen d’un plateau tournant et d’un jeu de rideaux et d’écrans semi-transparents. Les arrière-plans sont constamment animés, de manière parfois si profuse (la scène d’ouverture) qu’on aimerait disposer d’un DVD pour goûter à loisir les trouvailles de détail de cette production, dont le faste flamboyant renoue avec le Broadway des grands jours.
1 L’argument fut inspiré au producteur Arnold Saint-Subber par un couple de comédiens des années 1930, Alfred Lunt et Lynn Fontanne, célèbre pour ses disputes perpétuelles. Pour ajouter à ces jeux de miroir, Sam et Bella Spewack étaient eux-mêmes en instance de séparation lorsqu’ils écrivirent le livret.
2 Lesdits sous-entendus valurent à Porter d’être fréquemment banni des ondes radiophoniques. Ils seront fort édulcorés dans l’adaptation hollywoodienne de Kiss Me, Kate, au demeurant la meilleure comédie musicale de George Sidney. « The Kingsley Report » y devient « the latest report » et les couplets les plus lestes du désopilant Brush up your Shakespeare ont été pudiquement supprimés.
Sur les ailes de la danse
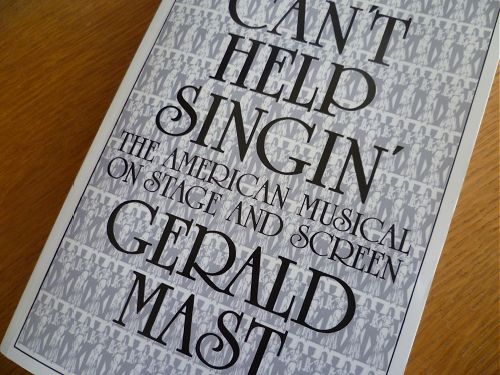
Repéré dans la bibliographie du Gene Kelly d’Alain Masson (Folio biographies, 2012), ce passionnant essai sur la comédie musicale américaine se recommande par de nombreuses qualités. Les ouvrages sur l’histoire de Broadway abondent ; de même ceux sur l’histoire de la comédie musicale hollywoodienne. L’intérêt de Can’t Help Singing est de raconter de front ces deux histoires étroitement imbriquées. Le fil rouge du livre — le musical, forme totalisante à l’instar de l’opéra européen du XIXe siècle, est par excellence l’expression artistique de la culture américaine du XXe siècle en même temps qu’un creuset multiculturel — est sans doute devenu un lieu commun. Mais l’approche stimulante de Gerald Mast lui conserve toute sa pertinence, conjuguant d’une plume vivante et précise la vue d’ensemble et le plan rapproché, l’information factuelle, la mise en contexte socio-historique et l’analyse esthétique souvent très fouillée. Les amateurs d’Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, Lorenz Hart, Ira et George Gershwin, Rodgers et Hammerstein y gagneront une connaissance approfondie de leurs auteurs et compositeurs de prédilection. Attentif au « fond » autant qu’à la « forme », Mast a le chic pour faire découvrir des détails inaperçus dans des œuvres qu’on croyait connaître par cœur, notamment parce qu’il envisage une chanson comme un tout organique cohérent, en montrant exemples à l’appui comment la ligne mélodique et la grille harmonique sont intimement accordées au propos, à la prosodie et à l’invention verbale du texte. Il en va de même pour le cinéma. Les chorégraphies de Busby Berkeley, le cycle Fred Astaire-Ginger Rogers à la RKO ou les films produits par Arthur Freed à la MGM sont analysés avec une grande attention au style visuel et à la mise en scène. On n’est pas surpris, en se renseignant sur l’auteur, d’apprendre qu’il fut un historien du cinéma réputé, auteur notamment de monographies sur la comédie et sur Howard Hawks, qu’on a du coup fort envie de lire.
Can’t Help Singing date de 1987. Il aurait mérité une édition mise à jour rendant compte de l’évolution ultérieure du genre. Hélas pour nous, Gerald Mast eut la mauvaise idée de mourir l’année suivante.