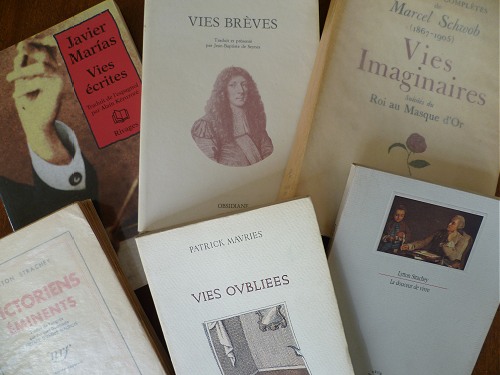Un canular
Pierre Louÿs avait un penchant prononcé pour le canular, et son ami Gide — qui marchait à tous les coups — en fit les frais plus souvent qu’à son tour. Si ma mémoire est bonne, c’est d’ailleurs une de ces mystifications, la goutte de trop qui fait déborder le vase, qui fut à l’origine de leur brouille définitive. Quoi qu’il en soit, on imagine avec une joie un peu sadique la tête du Gide recevant coup sur coup les lettres suivantes (lesquelles sont d’esprit tout à fait paludesque, comme pour élever la plaisanterie au carré). En 1894, Gide et Louÿs sont respectivement âgés de vingt-cinq et vingt-quatre ans.
1. Pierre Louÿs à André Gide
[jeudi, 13 décembre 1894]
Paludes est extraordinairement bien. Mon vieux, je suis dans une joie folle. C’est mille fois mieux que je n’espérais.
Seulement tu es un petit saligaud de l’avoir donné à Valéry d’abord et de lui avoir interdit de me le montrer ensuite. La seule chose qui me console, c’est qu’il ne l’a pas lu : il vient de me l’avouer.
Je suis donc le seul à le connaître.
Et il fallait que je fusse le seul.
Et il faut que je reste le seul.
J’ai bien réfléchi : si je l’enferme dans un tiroir, un jour ou l’autre je te le rendrai (mauvais moyen).
Si je le fais copier et que je détruise l’original… — même résultat.
Alors je vais faire un crime. Notre amitié, Gide, devait aboutir là. C’est une situation dramatique que Monsieur Polti n’a pas prévue : «l’œuvre du héros détruite par son ami». Et par pure amitié, note bien. Je ne détruirais pas les légumes de Monsieur Gabriel Trarieux ni les biftecks de Monsieur Barrès.
JE NE VEUX PAS que PERSONNE autre que moi lise Paludes. Je vais le relire une seconde fois et le brûler feuille à feuille, très avant dans la nuit.
Voilà qui sera une page intéressante de notre biographie. Mais tu ne mérites pas d’être mon ami si tu ne l’admires pas.
P.L.
Quelques notes posthumes qui seront intéressantes plus tard : Le manuscrit de Paludes était de cent vingt-deux pages 21 x 32 écrites au recto à l’encre noire. Les pages 40, 41, 43 sur papier teinté quadrillé au filigrane ; les autres sur vergé blanc non ébarbé.
L’œuvre se composait de six chapitres, plus un envoi, une alternative et une « table des phrases les plus remarquables de Paludes ».
2. Pierre Louÿs à André Gide
Même soirée. 2 h du matin.
Je n’ai pas besoin de te dire que, quand je t’ai écrit ma lettre d’il y a trois heures, je n’avais pas encore lu Paludes.
***
 Extrait de la kolossale Correspondance à trois voix GIDE/LOUŸS/VALÉRY. Gallimard, 2004, 1679 p.
Extrait de la kolossale Correspondance à trois voix GIDE/LOUŸS/VALÉRY. Gallimard, 2004, 1679 p.
Monk’s Casino
 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
 Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Chambres

Ouagadougou, février 2003
Les riches heures de Roger Fry
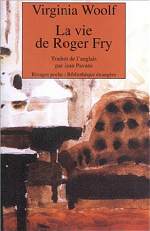 Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.
Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.
 À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.
À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.
Une anecdote, racontée dans les premières pages et reprise au fil du livre comme un leitmotiv, montre bien comment Woolf s’y prend pour cerner le noyau dur de la personnalité de Fry. Enfant, Roger pouvait s’absorber des heures dans la contemplation d’un touffe de pavots qui poussait dans le jardin familial, à attendre l’éclosion d’une fleur. Sa sœur aînée le surprit dans cette attitude et se moqua de lui, « comme le firent toutes les grandes personnes quand elles connurent l’histoire, car toutes les passions, même pour les pavots rouges, exposent au ridicule ». Si Fry s’affranchit par la suite d’une éducation rigide, cette « scène primitive » éclaire le conflit permanent qui se joua en lui entre la raison et la passion, et empêcha cet homme sensible et chaleureux, mais trop réfléchi, trop analytique, de devenir le grand peintre qu’il avait rêvé d’être – il fut assez lucide pour en avoir conscience et en souffrir. Loin de l’exhaustivité assommante qui est devenue la loi du genre, le délicat « filet à papillon » de Virgina Woolf a su de la vie de Fry capturer l’essentiel. C’est d’abord affaire d’écriture et l’on voit bien que la biographe n’oublie jamais, dans cette œuvre de commande, la romancière aux antennes ultra-sensibles qu’elle était avant tout. De sorte que ce livre, à l’instar de ceux de Lytton Strachey, autre membre du groupe de Bloomsbury, autre éminent biographe, se pose en contre-modèle exemplaire de presque tout ce qui s’écrit aujourd’hui en matière de biographies.
 Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.
Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.
Échouage
 Cher internaute qui avez abouti en ces lieux en tapant la requête « série noire baleine échouée » dans votre moteur de recherche,
Cher internaute qui avez abouti en ces lieux en tapant la requête « série noire baleine échouée » dans votre moteur de recherche,
Si par hasard vous repassez par ici, le livre que vous cherchez est très probablement la Baleine scandaleuse de John Trinian, le meilleur de son auteur et l’un de ces romans atypiques qui font le sel de la Série noire. Cette chronique unanimiste rassemble une brochette de personnages autour d’un énorme cétacé gris qui s’est inexplicablement échoué sur une plage californienne : un tueur en fuite, un flic stupide et raciste, un représentant de commerce, des gosses de riches, un acteur de second plan raté et sa jeune épouse, un tandem de scénaristes alcooliques, le conducteur de la dépanneuse chargé d’évacuer la baleine, etc. Comment cet événement singulier va interférer, un jour durant, avec la vie des uns et des autres, c’est ce que raconte ce livre très peu « policier » par les péripéties pratiquement exemptes de violence et de crimes, mais totalement « roman noir » par l’ambiance et l’écriture.
 John TRINIAN, la Baleine scandaleuse (The Whale Story). Traduction de Philippe Marnhac. Gallimard, Série noire n° 919, 1965, 185 p.
John TRINIAN, la Baleine scandaleuse (The Whale Story). Traduction de Philippe Marnhac. Gallimard, Série noire n° 919, 1965, 185 p.
Biographies miniatures
The retriving of these forgotten Things from oblivion in some sort resembles the Art of a Conjuror, who makes those walke and appeare that have layen in their graves many hundred years.
John Aubrey
Pour autant que cela nous occupe, nos idées générales peuvent être semblables à celles qui ont cours dans la planète Mars et trois lignes qui se coupent forment un triangle dans tout l’univers. Mais regardez une feuille d’arbre, avec ses nervures capricieuses, ses teintes variées par l’ombre et le soleil, le gonflement qu’y a soulevé la chute d’une goutte de pluie, la piqûre qu’y a laissée un insecte, la trace argentée du petit escargot, la première dorure mortelle qu’y marque l’automne ; cherchez une feuille exactement semblable dans toutes les grandes forêts de la terre : je vous mets au défi. Que tel homme ait eu le nez tordu, un œil plus haut que l’autre, l’articulation du bras noueuse ; qu’il ait eu coutume de manger à telle heure un blanc de poulet, qu’il ait préféré le Malvoisie au Château-Margaux, voilà qui est sans parallèle dans le monde. Aussi bien que Socrate, Thalès aurait pu dire : gnôthi seautón ; mais il ne se serait pas frotté la jambe dans la prison de la même manière, avant de boire la ciguë. Les idées des grands hommes sont le patrimoine commun de l’humanité ; chacun d’eux ne posséda réellement que ses bizarreries.
Marcel Schwob, Vies imaginaires.
La biographie à l’anglo-saxonne se subdivise en deux espèces : la famille des pavés, et celle des vies brèves, dont on doit l’invention à John Aubrey (1626-1697).
Chez les premiers, une exhaustivité épuisante et souvent fastidieuse. Il y a, bien sûr, d’heureuses exceptions ; mais trop fréquemment l’empilement des faits et l’absence de mise en perspective aboutissent à un nivellement qui rabat sur le même plan le témoignage essentiel, la note de blanchisserie et la révélation mesquine.
La biographie brève est, au contraire, un art de la miniature, qui mêle le portrait moral à la collection d’anecdotes — ou plus justement suggère celui-là à travers celles-ci. Il s’agit, en un court récit soigneusement agencé, d’épingler quelques moments révélateurs qui, mieux qu’un inventaire exhaustif, font surgir sous nos yeux une silhouette et un caractère. De là un penchant prononcé pour les bizarreries et les excentricités qui font la singularité irréductible d’une existence. N’est-ce pas pour leurs gestes, leurs manies, une façon de sourire en coin ou de pencher la tête que nous chérissons nos proches ? Et n’est-ce pas la première chose qu’on oublie lorsqu’ils ont disparu ?
Ainsi la biographie brève fait-elle la part belle au hasard et au caprice, là où le pavé véhicule souvent, à son insu ou non, une vision déterministe de l’existence : on y apprendra — en caricaturant — que tel grand personnage a un complexe d’agressivité parce qu’à l’âge de dix ans il a reçu injustement une paire de gifles de son père. Au fond, en suivant son sujet à la trace durant 500 ou 700 pages, l’auteur de pavés se berce de l’illusion qu’on peut dire le tout d’une vie, et par là saisir la vérité d’un être. Tandis que, dans son caractère partiel et lacunaire, la biographie brève semble plutôt faire écho à la précarité et à l’incomplétude fondamentales de toute vie humaine, qu’elle souligne et conjure à la fois : arrachant à l’oubli des petits riens négligés, comme l’écrit Aubrey, le microbiographe n’est pas seulement un magicien qui ressuscite des fantômes ; c’est un mélancolique qui dresse un rempart de mots contre la fuite du temps et la mort.
Cet art encore rudimentaire chez Aubrey, un Lytton Strachey l’aura élevé à son point de perfection. De consommés anglophiles en perpétuent aujourd’hui la tradition, de Patrick Mauriès à Javier Marías. Dans l’intervalle, de fins lettrés tels que Marcel Schwob et Jorge Luis Borges se sont emparés du genre, non sans l’infléchir en brouillant insidieusement la frontière entre la réalité et la fiction — comme pour suggérer que toute vie est peu ou prou une vie imaginaire.
***
Un choix succinct des Vies brèves d’Aubrey a paru chez Obsidiane en 1989. Les Vies imaginaires de Marcel Schwob sont disponibles dans de nombreuses éditions (L’Imaginaire, Garnier-Flammarion, Petite Bibliothèque Ombres, Phébus, Gérard Lebovici). De Lytton Strachey, on trouvera les Victoriens éminents chez Gallimard, et trois recueils au Promeneur : Cinq excentriques anglais, Scènes de conversation et la Douceur de vivre. Les biographies synthétiques de Borges sont recueillies dans le premier volume de ses Oeuvres complètes (Gallimard, La Pléiade, 1993). Les très belles Vies oubliées de Patrick Mauriès et les plus inégales Vies écrites de Javier Marías sont publiées chez Rivages.
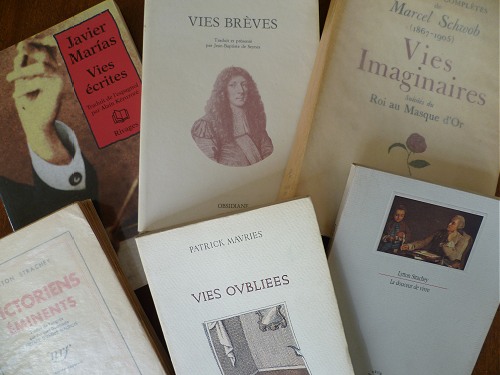
 Extrait de la kolossale Correspondance à trois voix GIDE/LOUŸS/VALÉRY. Gallimard, 2004, 1679 p.
Extrait de la kolossale Correspondance à trois voix GIDE/LOUŸS/VALÉRY. Gallimard, 2004, 1679 p.





 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
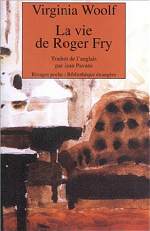 Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.
Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps. À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.
À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement. Cher internaute qui avez abouti en ces lieux en tapant la requête « série noire baleine échouée » dans votre moteur de recherche,
Cher internaute qui avez abouti en ces lieux en tapant la requête « série noire baleine échouée » dans votre moteur de recherche,