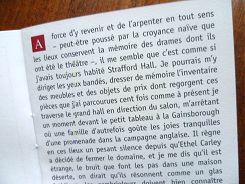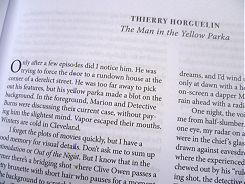Enlivrés
Beau néologisme.
je la regarde oui lire un livre les yeux fascinés puis remontant parfois sur la page reculant d’un paragraphe sur la page précédente en réalité elle lisait deux ou trois fois le livre dans notre appartement nous vivons enlivrés depuis les quelques livres de poche dont je ne trouvais pas l’autre édition jusqu’aux livres d’architecture son admiration pour l’architecture moderne elle vous citait tous les noms avec la manière de chacun ses caractéristiques je n’aime pas les livres aujourd’hui je déteste les livres mais j’y reviendrai dans quelques jours […]
Michel Beaulieu, Je tourne en rond mais c’est autour de toi,
éditions du Jour, 1969
De la copie comme création
Il existe un vertige philologique. Le génie de Borges fut d’apercevoir qu’il y avait là non seulement sujet à réflexion, mais matière à fiction — et à invention d’un fantastique inédit. Cependant, les spéculations borgésiennes recoupent des questions bien réelles qu’aborde Luciano Canfora dans son essai le Copiste comme auteur — en convoquant d’ailleurs Pierre Ménard dans le cours de sa démonstration.
Quoiqu’il s’appuie sur une érudition considérable, ce petit livre est moins une étude savante qu’une succession de courts aperçus sur un même écheveau de problèmes, envisagés à chaque chapitre à partir d’un angle de vue différent. S’agissant des textes de l’Antiquité classique, la question est de savoir ce qu’on lit et même qui on lit, autrement dit de s’interroger sur les processus de transmission par lesquels les textes anciens nous sont parvenus. Ces questions sont loin d’être récentes. Tels érudits du IVe siècle se la posaient déjà à propos de textes vieux pour eux de huit cents ans, ce qui donne une idée de l’abîme qui nous sépare de ces derniers. De la tradition orale au codex en passant par les rouleaux de papyrus, chacun sait que les textes anciens ont connu une histoire mouvementée : copiés et recopiés avec tous les risques d’erreurs qui s’ensuivent, ils furent remaniés, altérés, cités, traduits, abrégés, compilés, détruits, reconstitués… Le travail du philologue, suppose-t-on alors, consisterait à reconstituer patiemment, par la comparaison des diverses variantes conservées, leur généalogie de manière à remonter jusqu’à l’archétype le plus sûr. Or, les choses ne sont pas si simples.
Loin d’avoir été linéaire et verticale, la transmission des textes s’est effectuée de manière oblique et polycentrée, si bien que la notion même d’archétype apparaît illusoire. D’une part, l’intervalle entre ces archétypes et la date de composition de l’œuvre peut être immense, et les altérations les plus importantes surviennent généralement au début de la vie d’un texte. D’autre part, le manuscrit identifié comme archétype pourra n’être qu’une copie parmi d’autres qui aura eu la chance « arbitraire » de survivre. L’une des raisons en est la fragilité des lieux de collecte et d’archivage que furent les grandes bibliothèques comme celle d’Alexandrie, plus riches mais aussi plus vulnérables parce que plus fréquemment sujettes aux pillages et aux destructions que des bibliothèques privées situées à la périphérie des grandes cités. Ce sont donc de celles-ci que nous tenons souvent les copies les plus anciennes, qui ne sont pas forcément les plus fiables.
Plus fondamentalement, les notions d’auteur et de création originale sont des inventions modernes, et il y a quelque anachronisme à les appliquer à l’Antiquité et au Moyen Âge, où elles recouvraient des réalités beaucoup plus instables et mouvantes. Dans l’Antiquité, un « manuscrit » original pouvait n’être rien d’autre qu’un ensemble de notes, de feuillets servant de support à un enseignement oral, de sorte qu’au moment de la première transmission, il y eut d’emblée multiplication d’interprétations, de variantes et de ramifications, donnant lieu à plusieurs versions d’une même « œuvre ». Au passage, Canfora pointe la dimension collective du mode de composition des textes, en rappelant que certains corpus philosophiques des écoles platoniciennes ou aristotéliciennes furent élaborés, au sein de cercles d’érudits, par des communautés de lecteurs. Dès lors, le copiste cesse d’être ce scribe ignorant qui dénature, en le recopiant, un texte qu’il ne comprend pas ; il faut plutôt l’envisager comme son premier éditeur (au sens anglais : editor et non publisher). La copie ne fut pas seulement le vecteur de la transmission des textes; elle appartient de plein droit au processus de leur élaboration.
 Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.
Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.
Anthologie
Élisabeth Dayre (1860-1933) épousa en 1899 le poète symboliste Gustave Kahn. Ses nombreuses liaisons antérieures avec des écrivains (Saint-Pol Roux, Jean Moréas, Rodolphe Darzens, et l’on en passe) l’avaient fait surnommer « La Petite Anthologie ».
Dimanche à Pékin (2)
Un peu plus tard, dans Dimanche à Pékin, un fondu enchaîné nous transporte, en un mouvement typiquement markerien, de l’image d’un lieu à ce lieu.


Et voici ce que dit le commentaire :
Je rêvais de Pékin depuis trente ans sans le savoir. J’avais dans l’œil une gravure de livre d’enfant sans savoir où c’était exactement.
C’était exactement à Pékin : l’allée qui conduit au tombeau des Ming. Et un beau jour, j’y étais. C’est plutôt rare de pouvoir se promener dans une image d’enfance.
Pouvoir se promener dans une image d’enfance : bon sang, mais c’est déjà la Jetée !
Dimanche à Pékin (1)

L’Ambassade
Certains films se révèlent après coup comme la bande-annonce d’une œuvre à venir. Par exemple, Dimanche à Pékin de Chris Marker (1956).
Vous avez peut-être vu l’Ambassade du même Marker (1975). Ce court métrage sans nom d’auteur se présente comme un film Super 8 amateur. On y voit des opposants politiques trouver refuge en pagaille dans une ambassade après un coup d’État. Ils y séjourneront quelque temps. Le pays n’est jamais nommé. On subodore à certains indices qu’il s’agit d’une dictature d’Amérique latine, probablement le Chili après le coup d’État de Pinochet. Pellicule rayée, image tremblante, coups de zoom maladroits, mouvements d’appareil et montage heurtés : tout suggère le document tourné à chaud. À la fin du film, on évacue les réfugiés. La caméra panote alors vers le ciel et l’on découvre… la tour Eiffel, dans le lointain, au crépuscule. Le pseudo-reportage n’était qu’une géniale supercherie filmée à Paris, moquant la confiance bête que nous prêtons aux images pour peu qu’elles adoptent l’apparence d’un documentaire.
Or, cet effet, j’ai eu la surprise de le retrouver au début de Dimanche à Pékin, tourné quelque vingt ans plus tôt, que je n’avais pas revu depuis des lustres et dont j’avais à peu près tout oublié, si ce n’est une vague impression d’ensemble, et le souvenir de couleurs magnifiques, vives et saturées, typiques des pellicules Eastmancolor.
Au début du film, la caméra panote sur diverses babioles chinoises étalées en désordre sur un balcon. Là-dessus, un rapide mouvement ascendant nous découvre la tour Eiffel dans l’embrasure d’une fenêtre. Nous nous croyions à Pékin ; mais non, nous étions encore à Paris. Le documentaire, chez Marker, est toujours réflexion sur le documentaire, ce que confirmera Lettres de Sibérie (1958) et sa célèbre séquence reprise trois fois de suite avec trois commentaires différents, histoire de montrer qu’on peut faire dire à peu près ce qu’on veut à des images : le premier commentaire est de type propagande communiste, le deuxième de type propagande anti-communiste, le troisième aussi neutre que possible mais en fait pas si neutre que cela, la neutralité étant en tout état de cause impossible.


Dimanche à Pékin
Nouvelles du front

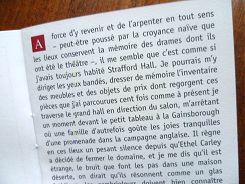
Marienbad raconté par Agatha Christie : c’est l’Enquête, une nouvelle qui paraît dans le cadre de la Fureur de lire (9-13 octobre), avec cinq autres signées Geneviève Damas, Sophie Daxhelet, Fidéline Dujeu, Joseph Ndwaniye et Max de Radiguès. Lesdites nouvelles, imprimées sous forme de plaquettes tirées à plusieurs milliers d’exemplaires (!), seront distribuées gratuitement dans les librairies, les bibliothèques et les écoles secondaires. On peut les télécharger au format PDF ici.

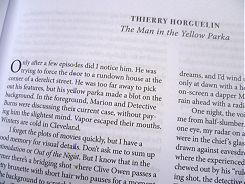
Sous le titre The Man in the Yellow Parka, ma nouvelle l’Homme à l’anorak jaune paraît en anglais dans la revue semestrielle Eleven Eleven (no 15), publiée par le California College of the Arts de San Francisco. (L’anorak est devenu une parka pour des raisons d’euphonie.) Je remercie encore une fois mon traducteur Edward Gauvin pour sa ténacité, la finesse et la précision de son travail, le plaisir pris à nos échanges. Voilà un homme qui traduit en écrivain qu’il est aussi et se dépense sans compter pour « ses » auteurs.
Autoportrait en miettes

La première entrée s’intitule « A » ; la dernière, « Zibaldone ». Malicieux pied de nez qu’adresse, au genre devenu banal de l’abécédaire, ce livre qui « n’a ni début ni fin. Pas de forme bien arrêtée non plus ».
Fragments d’une forêt fait suite aux Lieux parallèles, paru chez Plon voici près de quinze ans. L’ouvrage se recommande d’une longue tradition qui remonte à l’Antiquité (Athénée, Macrobe, Aulu-Gelle) et s’épanouit à la Renaissance (Érasme, Bacon) ainsi que chez les baroques anglais chers au cœur de l’auteur. Une forêt, apprend-on au seuil du livre, désignait alors « un recueil mêlé de notes et de marginalia, une collection de fragments et de faits récupérés chez les uns pour être proposés aux autres ». Bacon éleva même le genre au carré en s’attelant, au soir de sa vie, à la compilation d’une forêt des forêts (Sylva Sylvarum).
Il s’agit donc d’un carnet de bord réunissant citations et notes de lecture, exercices d’admiration, portraits et biographies brèves, choses vues et beaux faits divers, notations intimes, épiphanies de la vie ordinaire liées à des lieux, des amours, des rencontres. On s’y promène entre Londres, Paris, Nice, Rome, Sienne et Milan. On y croise Italo Calvino, Federico Zeri, Giorgio Manganelli, Pierre Lesieur, Boris Kochno, Olivier Larronde, Tomaso Buzzi et quantité d’autres figures inclassables d’écrivains, de peintres, d’architectes, de décorateurs, d’érudits, d’excentriques et de collectionneurs d’hier et d’aujourd’hui. L’usage des formes brèves qu’affectionne Patrick Mauriès convient idéalement à l’évocation oblique de ces créateurs en marge, à l’écart du mainstream comme des avant-gardes patentées, qui nourrissent depuis toujours ses passions de lecteur, d’essayiste et d’éditeur. L’éclectisme dont celles-ci témoignent n’est nullement le fait d’un esprit versatile, mais tout simplement celui d’un homme épris avant tout de singularité. Il n’exclut nullement la fermeté des partis pris.
De Roland Barthes, Mauriès a hérité non seulement le goût du fragment et des biographèmes, mais aussi l’art de saisir le ton d’une époque à travers ses phénomènes en apparence les plus futiles. La lecture de Vogue et de Vanity Fair, le spectacle d’une bonimenteuse d’une chaîne de télé-achat, la floraison des boutiques de faux luxe, le service d’accueil des TGV mimant dérisoirement celui des aéroports, le décor standardisé des chambres d’hôtels, les mouvements cycliques de la mode vestimentaire — dont l’accélération constante dans la pratique du recyclage s’apparente désormais à un sur-place définitif — lui inspirent ainsi autant de « mythologies » miniatures. Constatant sans aménité le conformisme de plus en plus écrasant des modes éditoriales (le culte des gagnants triomphe là comme ailleurs), il s’en prend à l’« émotion » érigée en critère suprême d’appréciation esthétique, au minimalisme (en littérature et en art comme dans la décoration d’intérieur) devenu le cache-misère d’une pauvreté flagrante de style, de pensée et d’imagination. Face à la dématérialisation du monde en cours avec l’avènement du numérique, il propose un parallèle éclairant avec la révolution industrielle anglaise dont il montre qu’elle fut le moment d’une « première crise de l’analogique » (dans le même ordre d’idées, on lira avec intérêt ses remarques sur l’évolution de la perception des couleurs).
Une continuité souterraine se fait jour sous la disparate apparente de ces pages, qui dessinent, en creux, un autoportrait en miettes. De quoi s’agit-il au fond ? D’arracher à l’oubli, comme l’écrivait John Aubrey, des petits riens négligés, de sauver du néant des moments fugaces qui engagent l’existence, des lieux, des œuvres, des êtres aimés. Et c’est ici que la démarche de l’écrivain rejoint la passion du modeste collectionneur qu’est aussi Patrick Mauriès.
Je retiens, comme on retient une personne sur le point de partir, tous mes livres, mes tableaux, mes objets, même s’ils ne me parlent plus. Exemple parfait de cette sorte de collectionneur que distingue un psychanalyste américain, en opposition dialectique à son contretype : celui qui amasse et celui qui élimine, le premier ne parvenant pas à combler la perte, courant vers la réparation impossible, paralysé par l’idée de choix, le second tenu par un narcissisme épuisant, qui ne (se) trouve jamais assez bien.
Mais « accumuler », cela signifie-t-il « ne pas choisir » ? Non, bien sûr, il s’agit d’abord de garder, en témoignage, chacune des étapes, chacun des états du choix, pièce de l’interminable puzzle qui nous compose et se découvre progressivement devant nous, pour notre plus grand étonnement (« je ne collectionne pas, je vis avec mes objets », dit, dans un quotidien, la collectionneuse américaine Alicia Kaplan).
Passage auquel fait écho, vingt pages plus loin, une citation de Taine où Mauriès voit la raison profonde de la passion des objets :
Il y a un proverbe turc qui dit : « Quand la maison est finie, la mort entre. » C’est pour cela que les sultans ont toujours un palais en construction, qu’ils se gardent bien d’achever. La vie semble ne vouloir rien de complet — que le malheur. Rien n’est redoutable comme un souhait réalisé.
Cet interminable puzzle, ce palais en construction que l’auteur se garderait bien d’achever, c’est aussi bien ce livre. Qui n’a donc « ni début ni fin », et pour cause.
 Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.
Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.






 Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.
Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.