Le point de vue de Trollope
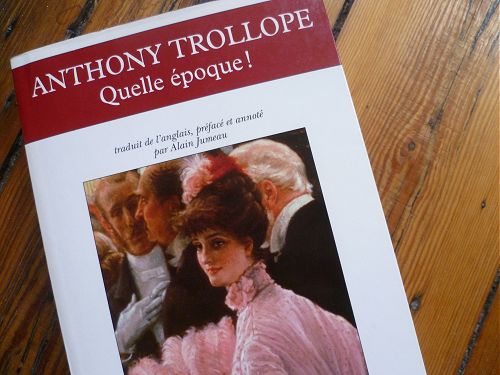
Quelle époque ! est une vaste fresque sociale située dans les mondes étroitement imbriqués de l’aristocratie, de la politique, de la finance et de la presse. Plus ambitieux mais moins bien équilibré (en termes d’architecture narrative) que les Tours de Barchester, ce gros roman multipliant intrigues et sous-intrigues est aussi bien plus sombre. La verve satirique n’en est pas absente, mais la vision du monde s’y fait beaucoup plus noire. Mario Praz y a vu à juste titre une peinture de la dégradation de la morale victorienne, conséquence de l’influence du capitalisme sur les classes dirigeantes 1.
La fresque est dominée par le personnage d’Augustus Melmotte, personnage ogresque, démesuré, tyran domestique et financier véreux, lancé dans une opération de spéculation internationale en même temps que dévoré par l’ambition politique et la soif de conquérir une place dans la bonne société. Mais Melmotte n’est que le miroir grossissant d’une société régie à tous ses étages, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, par la tricherie et l’appât du gain : du simple mensonge de convenance à la corruption pure et simple, en passant par l’imposture et la fraude. La course au mariage est elle-même un marché : quête éperdue du mari fortuné ou de la riche héritière qui épongera vos dettes de jeu, les relations sentimentales étant toujours liées, chez Trollope (comme chez sa devancière Jane Austen), à des questions de statut social et d’argent.
Grand peintre des dilemmes et des compromissions de la vie ordinaire, Trollope se révèle, comme dans les Tours de Barchester, un maître de la circulation des points de vue. Les personnages sont envisagés selon une succession d’aperçus qui en corrigent, en nuancent sans cesse l’appréhension, pour mieux mettre en relief leurs facettes contradictoires, leurs qualités et leurs faiblesses, et nous faire constamment changer d’avis à leur sujet. Trollope est très fort à ce jeu : dépeindre longuement une situation à travers la perception — et le jugement moral — d’un personnage, puis opérer en souplesse un déplacement de caméra hitchcockien 2 pour nous la faire appréhender sous l’angle de vision d’un second protagoniste, de sorte que ladite situation revêt d’un coup une autre signification, et que notre jugement se transforme.
C’est particulièrement vrai des personnages féminins, et l’on peut presque parler de pédagogie trollopienne à ce sujet — Trollope étant, parmi les romanciers victoriens, l’un des plus sensibles à l’aliénation de la condition féminine. Tout se passe comme s’il prenait son lecteur victorien par la main en lui disant en substance : « Pendant trois pages, je vous ai présenté Lady Carbury ou Georgiana Longestaffe du point de vue de la bonne société et du qu’en-dira-t-on. Vous avez réprouvé leur conduite. À présent, faites un pas de côté pour considérer la situation de leur point de vue à elles et dites-moi si elles ont vraiment le choix d’agir comme elles le font ? »
Trollope est un mélange intrigant de traditionalisme et de progressisme, et c’est ce qui fait son sel. Lui-même se définissait comme un « libéral-conservateur avancé », formule dont l’apparent paradoxe situe en réalité exactement sa position de romancier. C’est un « homme de son temps et de sa classe » (Sylvère Monod), qui croit en l’idéal du gentleman (cet idéal, dans Quelle époque !, s’incarne dans le personnage de Roger Carbury, hobereau érigé en contre-exemple vertueux d’un aréopage d’aristocrates débiles dépeints sans aménité, et que ses proches estiment tout en le trouvant ennuyeux comme un vieux chausson). Mais c’est aussi, parmi les romanciers de son temps, l’un des plus exempts de préjugés. Outre son point de vue qu’on pourrait qualifier de préféministe, Quelle époque ! épingle notamment l’antisémitisme ordinaire de la haute société — le cas est unique, à ma connaissance, dans la fiction victorienne. L’un des rares personnages entièrement sympathiques du roman est Ezekiel Breghert, le placide banquier juif que Georgiana Longestaffe envisage un temps d’épouser, en désespoir de cause et en se pinçant le nez, pour ne pas demeurer vieille fille : homme probe, intègre et net, franc et sans détour, naturellement mal vu, parce que juif, et parce qu’il ignore les codes sociaux en usage — doublement shocking.
1. The Hero in Eclipse in Victorian Fiction. Oxford University Press, 1956.
2. Je pense par exemple à cette scène des Oiseaux où Hitchcock opère un transfert d’un point de vue général objectif au point de vue subjectif de Melanie, au moment où celle-ci comprend (et nous en même temps qu’elle) que la mère de Mitch est en train de perdre la boule. Séquence parfaitement analysée par le cinéaste dans Hitchcock-Truffaut, p. 247-248.
 Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).
Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).
Traduction, préface et notes d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.
Abordons l’héritière
Même si [Lord Niddersdale] n’était pas très enclin à réfléchir sérieusement, il avait l’impression qu’il était nécessaire, en l’occurrence, de réfléchir. Le patrimoine de son père n’était pas considérable. Son père et son grand-père étaient dépensiers tous les deux, et lui-même avait contribué aux difficultés financières de la famille. Il était convenu, depuis ses débuts dans la vie, qu’il devait épouser une héritière. Dans des familles comme la sienne, il est généralement convenu, quand on en est arrivé à de tels résultats, que la situation sera rétablie grâce à une héritière. C’est devenu une institution, comme la primogéniture, et c’est presque aussi utile pour préserver convenablement l’ordre des choses. La noblesse gaspille l’argent ; le commerce le gagne — et alors le commerce achète la noblesse, en lui permettant de redorer son blason. Cet accommodement, dans la mesure où il touche l’aristocratie en général, est tout à fait convenu, et le vieux marquis l’approuvait pleinement — si bien qu’il se sentait justifié, lorsqu’il dilapidait le patrimoine, en pensant que le futur mariage de son fils viendrait le restaurer, naturellement. Nidderdale, lui-même, n’avait jamais exprimé d’opinion contraire, n’avait jamais conçu de théorie fantaisiste opposée à cette façon de voir, et n’avait jamais inquiété son père par une liaison visant à épouser une beauté sans dot ; mais il avait réclamé le droit de « prendre du bon temps », avant de se consacrer au rétablissement du patrimoine familial. Son père avait eu le sentiment que ce serait une erreur, et peut-être même une idée insensée, de s’opposer à un désir aussi naturel. Il avait considéré tous les détails du « bon temps » d’un œil indulgent. Mais un petit différend avait surgi, quant à la durée du bon temps, et le père s’était finalement vu obligé d’informer son fils que, si le bon temps se prolongeait encore, cela occasionnerait une guerre d’extermination réciproque entre lui et son héritier. Niddersdale, qui avait à la fois du bon sens et un bon caractère, vit la chose tout à fait comme il convenait. Il assura son père qu’il n’avait nullement l’intention de se fâcher, il déclara qu’il était prêt pour aborder l’héritière, dès que l’héritière serait placée sur son chemin, et il entreprit honnêtement la tâche qui lui était imposée.
Anthony Trollope, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).
Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.
Ce qu’ils lisent
18 mars
Dans le Thalys Liège-Paris

— Ma voisine (photo ci-dessus) lit un thriller de Terry Hayes, Je suis Pilgrim. Quelques places plus loin (photo ci-dessous), une phrase de Paris, ein Fest fürs Leben d’Ernest Hemingway fait rire une jeune Allemande. Plus loin encore, seul de sa petite bande à ne pas tripoter un appareil électronique, un garçon de douze ou treize ans lit Die Tribute von Panem de Suzanne Collins.
Il y a trois autres lecteurs (deux femmes et un homme) dans le wagon.

Du 18 au 23 mars
Sur la ligne 12 du métro parisien

— Ci-dessus, sur le quai de la station de Notre-Dame-des-Champs, une lectrice de Mangeclous d’Albert Cohen, qu’on a identifié de loin grâce à la couverture de l’édition Folio.
— Debout dans le wagon bondé, une dame lit A Question of Belief de Donna Leon qu’elle tient d’une main, la seconde étant encombrée d’un grand sac.
— Ci-dessous, une lectrice de Fantôme de Jo Nesbo.

— Une petite dame fort bien mise, cheveux gris coupés courts, manteau noir sur un ensemble de même couleur, bague et boucles d’oreilles élégantes et discrètes, est plongée dans l’Autre Moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Nous arrivons porte de Versailles. Les fines lunettes disparaissent dans un étui métallisé, le livre et l’étui dans un petit sac à main noir.

— Ci-dessus, une lectrice de Beautiful Sex Bomb de Christine Lauren.
— Un quinquagénaire coiffé d’un chapeau lit Un Corbusier de François Chaslin publié dans la collection Fiction et Cie.

— Ci-dessus, ils lisent respectivement un thriller de John Grisham et les Nouvelles Histoires extraordinaires de Poe. Dans trois stations, ils seront rejoints par une lectrice de Harlan Coben sanglée dans un manteau gris souris.
22 mars
Dans l’autobus 96
— Mon voisin lit un essai allemand où il est question de Claude et de Néron, dont il surligne des passages au marqueur jaune. Ce que lit la jeune femme assise de l’autre côté de l’allée centrale, nous ne le saurons jamais. Elle descend à Oberkampf en emportant son secret.
24 mars
Dans le Thalys Paris-Liège
— Sur la tablette d’une vieille dame endormie, Die Liebe in den Zeiten der Cholera de Gabriel García Márquez.
— Un autre lecteur est plongé dans un gros roman. L’héroïne s’en prénomme Denise, je ne peux rien dire de plus.
Chambres

Forest, chaussée de Bruxelles

Bruxelles, rue Émile-Bouilliot
Ce qu’ils lisent
Dans l’Eurostar Bruxelles-Londres
— Nombreux lecteurs néerlandais de guides touristiques sur Londres (Londen) et la Grande-Bretagne (Groot Britannië). Ma voisine lit un roman d’Agatha Christie, De zaak Styles, qui est sûrement la Mystérieuse Affaire de Styles.
— Une jeune fille blonde dort à poings fermés, d’énormes écouteurs roses sur les oreilles. Sur sa tablette, City of Bones de Stephanie Meyer.
— On se demande pourquoi ce cadre trentenaire en complet anthracite retape frénétiquement sur son ordinateur portable de larges extraits de How Good Can We Be.
Londres
— Au Prêt à manger d’Euston Road, ma voisine lit Love in the Time of Victoria de Françoise Barret-Ducrocq, édition Penguin, dans un exemplaire de bibliothèque (curieusement estampillé YUL sur la tranche, qui est le sigle de l’aéroport de Montréal). Plutôt nerveuse, elle saute continuellement de son téléphone vert pomme à son livre. Je lui fais remarquer l’amusant chiasme que nous formons : moi lisant un roman anglais en traduction française (je lui désigne mon exemplaire d’Orgueil et préjugés), elle un essai français en traduction anglaise. Justement, me dit-elle, la traduction de son livre n’est manifestement pas très bonne. Et puis, l’auteur l’énerve : elle cite insuffisamment ses sources. Le tout débité à un rythme de mitraillette comme une héroïne de Capra, avec un fort accent américain.
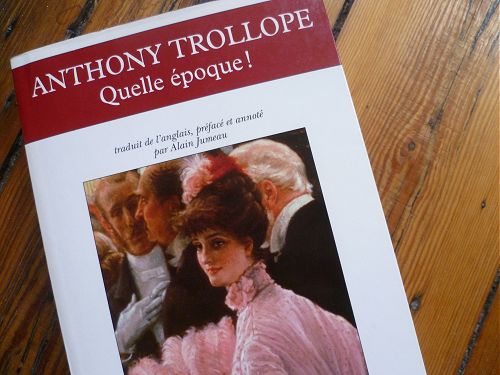
 Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).
Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).














