La mémoire vagabonde
Marcel Ophuls, Mémoires d’un fils à papa. Calmann-Lévy, 2014. Ouvrage pourvu d’un index.
À Munich, la crise fut déclarée entre les producteurs et mon père. À la suite des retards successifs, les producteurs avaient envoyé des lettres recommandées à Max Ophuls, qui les faisait encadrer derrière du verre et en tapissait sa loge.
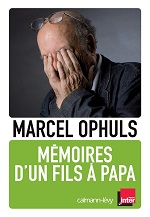 Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.
Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.
Max Ophuls, son génie, ses extravagances, sa distraction phénoménale, ses coups de colère, ses méthodes de tournage, sa carrière volante entre l’Allemagne, l’Italie, Hollywood et la France, occupe de nombreuses pages de ces mémoires ; pages admiratives mais non hagiographiques. Au total, il semble que Marcel ait assez bien surmonté l’écueil écrasant d’être le fils d’un artiste exceptionnel lorsqu’on ambitionne d’exercer la même profession que lui.
Il connut un début de carrière classique pour un cinéaste français de sa génération, contemporaine de la Nouvelle Vague : quelques années d’assistanat, puis un sketch du film l’Amour à vingt ans grâce au coup de pouce de François Truffaut (qui restera, sa vie durant, un soutien fidèle) ; puis un premier long métrage, Peau de banane, polar à l’américaine adapté de Charles Williams, avec Belmondo et Jeanne Moreau, qui fut un succès commercial. Qui sait ce qu’aurait été la suite de sa carrière s’il avait écouté le conseil de Serge Silberman et n’avait pas accepté de réaliser un mauvais film d’Eddie Constantine en Espagne ? Le bide de ce navet (le mot est d’Ophuls) coula instantanément sa réputation de jeune cinéaste prometteur, comme l’avait prédit Silberman. Et c’est ainsi qu’Ophuls, pour assurer sa subsistance, intégra l’équipe de Zoom (antenne rédactionnelle qui maintenait par la ruse une relative indépendance éditoriale au sein de l’ORTF) et qu’il devint l’un des plus grands cinéastes documentaires du XXe siècle. La suite, ce fut, à l’instar de son père, une carrière itinérante entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les États-Unis, au gré des commandes et des engagements à la télévision, dans la presse ou dans l’enseignement. Ce parcours, qui est aussi une traversée d’un demi-siècle d’histoire (la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, la Libération, Mai 68, la guerre du Vietnam, la chute du Mur de Berlin, les guerres de Yougoslavie), nous vaut des aperçus concrets sur les milieux du journalisme, du cinéma, de la télé et de l’université, les querelles avec les producteurs, les conflits avec la censure ; des croquis au vol, élogieux ou poivrés, de Pierre Mendès France, Simone Veil, François Mitterrand, Bertolt Brecht, Louis Jouvet, James Mason, John Huston, Preston Sturges, Marlene Dietrich et bien d’autres. Au passage, Ophuls dit quelques mots éclairants de sa conception du documentaire et de ses méthodes de travail, cousines de celles de Frederick Wiseman qu’il admirait beaucoup : une subjectivité assumée ; pas de pré-scénarisation, jamais, car l’art du documentaire consiste à « essayer de rencontrer la réalité en tournant ».
Chambres

Bruxelles, Nhow Hotel
Coquilles
Naples, lundi 7 mars [1932]
[…] De là à Monteoliveto et à la poste où j’ai trouvé le jeu complet des 1res épreuves de Technique en deux paquets. Je les ai lues une première fois : coquilles prodigieuses, — bas pour bons, Eratratique (?) pour Stratégie et 200 choses de ce calibre-là. Et puis j’ai vu que M. E. Boudot-Lamotte n’a pas toujours tenu compte de, ou compris, ou retenu, mes recommandations : je vois des chapitres que j’avais rejetés, et je n’en vois pas d’autres que j’avais pourtant inscrits sur la liste qui lui a servi à rassembler tous les chapitres épars dans les revues. Il faudra que je remette ordre à cela. Mais je suis certain que ce livre-là sera aussi plein de coquilles que les autres imprimés à la NRF ; je me demande pourquoi ? Stols et Alberts m’ont beaucoup mieux imprimé, et Levi, et F. Paillart à présent, ne m’ont pas saboté ce que j’ai donné à Commerce. Le plus étonnant est que plusieurs des choses ainsi sabotées par les typos de Gaston Gallimard ont été imprimées d’après les impressions de Levi. Cela m’a fait relire avec plaisir ma « Lettre aux imprimeurs » que j’ai fait placer à la fin de Technique ; il n’y a pas un mot à y changer, et je n’en regrette pas un mot, et elle me venge par avance de toutes les fautes commises par ces Messieurs dans ces épreuves. Penser qu’ils ont imprimé « quatreS » d’après un texte imprimé ! […] En somme il faut nous résigner à être aussi mal imprimés que les auteurs antérieurs à l’imprimerie étaient copiés.
Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.
Sur Larbaud et les coquilles, voir aussi « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».
Tuer le cochon
« Tuer le cochon » […] J’y vois encore un exemple et un précepte applicable au métier d’écrivain : éviter la grandiloquence, maintenir l’expression en deçà de l’émotion ressentie et qu’il s’agit de communiquer. En marge d’un brouillon, « tuer le cochon » signifiera : « À récrire en baissant le ton. »
Valery Larbaud, « Tuer le cochon »,
section « l’Art et le métier »
de Sous l’invocation de saint Jérôme, Gallimard, 1946.
*
Naples, dimanche 28 février [1932].
Beaucoup travaillé en pensée, ces jours-ci, à l’Amour et la monarchie ; idées et paroles viennent avec une abondance extraordinaire ; il faudra filtrer beaucoup, et tuer le cochon plus d’une fois, – tuer beaucoup de cochons !
Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.
Lectures expresses
Pierre Belfond, Scènes de la vie d’un éditeur. Fayard 2006.
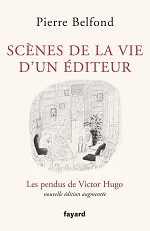 Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.
Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.
En vingt-cinq ans d’activité, Pierre et Cora Belfond ont édifié un catalogue aussi varié qu’équilibré, où l’édition de bestsellers américains dont ils furent les pionniers en France avec Robert Laffont (The Love Machine, Les oiseaux se cachent pour mourir) permettait de maintenir la maison à flot en finançant les secteurs peu ou non rentables qui leur tenaient à cœur : la poésie et le roman français, la littérature étrangère, les livres sur la musique et sur l’art, deux de leurs grandes passions. L’entrée en Bourse de la maison, dans les années 1980, lui apporta sur le moment le ballon d’oxygène dont elle avait besoin, mais signa à terme la fin de son indépendance et son absorption par les éditions Masson. Une page de l’histoire de l’édition se tournait, avec l’entrée en scène des gestionnaires.
Si tous les chapitres de ce gros volume ne sont pas d’un égal intérêt, l’ensemble se recommande par sa franchise et son allant. Doté d’un sens du portrait et d’un bon talent de conteur, Belfond raconte avec un enthousiasme égal ses réussites et ses échecs, les paris improbables remportés contre toute attente, les occasions manquées, les coups durs et les rétablissements acrobatiques. La conclusion qu’on en tire – comme à la lecture de tant d’autres mémoires d’éditeurs – est que le commerce des livres est le plus imprévisible qui soit.
L’image absente
L’art du cinéma consiste parfois à susciter des images d’autant plus fortes qu’elles ne figurent pas dans le film mais se trouvent nulle part ailleurs que dans la tête du spectateur. C’est le ressort bien connu de la Lubitsch’s touch. La caméra s’arrête au seuil d’une porte close, à nous d’imaginer ce qui se passe derrière : le gag est d’autant plus drôle qu’il n’est pas montré.
La parole et, de manière indissociable, la mise en scène de cette parole, son incarnation dans une voix, un corps d’acteur ont le pouvoir de générer ces images absentes.
Soit le monologue génial de Faisons un rêve…, tout d’attente impatiente et de désir fébrile. Un œil sur la pendulette de son bureau, Sacha Guitry imagine à voix haute et en temps réel le trajet dans Paris de sa future amante Jacqueline Delubac pour arriver jusqu’à lui. Elle quitte son appartement de l’avenue de l’Alma, hèle un taxi. La voiture traverse les Champs-Élysées, emprunte la rue Washington qui n’en finit pas, passe devant la grande horloge, tourne dans le boulevard Haussmann – « va, prends-le, mon amour, je te le donne, le boulevard Haussmann ! » –, contourne la statue de Shakespeare, s’engage dans l’avenue de Messine, rétrocède en seconde, se trompe d’adresse, avance encore un peu, dépose enfin sa passagère. Celle-ci traverse l’avenue en regardant craintivement à droite et à gauche (« mais non, à cette heure-ci, qui veux-tu qui te regarde ? »), franchit la porte cochère. Elle gravit l’escalier, elle va sonner, elle va sonner… Pourquoi ne sonne-t-elle pas ?
Filmage en plans longs qui renforcent l’impression de temps réel ; génie verbal de Guitry, comme enivré de sa propre parole, timbre hypnotisant de sa voix, science de la diction et du phrasé, des pauses et des reprises ; mais aussi économie parfaite de la gestuelle et des déplacements : gestes des bras, des mains mimant le trajet, mobilité du regard dirigé hors-champ vers un écran imaginaire où Guitry projette en pensée sa vision, en dirigeant comme à distance l’action des personnages *… La puissance hallucinatoire de ce monologue est telle qu’on peut aisément se convaincre d’avoir bel et bien vu le taxi avalant la rue Washington, la statue de Shakespeare dressée boulevard Haussmann.

« Elle descend l’escalier… »

« Elle passe devant l’horloge de précision
qui retarde d’une heure trente-cinq depuis un an et demi… »

« Elle tourne autour de la statue de Shakespeare… »
Autre monologue. Dans Rebecca, Laurence Olivier dévoile enfin à Joan Fontaine la vraie nature de Rebecca et les circonstances véritables de sa mort. Un cinéaste moyen aurait été tenté d’illustrer ce récit par des images en flash-back avec, en voix off, la confession d’Olivier. Rien de tel chez Hitchcock, qui s’emploie au contraire à susciter la présence d’une absente. Cette évocation s’accomplit dans un admirable mouvement de caméra, d’abord légèrement ascendant, puis panoramique de la droite vers la gauche (soit du présent vers le passé), qui révèle progressivement le décor de la pièce – décor vide de présence humaine mais hanté par le fantôme de Rebecca – pour aboutir aux pieds d’Olivier, où se trouve le corps (absent) de la morte **.

Le cendrier n’a pas été vidé depuis la mort de Rebecca. Nous voici transporté dans le passé :
elle vient d’éteindre sa dernière cigarette, se lève…



Le trajet en taxi de Jacqueline Delubac ; les derniers instants de la vie de Rebecca : ces images non montrées n’en font pas moins partie intégrante du film et s’incorporent au souvenir qu’on en conserve. Revoyant un film des années plus tard, on est parfois surpris de n’y pas trouver des images qu’on était pourtant convaincu d’y avoir vues.
* Comme le remarque très justement Philippe Arnaud, pour l’amant de Faisons un rêve…, le désir est inséparable de sa mise en scène. Cf. le collectif Sacha Guitry, cinéaste, Festival international du film de Locarno/Yellow Now, 1993, p. 175.
** À relever aussi dans cette scène, le rôle important de la musique de Franz Waxman, qui concourt à l’égal de la mise en scène hitchcockienne à faire naître la vision d’images absentes.
Lectures expresses
Hampton Charles [Roy Peter Martin], Miss Seeton au service de Sa Majesté (Miss Seeton, by Apointment, 1990). Traduit de l’anglais par Katia Holmes. 10/18, « Grands Détectives », 1999.
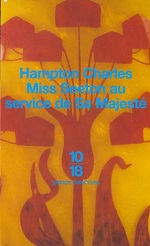 Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Professeur de dessin à la retraite, Emily D. Seeton est une excentrique de province que son entourage prend pour une aimable toquée. La police lui alloue une petite rémunération mais sa collaboration à Scotland Yard est tout involontaire. D’une part, elle a la manie de griffonner sans y penser des croquis sur des feuilles volantes. Or, ces dessins transposent de façon sibylline des personnes ou des situations qu’elle a observées sans y prêter d’attention particulière. Correctement interprétés, ils aident l’inspecteur Delphick à résoudre les affaires criminelles dont il a la charge. D’autre part, Miss Seeton, équipée d’un parapluie redoutable, a le don de se placer dans des situations impossibles et de dénouer malgré elle les intrigues par son comportement erratique, motivé à son sens par un strict respect des convenances mais aberrant aux yeux d’autrui. Sa candeur désarmante fait qu’elle ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d’elle.
Miss Seeton au service de Sa Majesté se déroule à l’époque du swinging London (avec, au passage, une allusion à l’affaire des Cinq de Cambridge). Une vendeuse de grand magasin remporte un concours de mannequinat organisé par un magazine de mode. Elle aura l’honneur d’être photographiée par Cédric Benbow (photographe de la gentry inspiré de Cecil Beaton) dans le cadre prestigieux d’un manoir de province, vêtue des plus beaux atours et parée de bijoux hors de prix prêtés par des collectionneurs. Pour arrondir ses fins de mois, notre vendeuse avait posé pour des photos osées. Un cambrioleur la fait chanter pour en faire sa complice afin de dérober les précieux bijoux. L’intrigue entrecroise habilement les parcours de nombreux personnages, reliés à leur insu les uns aux autres. Le tout, appuyé sur l’observation amusée des mœurs anglaises, baigne dans une ambiance joyeusement loufoque. Une parfaite lecture estivale.
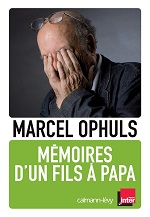 Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.
Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.






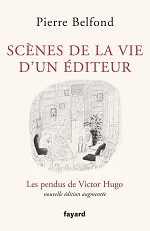 Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.
Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.






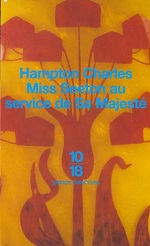 Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.