
Bruxelles, hôtel Marivaux

Sauf ignorance de ma part, J’étais une aventurière (1938) est rarement cité parmi les perles du cinéma français des années 1930. Aussi espère-t-on faire œuvre utile en le clamant bien fort : ce film est tout à fait délicieux. Il s’agit d’une comédie d’escroquerie internationale typique de la période (le chef-d’œuvre du genre étant bien entendu Trouble in Paradise) et où, pour une fois, les Français se montrent à la hauteur de leur modèle hollywoodien. D’un hôtel de luxe à l’autre entre Vienne, Londres et Cannes, un trio de filous – le cerveau au sang froid, le pickpocket et l’enjôleuse – s’y emploie à détrousser des pigeons fortunés au moyen de combines bien rodées. Raymond Bernard, fils de Tristan, est surtout réputé pour des productions ambitieuses telles que les Misérables et les Croix de bois. Peut-être considéra-t-il J’étais une aventurière comme une œuvrette de commande. Mais le moins qu’on puisse dire est qu’il ne la traita pas par-dessus la jambe. Au contraire : il y montre des qualités épatantes de vitesse, de fluidité, d’élégance et de brio dans une intrigue où abondent comme il se doit les faux-semblants et les coups fourrés. Le scénario de Jacques Companeez, le dialogue de Michel Duran, l’interprétation : tout pétille. Les retournements surprises qui sont la loi du genre n’ont rien de forcé et découlent naturellement des caractères des personnages. L’écueil du dernier tiers – souvent plus faible dans ce type de comédie, plus facile à mettre en place qu’à dénouer – est surmonté par d’habiles relances. Edwige Feuillère, que notre mémoire associe à des compositions guindées plus tardives, fait preuve d’une merveilleuse vivacité dans un rôle à transformation. Plus rare encore, le premier rôle masculin, Jean Murat, ne s’est pas démodé, contrairement à tant de bellâtres de l’époque, de sorte qu’on admet sans suspension of disbelief que l’aventurière des palaces soit sensible à son charme curieux. Dans le rôle des complices de la demoiselle, on a eu plaisir à découvrir le parfait Jean Max et à retrouver l’ineffable Jean Tissier.
Jacques Lourcelles signale que Raymond Bernard tourna lui-même un remake de son film en 1956, toujours avec Feuillère dans le rôle principal, intitulé le Septième Commandement. « L’absence de fantaisie et d’élégance, écrit-il, le caractère laborieux et souvent sinistre du film soulignent l’abîme qui sépare le cinéma français des années 1930 de celui des années 1950. » On le croit sur parole.
La copie de J’étais une aventurière parue dans la collection rouge à bon marché de la Gaumont n’a pas été restaurée, comme l’indique l’éditeur avec probité. Elle est fatiguée mais néanmoins regardable.
Pierre Nora, Une étrange obstination. Gallimard, 2022.
 Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés.
Ce volume de mémoires professionnels fait suite à Une jeunesse. La carrière de Pierre Nora s’est partagée entre trois pôles : l’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la direction du secteur des sciences humaines chez Gallimard, la corédaction en chef de la revue le Débat. Avec le recul, estime l’auteur, avoir refusé de choisir entre ces activités – alors que chacun de ces « camps » cherchait à se l’accaparer entièrement – pour préférer une position de « marginal central » fut une chance et un facteur d’enrichissement : l’enseignement, la recherche et la pratique éditoriale se sont nourris mutuellement. On lit ce livre partagé entre l’intérêt et l’agacement. L’égo de l’auteur n’est pas piqué des hannetons. L’hommage à ces travailleurs de l’ombre que sont les réviseurs et les traducteurs, pour être sûrement sincère, n’en est pas moins empreint de condescendance. L’ouvrage peine à trouver son unité. Il oscille entre les anecdotes de coulisses, le portrait de quelques grandes figures (les plus notables étant ceux de Michel Foucault, Marcel Gauchet et Kzrysztof Pomian) et des pages plus intéressantes où la réflexion l’emporte sur le récit. Elles concernent notamment le bref « âge d’or » de l’édition de sciences humaines au tournant des années 1970, l’interrelation complexe et changeante entre les notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine, les implications à la fois intellectuelles et pratiques de la mise en œuvre d’un grand chantier éditorial tel que celui des Lieux de mémoire. Au passage on mesurera, si l’on en doutait encore, combien le monde intellectuel, loin d’être une tour d’ivoire animée par la construction et la circulation désintéressées du savoir, est un champ de bataille agité par des querelles de chapelles et d’égos, des jalousies personnelles, pour ne pas dire des haines recuites, le tout dans un périmètre parisien de quelques centaines de mètres carrés.
En 2011, Pierre Nora avait réuni sous le titre d’Historien public un copieux choix d’articles assortis de chapeaux qui les replaçaient dans leur contexte et en nuançaient ou en corrigeaient, le cas échéant, certaines affirmations. L’ensemble composait une autobiographie intellectuelle où l’historien, beaucoup mieux à mon sens que dans Une étrange obstination, se faisait historien de lui-même. C’est ce volume qu’on suggère en priorité à qui voudrait se faire une idée de son parcours.
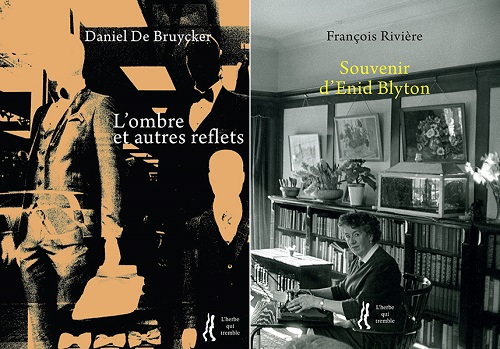
C’est aujourd’hui que paraissent deux livres dont j’ai eu l’immense plaisir de piloter l’édition à L’herbe qui tremble.
Daniel De Bruycker, natif de Bruxelles, prix Rossel (le Goncourt belge) pour son roman Silex (Actes Sud), avait ces dernières années délaissé la fiction au profit de la poésie (à l’exception de la publication d’une novella). L’Ombre et autres reflets marque son grand retour sur les terres de l’imaginaire. Ombres et reflets trompeurs, identités instables, œuvres apocryphes, livres truqués, villes invisibles, charmes vénéneux d’un Orient imaginaire : un bouquet de nouvelles fantastiques célébrant le pouvoir égarant de l’imagination.
Parmi les ouvrages qu’a consacrés François Rivière à des figures d’outre-Manche (J. M. Barrie, Agatha Christie, Alfred Hitchcock, G. K. Chesterton), Souvenir d’Enid Blyton est sans conteste l’un des plus personnels. Loin d’une monographie conventionnelle, il s’agit d’un exercice d’admiration entremêlant enquête sur la célèbre romancière du Club des Cinq – sa vie publique et privée, son univers, ses étonnantes méthodes d’écriture expliquant une fécondité hors du commun –, remembrances de l’auteur sur ses premières lectures d’enfance (qui furent à la source de sa propre vocation d’écrivain), réflexion sur la littérature enfantine et même des échappées dans la fiction, sous la forme d’une visite imaginaire à Enid Blyton dans sa propriété de Green Hedges. Paru chez Albin Michel en 1982, le livre est proposé ici dans une édition revue, augmentée d’une postface inédite.
Ces livres sont commandables dans toute bonne librairie ou directement sur le site de la maison d’édition, ici (De Bruycker) et là (Rivière).
Jay McInerney, les Jours enfuis (Bright, Precious Days, 2016). Traduction de Marc Amfreville. L’Olivier, 2017.
 Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama.
Ce roman est le dernier volet d’une trilogie mettant en scène et regardant vieillir sur trois décennies le même couple new-yorkais et son entourage (je n’ai pas lu les deux premiers, Trente Ans et des poussières et la Belle Vie). Russell Calloway dirige une petite maison d’édition littéraire. Son épouse Corrine a quitté un emploi dans la banque pour se dédier à l’aide alimentaire ; c’est aussi une scénariste de talent. Leur couple, apparemment solide comme le roc, constitue un point de repère pour leur entourage jonché de divorces. Leur milieu est celui de la moyenne bourgeoisie intellectuelle « éclairée », qui n’est certes pas à plaindre mais subit néanmoins à son tour la gentrification effrénée de New York. La narration enchaîne tableaux domestiques, dîners en ville et repas de famille tournant régulièrement au désastre, mondanités, vernissages et lancements copieusement arrosés et cocaïnés, vacances dans les Hampton, parties de pêche à la mouche, soirées dans les restaurants à la mode pratiquant la cuisine moléculaire et l’addition stratosphérique (l’obsession alimentaire est l’un des motifs seconds du livre). Thèmes : crise de la cinquantaine, amours adultères, foire aux vanités, bonne-mauvaise conscience d’une classe heureuse tout de même de jouir de ses privilèges, « débris du passé » qui n’en finissent pas de hanter le présent. En navette, la vie d’une maison d’édition indépendante : les agents requins, les jeunes auteurs ingrats, l’attente anxieuse des premières critiques qui décideront du succès ou de l’échec commercial d’un livre, le scandale lié à la publication d’un témoignage bidon, les fins de mois acrobatiques. À l’arrière-plan : les primaires démocrates, la crise des subprimes, le scandale Lehman Brothers et l’élection d’Obama.
De temps à autre, on se dit qu’il faut bien lire un gros roman mainstream américain, et pour finir cela ressemble exactement à l’idée qu’on peut s’en faire sans l’avoir ouvert. Jay McInerney a sans conteste un talent de narrateur et d’observateur. Ce talent n’est pas donné à tout le monde, si l’on considère le nombre de romans qui vous tombent des yeux au bout de trois paragraphes quand on les feuillette en librairie. Néanmoins, son livre permet de mesurer le fossé qui sépare le storytelling de la littérature. L’un des symptômes en est un effet d’aplatissement qui réduit au même niveau tous les éléments de la narration, qu’ils soient signifiants ou adventices. Lire un roman de ce genre, même non dénué de mérites, fait l’effet de visionner une série télé sans la cinégénie, la lumière, les décors, les comédiens qui lui apporteraient le supplément de leur incarnation.



Tokyo, 1953. Reikichi vit chez son frère Hiroshi. Ancien de la marine marqué par la guerre et par un amour perdu, caractère ombrageux et taciturne, Reikichi vivote de traductions mal rémunérées avant de se faire écrivain public. Hiroshi, son cadet, jeune homme entreprenant, vit de l’achat et de la revente de livres d’occasion et finit par ouvrir une échoppe de bouquiniste à l’entrée d’un boui-boui. Son astuce : acheter des magazines de mode fraîchement parus au magasin de l’armée américaine et les revendre à prix d’or comme des produits d’importation.
On ajoutera donc Lettre d’amour de Kinoyu Tanaka (1953) au corpus des films évoquant le monde du livre et ses marges, quoique cet aspect ne soit qu’un élément d’arrière-plan sociologique et nullement le sujet de ce beau film mêlant mélodrame et chronique du Japon de l’après-guerre, riche en observations sur la vie quotidienne, l’animation des rues, la mésadapation des anciens combattants, la débrouille des petites gens et les barrières de classes.
Pere Gimferrer, Interlude bleu (Interludio azul, 2006). Traduit de l’espagnol par Christophe David. Le Promeneur, 2009.
 Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :
Un homme et une femme se sont aimés en 1969 ; puis se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de son côté. Un hasard les fait se retrouver trente-cinq ans plus tard. Non, ce ne sera ni un second coup de foudre ni un remake de la Femme d’à côté, quoique la tension passionnelle demeure latente entre ces deux êtres que caractérise une grande lucidité. Le narrateur est écrivain. Son récit est saturé de références littéraires et cinématographiques (de Douglas Sirk à Jacques Tourneur en passant par Mitchell Leisen et Alain Resnais). Non par pédantisme mais parce qu’il est de ces êtres chez qui la fréquentation des œuvres se confond avec le tissu intime de l’existence, de sorte qu’à tout moment s’impose à sa mémoire le souvenir d’un vers, d’une ambiance de film faisant écho à sa vie présente. Au début, on est plutôt envoûté par ce monologue procédant par longues phrases sinueuses épousant les circonvolutions de la pensée du narrateur. Et puis, on finit par se demander où l’auteur veut en venir. Mais çà et là surgissent de beaux poèmes en prose :
Les rues nous emmènent à la rencontre de nous-mêmes, comme si la nuit barcelonaise était la nuit antillaise de tabac et de tambours de Vaudou de Jacques Tourneur, comme si le plein jour barcelonais était cette aube « claire et belle », avec le silence aujourd’hui inconcevable de l’aubade médiévale, dans laquelle Tirant sort à la recherche peut-être de Camesina, parce que notre histoire est aussi un roman de chevalerie, et nous marchons, hypnotisés par nous-mêmes – par ce que nous sommes, et par nos mots, dits comme s’ils étaient des talismans –, sans pesanteur à travers les trottoirs, transportés, hallucinés et pourtant, en même temps, horriblement lucides : c’est C., c’est moi, c’est nous deux, côte à côte, main dans la main, enveloppés dans la coquille noire de la nuit, dans la lumière fausse des néons, dans le masque de cire ou le grand masque de liège de la tombée du jour. Il commence à faire sombre : en même temps en 1969 et aujourd’hui.
Benoît Duteurtre, Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années folles. Plon, 2022.
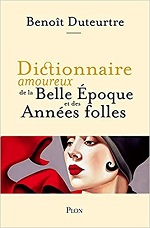 Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale.
Généralement peu client de la formule des dictionnaires amoureux, j’ai été séduit par le livre que consacre Benoît Duteurtre aux années 1890-1930. À cela, plusieurs raisons. La plume fluide de l’auteur confère à la lecture autant d’intérêt que d’agrément. Sa maîtrise du sujet ne fait aucun doute, en particulier sa culture musicale qui embrasse le spectre entier du genre, depuis la musique savante jusqu’au café concert. Richard Strauss, Duke Ellington et Dranem sont traités avec une égale compétence – et une égale sympathie. L’indifférence aux frontières entre les arts, à la hiérarchie scolaire des genres, l’attention aux croisements esthétiques et sociaux auxquels l’époque fut propice suggèrent de même des rapprochements qui l’éclairent tout entière : « Le plaisir du jeu, le sens de l’ironie qui inspirent Apollinaire ou Ravel, Maurice Leblanc les a appliqués au roman policier. » On pourra regretter le point de vue franco-centré et s’étonner de quelques absences mais l’approche subjective est la loi du genre ; et si l’auteur emploie fréquemment la première personne pour exprimer une préférence ou évoquer les circonstances d’une découverte, on lui sait gré de ne pas se faire valoir aux dépens de son sujet. Enfin, une idée anime le livre, un point de vue unifie le désordre obligé des notices. On a coutume d’opposer terme à terme la Belle Époque et les Années folles, le foisonnement végétal du modern style et la ligne claire de l’Art déco. Benoît Duteurtre s’emploie au contraire à mettre en valeur la continuité qui unit ces deux époques, de part et d’autre de la grande saignée de la Première Guerre mondiale.