
Foire du livre de Francfort
Marcel Ophuls, Mémoires d’un fils à papa. Calmann-Lévy, 2014. Ouvrage pourvu d’un index.
À Munich, la crise fut déclarée entre les producteurs et mon père. À la suite des retards successifs, les producteurs avaient envoyé des lettres recommandées à Max Ophuls, qui les faisait encadrer derrière du verre et en tapissait sa loge.
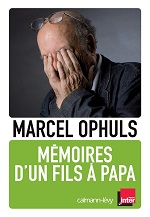 Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.
Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.
Max Ophuls, son génie, ses extravagances, sa distraction phénoménale, ses coups de colère, ses méthodes de tournage, sa carrière volante entre l’Allemagne, l’Italie, Hollywood et la France, occupe de nombreuses pages de ces mémoires ; pages admiratives mais non hagiographiques. Au total, il semble que Marcel ait assez bien surmonté l’écueil écrasant d’être le fils d’un artiste exceptionnel lorsqu’on ambitionne d’exercer la même profession que lui.
Il connut un début de carrière classique pour un cinéaste français de sa génération, contemporaine de la Nouvelle Vague : quelques années d’assistanat, puis un sketch du film l’Amour à vingt ans grâce au coup de pouce de François Truffaut (qui restera, sa vie durant, un soutien fidèle) ; puis un premier long métrage, Peau de banane, polar à l’américaine adapté de Charles Williams, avec Belmondo et Jeanne Moreau, qui fut un succès commercial. Qui sait ce qu’aurait été la suite de sa carrière s’il avait écouté le conseil de Serge Silberman et n’avait pas accepté de réaliser un mauvais film d’Eddie Constantine en Espagne ? Le bide de ce navet (le mot est d’Ophuls) coula instantanément sa réputation de jeune cinéaste prometteur, comme l’avait prédit Silberman. Et c’est ainsi qu’Ophuls, pour assurer sa subsistance, intégra l’équipe de Zoom (antenne rédactionnelle qui maintenait par la ruse une relative indépendance éditoriale au sein de l’ORTF) et qu’il devint l’un des plus grands cinéastes documentaires du XXe siècle. La suite, ce fut, à l’instar de son père, une carrière itinérante entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les États-Unis, au gré des commandes et des engagements à la télévision, dans la presse ou dans l’enseignement. Ce parcours, qui est aussi une traversée d’un demi-siècle d’histoire (la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, la Libération, Mai 68, la guerre du Vietnam, la chute du Mur de Berlin, les guerres de Yougoslavie), nous vaut des aperçus concrets sur les milieux du journalisme, du cinéma, de la télé et de l’université, les querelles avec les producteurs, les conflits avec la censure ; des croquis au vol, élogieux ou poivrés, de Pierre Mendès France, Simone Veil, François Mitterrand, Bertolt Brecht, Louis Jouvet, James Mason, John Huston, Preston Sturges, Marlene Dietrich et bien d’autres. Au passage, Ophuls dit quelques mots éclairants de sa conception du documentaire et de ses méthodes de travail, cousines de celles de Frederick Wiseman qu’il admirait beaucoup : une subjectivité assumée ; pas de pré-scénarisation, jamais, car l’art du documentaire consiste à « essayer de rencontrer la réalité en tournant ».
Naples, lundi 7 mars [1932]
[…] De là à Monteoliveto et à la poste où j’ai trouvé le jeu complet des 1res épreuves de Technique en deux paquets. Je les ai lues une première fois : coquilles prodigieuses, — bas pour bons, Eratratique (?) pour Stratégie et 200 choses de ce calibre-là. Et puis j’ai vu que M. E. Boudot-Lamotte n’a pas toujours tenu compte de, ou compris, ou retenu, mes recommandations : je vois des chapitres que j’avais rejetés, et je n’en vois pas d’autres que j’avais pourtant inscrits sur la liste qui lui a servi à rassembler tous les chapitres épars dans les revues. Il faudra que je remette ordre à cela. Mais je suis certain que ce livre-là sera aussi plein de coquilles que les autres imprimés à la NRF ; je me demande pourquoi ? Stols et Alberts m’ont beaucoup mieux imprimé, et Levi, et F. Paillart à présent, ne m’ont pas saboté ce que j’ai donné à Commerce. Le plus étonnant est que plusieurs des choses ainsi sabotées par les typos de Gaston Gallimard ont été imprimées d’après les impressions de Levi. Cela m’a fait relire avec plaisir ma « Lettre aux imprimeurs » que j’ai fait placer à la fin de Technique ; il n’y a pas un mot à y changer, et je n’en regrette pas un mot, et elle me venge par avance de toutes les fautes commises par ces Messieurs dans ces épreuves. Penser qu’ils ont imprimé « quatreS » d’après un texte imprimé ! […] En somme il faut nous résigner à être aussi mal imprimés que les auteurs antérieurs à l’imprimerie étaient copiés.
Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.
Sur Larbaud et les coquilles, voir aussi « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».
« Tuer le cochon » […] J’y vois encore un exemple et un précepte applicable au métier d’écrivain : éviter la grandiloquence, maintenir l’expression en deçà de l’émotion ressentie et qu’il s’agit de communiquer. En marge d’un brouillon, « tuer le cochon » signifiera : « À récrire en baissant le ton. »
Valery Larbaud, « Tuer le cochon »,
section « l’Art et le métier »
de Sous l’invocation de saint Jérôme, Gallimard, 1946.*
Naples, dimanche 28 février [1932].
Beaucoup travaillé en pensée, ces jours-ci, à l’Amour et la monarchie ; idées et paroles viennent avec une abondance extraordinaire ; il faudra filtrer beaucoup, et tuer le cochon plus d’une fois, – tuer beaucoup de cochons !Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.
Pierre Belfond, Scènes de la vie d’un éditeur. Fayard 2006.
 Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.
Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.
En vingt-cinq ans d’activité, Pierre et Cora Belfond ont édifié un catalogue aussi varié qu’équilibré, où l’édition de bestsellers américains dont ils furent les pionniers en France avec Robert Laffont (The Love Machine, Les oiseaux se cachent pour mourir) permettait de maintenir la maison à flot en finançant les secteurs peu ou non rentables qui leur tenaient à cœur : la poésie et le roman français, la littérature étrangère, les livres sur la musique et sur l’art, deux de leurs grandes passions. L’entrée en Bourse de la maison, dans les années 1980, lui apporta sur le moment le ballon d’oxygène dont elle avait besoin, mais signa à terme la fin de son indépendance et son absorption par les éditions Masson. Une page de l’histoire de l’édition se tournait, avec l’entrée en scène des gestionnaires.
Si tous les chapitres de ce gros volume ne sont pas d’un égal intérêt, l’ensemble se recommande par sa franchise et son allant. Doté d’un sens du portrait et d’un bon talent de conteur, Belfond raconte avec un enthousiasme égal ses réussites et ses échecs, les paris improbables remportés contre toute attente, les occasions manquées, les coups durs et les rétablissements acrobatiques. La conclusion qu’on en tire – comme à la lecture de tant d’autres mémoires d’éditeurs – est que le commerce des livres est le plus imprévisible qui soit.