L’image absente
L’art du cinéma consiste parfois à susciter des images d’autant plus fortes qu’elles ne figurent pas dans le film mais se trouvent nulle part ailleurs que dans la tête du spectateur. C’est le ressort bien connu de la Lubitsch’s touch. La caméra s’arrête au seuil d’une porte close, à nous d’imaginer ce qui se passe derrière : le gag est d’autant plus drôle qu’il n’est pas montré.
La parole et, de manière indissociable, la mise en scène de cette parole, son incarnation dans une voix, un corps d’acteur ont le pouvoir de générer ces images absentes.
Soit le monologue génial de Faisons un rêve…, tout d’attente impatiente et de désir fébrile. Un œil sur la pendulette de son bureau, Sacha Guitry imagine à voix haute et en temps réel le trajet dans Paris de sa future amante Jacqueline Delubac pour arriver jusqu’à lui. Elle quitte son appartement de l’avenue de l’Alma, hèle un taxi. La voiture traverse les Champs-Élysées, emprunte la rue Washington qui n’en finit pas, passe devant la grande horloge, tourne dans le boulevard Haussmann – « va, prends-le, mon amour, je te le donne, le boulevard Haussmann ! » –, contourne la statue de Shakespeare, s’engage dans l’avenue de Messine, rétrocède en seconde, se trompe d’adresse, avance encore un peu, dépose enfin sa passagère. Celle-ci traverse l’avenue en regardant craintivement à droite et à gauche (« mais non, à cette heure-ci, qui veux-tu qui te regarde ? »), franchit la porte cochère. Elle gravit l’escalier, elle va sonner, elle va sonner… Pourquoi ne sonne-t-elle pas ?
Filmage en plans longs qui renforcent l’impression de temps réel ; génie verbal de Guitry, comme enivré de sa propre parole, timbre hypnotisant de sa voix, science de la diction et du phrasé, des pauses et des reprises ; mais aussi économie parfaite de la gestuelle et des déplacements : gestes des bras, des mains mimant le trajet, mobilité du regard dirigé hors-champ vers un écran imaginaire où Guitry projette en pensée sa vision, en dirigeant comme à distance l’action des personnages *… La puissance hallucinatoire de ce monologue est telle qu’on peut aisément se convaincre d’avoir bel et bien vu le taxi avalant la rue Washington, la statue de Shakespeare dressée boulevard Haussmann.

« Elle descend l’escalier… »

« Elle passe devant l’horloge de précision
qui retarde d’une heure trente-cinq depuis un an et demi… »

« Elle tourne autour de la statue de Shakespeare… »
Autre monologue. Dans Rebecca, Laurence Olivier dévoile enfin à Joan Fontaine la vraie nature de Rebecca et les circonstances véritables de sa mort. Un cinéaste moyen aurait été tenté d’illustrer ce récit par des images en flash-back avec, en voix off, la confession d’Olivier. Rien de tel chez Hitchcock, qui s’emploie au contraire à susciter la présence d’une absente. Cette évocation s’accomplit dans un admirable mouvement de caméra, d’abord légèrement ascendant, puis panoramique de la droite vers la gauche (soit du présent vers le passé), qui révèle progressivement le décor de la pièce – décor vide de présence humaine mais hanté par le fantôme de Rebecca – pour aboutir aux pieds d’Olivier, où se trouve le corps (absent) de la morte **.

Le cendrier n’a pas été vidé depuis la mort de Rebecca. Nous voici transporté dans le passé :
elle vient d’éteindre sa dernière cigarette, se lève…



Le trajet en taxi de Jacqueline Delubac ; les derniers instants de la vie de Rebecca : ces images non montrées n’en font pas moins partie intégrante du film et s’incorporent au souvenir qu’on en conserve. Revoyant un film des années plus tard, on est parfois surpris de n’y pas trouver des images qu’on était pourtant convaincu d’y avoir vues.
* Comme le remarque très justement Philippe Arnaud, pour l’amant de Faisons un rêve…, le désir est inséparable de sa mise en scène. Cf. le collectif Sacha Guitry, cinéaste, Festival international du film de Locarno/Yellow Now, 1993, p. 175.
** À relever aussi dans cette scène, le rôle important de la musique de Franz Waxman, qui concourt à l’égal de la mise en scène hitchcockienne à faire naître la vision d’images absentes.
Lectures expresses
Hampton Charles [Roy Peter Martin], Miss Seeton au service de Sa Majesté (Miss Seeton, by Apointment, 1990). Traduit de l’anglais par Katia Holmes. 10/18, « Grands Détectives », 1999.
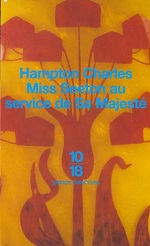 Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Professeur de dessin à la retraite, Emily D. Seeton est une excentrique de province que son entourage prend pour une aimable toquée. La police lui alloue une petite rémunération mais sa collaboration à Scotland Yard est tout involontaire. D’une part, elle a la manie de griffonner sans y penser des croquis sur des feuilles volantes. Or, ces dessins transposent de façon sibylline des personnes ou des situations qu’elle a observées sans y prêter d’attention particulière. Correctement interprétés, ils aident l’inspecteur Delphick à résoudre les affaires criminelles dont il a la charge. D’autre part, Miss Seeton, équipée d’un parapluie redoutable, a le don de se placer dans des situations impossibles et de dénouer malgré elle les intrigues par son comportement erratique, motivé à son sens par un strict respect des convenances mais aberrant aux yeux d’autrui. Sa candeur désarmante fait qu’elle ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d’elle.
Miss Seeton au service de Sa Majesté se déroule à l’époque du swinging London (avec, au passage, une allusion à l’affaire des Cinq de Cambridge). Une vendeuse de grand magasin remporte un concours de mannequinat organisé par un magazine de mode. Elle aura l’honneur d’être photographiée par Cédric Benbow (photographe de la gentry inspiré de Cecil Beaton) dans le cadre prestigieux d’un manoir de province, vêtue des plus beaux atours et parée de bijoux hors de prix prêtés par des collectionneurs. Pour arrondir ses fins de mois, notre vendeuse avait posé pour des photos osées. Un cambrioleur la fait chanter pour en faire sa complice afin de dérober les précieux bijoux. L’intrigue entrecroise habilement les parcours de nombreux personnages, reliés à leur insu les uns aux autres. Le tout, appuyé sur l’observation amusée des mœurs anglaises, baigne dans une ambiance joyeusement loufoque. Une parfaite lecture estivale.
Lectures expresses
Dorothy Whipple, High Wages (1930). Rééd. Persephone Books, 2009.
 Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.
Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.
L’évolution du commerce de détail et l’essor des grands magasins, la naissance du consumérisme, consécutifs à la Révolution industrielle, ont inspiré de nombreux romans à partir d’Au bonheur des dames. Au passage, ces fictions ont engendré un nouveau type populaire, celui de la shop girl. High Wages s’inscrit dans ce courant *. Situé de part et d’autre de la Première Guerre mondiale dans une petite ville du Lancashire, le roman narre l’ascension d’une jeune vendeuse employée d’un magasin de confection à l’ancienne, qui conquiert son indépendance et finit par ouvrir sa propre boutique. Au contraire de son affreux couple de patrons exploiteurs, Jane Carter est douée de flair commercial. Elle surveille les innovations de la concurrence et observe avec attention le comportement de la clientèle. C’est ainsi qu’elle pressent l’essor inéluctable du prêt-à-porter, qui assurera le succès de sa petite entreprise.
Dorothy Whipple fait preuve d’un sens du typage psychologique et social des personnages hérité de Jane Austen, avec, comme chez sa devancière, une grande attention portée à leurs idiosyncrasies langagières (à la Austen également, une grande scène de bal qui tourne au désastre). Son don d’observation fait mouche dans la peinture amusée des mœurs cancanières de province, la description de la société de classes anglaise et des transformations engendrées par la Première Guerre. Le tout d’autant mieux venu qu’au contraire d’autres romanciers contemporains soucieux du sort des classes laborieuses (tels que H.G. Wells), Whipple s’abstient de tout prêche social. La peinture du monde du commerce de confection, nourrie de nombreux détails matériels, est particulièrement réussie et fait tout l’intérêt du livre. A contrario, la part croissante et plus convenue de romance, non exempte d’une pointe de mélodrame, atténue la portée de son dernier quart.
En raison de sa construction par séquences, avec circulation des points de vue narratifs, et de l’abondance des dialogues, on lit High Wages comme on visionnerait une série télévisée anglaise. Et l’on se dit qu’aurait-elle été active de nos jours, Dorothy Whipple aurait probablement écrit directement pour le petit écran. Cette impression vient renforcer une hypothèse : un certain type de littérature middlebrow de bonne tenue, qui fit les bestsellers d’autrefois, se vend beaucoup moins en librairies aujourd’hui parce que son public, qui n’a rien perdu de son appétit pour ce genre de fictions, préfère désormais les consommer sous forme de séries télé.
* Signe que le sujet était dans l’air du temps, deux autres romancières à succès, Jane Oliver et Ann Stafford, publièrent à la même époque un désopilant roman par lettres situé dans un grand magasin londonien, Business as Usual.
Lectures expresses
Joshua Abbott et Philip Butler, London Tube Stations 1924-1961. Fuel, 2023.
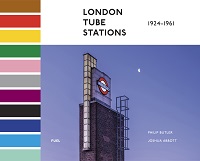 Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.
Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.
Au milieu des années 1920, le métro londonien connaît une phase d’expansion, marquée par le prolongement de lignes existantes en direction des banlieues et l’ouverture de nouvelles lignes. Frank Pick, directeur général des transports londoniens, lance un ambitieux programme architectural pour la rénovation des gares existantes et la construction de nouvelles stations. La réalisation en est confiée à l’architecte Charles Holden. Celui-ci va concevoir un remarquable ensemble de stations de style moderniste, ainsi que le nouveau siège social de l’UERL (Underground Electric Railways Company). Un souci de cohérence guide l’action de Pick et Holden. Il s’agit de concilier le style et la fonction tout en donnant une identité moderne et forte au métro londonien *. Les nouvelles stations, construites en briques, souvent coiffées d’une tour jouant comme un signal, se repèrent aisément dans l’espace urbain. Dans un pays que son insularité avait isolé des courants architecturaux contemporains, ce projet exemplaire ouvrira la voie au modernisme, ainsi qu’en témoignera par la suite la construction de nouveaux quartiers résidentiels dans la banlieue de Londres **.
London Tube Stations répertorie, ligne par ligne, les gares ayant survécu à cette période novatrice et les exemples ultérieurs influencés par elle. Toutes les stations clés sont présentées sur une double page, où les textes informés et précis de l’historien Joshua Abbott jouxtent les belles photographies de Philip Butler. Une introduction générale présente le contexte historique du projet, tandis qu’un dernier chapitre dresse la liste des stations démolies.
Ajoutons que le livre est une belle réalisation éditoriale : reliure cartonnée, format à l’italienne, mise en page et typographie élégantes dans leur clarté.
* À la même époque, Harry Beck conçoit un nouveau plan du métro londonien qui fera date dans l’histoire du design graphique. Cette histoire est racontée dans le livre passionnant de Ken Garland, Mr Beck’s Underground Map (Capital Transport Publishing, 1994).
** Sur ce sujet, voir l’excellent guide de Joshua Abbott, A Guide to Modernism in MetroLand (Unbound, 2020).














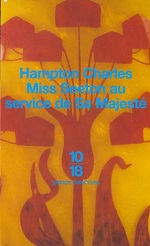 Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.
Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série. Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.
Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

















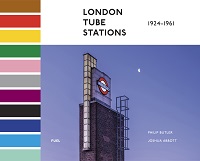 Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.
Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.