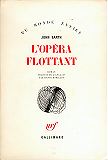 Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire.
Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire.
L’opéra flottant du titre est l’un de ces showboats qui faisaient la navette dans les estuaires de la Virginie et du Maryland en donnant de ville en ville des représentations théâtrales. La dernière partie de l’histoire se déroule à son bord, mais l’embarcation est aussi une métaphore de l’existence humaine et du livre que nous sommes en train de lire, au fur et à mesure qu’il s’écrit sous nos yeux. «C’est un opéra flottant, mes amis, surchargé de curiosités, de mélodrame, de spectacles, d’enseignement et de divertissements, mais il flotte bon gré mal gré au rythme des marées de ma prose vagabonde. » Nous voilà donc embarqués dans une parodie tour à tour sérieuse et bouffonne de roman existentiel, qui marie en un très singulier alliage angoisse de la vieillesse, sens de l’absurde, humour pince-sans-rire et recherches formelles.
Le narrateur, Todd Andrews est un avocat cynique et détaché, pour qui « tout a un sens et rien au fond n’est important », ce qui lui a permis de réussir dans une profession à laquelle il ne croit pas plus qu’au reste, mais lui inspire aussi un penchant pour l’acte gratuit, au point de lui faire envisager froidement une action que je ne révélerai pas. Atteint d’une faiblesse cardiaque qui a fait de lui, dès son jeune âge, un homme en sursis, il habite à l’hôtel où il loue une chambre à la journée. Après seize ans de mûre réflexion, il entreprend de reconstituer par le menu la journée de juin 1937 au cours de laquelle il a calmement envisagé de mettre fin à sa vie (et, sa décision prise, de vivre cette dernière journée comme toutes les autres, en se conformant strictement à ses habitudes), avant de se raviser. L’examen méticuleux des causes et des effets le conduit à multiplier les précautions oratoires, les retours en arrière et les ratiocinations, les commentaires et les digressions, poussé par un souci de clarté et d’exhaustivité qui rend son entreprise interminable – comme l’Enquête sur lui-même dont il accumule les matériaux dans des cageots à pêches, comme le voilier dont il n’achèvera jamais la construction. Chemin faisant, il est donc amené à narrer sa jeunesse, son dépucelage, son expérience du front durant la première guerre mondiale (épisode proprement sidérant), ou encore à détailler l’étonnant ménage à trois qu’il forme avec son meilleur ami Harrison Mack et l’épouse d’icelui (parents d’une fillette dont il est peut-être le géniteur). Ici s’avance un des sous-thèmes du livre, la paternité et la filiation, le legs, l’héritage, aux retombées tantôt dramatiques et tantôt burlesques. Dramatique : ruiné par le crash de 1929, le père de Todd s’est lui-même suicidé, et cet épisode traumatique hante son existence en déterminant pour une part sa conduite. Burlesque : l’inénarrable imbroglio juridique de la succession Mack. Le père de Harrison, industriel ayant fait fortune dans la conserve de cornichons, est mort sénile en laissant derrière lui sept testaments contradictoires et des bocaux remplis de ses excréments qui font l’objet de procès répétition (les autres affaires judiciaires évoquées dans le livre valent leur pesant de cacahuètes).
Andrews est un narrateur débutant, dont le souci de totalisation se heurte aux difficultés inhérentes à la mise en forme romanesque. Il s’en excuse d’emblée en promettant à son cher lecteur qu’il gagnera en assurance au fil des pages. Naturellement, la maladresse (réelle) du narrateur est une maladresse (feinte) de la part de Barth, qui cache sa maîtrise (réelle) de romancier, et de cet hiatus naît une part de l’ironie indéfinissable du récit. Il faut, après avoir terminé le livre, reprendre le premier chapitre pour s’apercevoir que la plupart des thèmes et des personnages y sont posés sans avoir l’air d’y toucher… comme dans une ouverture d’opéra.
« Nulle notion n’est plus insaisissable que le motif d’une action humaine, quelle qu’elle soit. » De ce constat banal, Barth a tiré un roman aussi excentrique et raisonneur que son personnage, ancré dans la tradition romanesque américaine (tranche de vie provinciale, personnages hauts en couleur) que cependant il sape de l’intérieur, avec un clin d’œil possible à Joyce : l’action, comme dans Ulysse, tient en une journée, Cambridge (Maryland) vaut bien Dublin, et Barth use avec humour de divers procédés narratifs : chœur des vieillards sur un banc public, chapitre en forme de prospectus, épisode à deux narrations parallèles (sur deux colonnes).
On en a vu d’autres depuis en matière de jeux formels, de métafictions et de mises en abyme [1]. Mais contrairement à bien des « nouveaux romans » de la même époque qui font littérature de professeur, l’Opéra flottant ne s’est pas démodé. D’abord parce que le goût barthien de la déconstruction n’a rien de « théorique » et reste indissociable d’un allègre plaisir de conter ; ensuite en raison de son irrésistible ton moqueur, qui n’épargne pas même sa propre entreprise.
 John BARTH, l’Opéra flottant. Traduction d’Henri Robillot. Gallimard, « Du monde entier », 1968, 289 p. Rééd. « L’Étrangère », 1997.
John BARTH, l’Opéra flottant. Traduction d’Henri Robillot. Gallimard, « Du monde entier », 1968, 289 p. Rééd. « L’Étrangère », 1997.
1. Et Barth a, semble-t-il, poussé le bouchon beaucoup plus loin dans son œuvre ultérieure, ce qui explique que cet auteur si renommé outre-Atlantique reste relativement méconnu du public francophone, plusieurs de ses livres posant d’énormes difficultés de traduction.
3 Comments
Laisser un commentaire
Merci pour ces précisions. Les traductions Gallimard sont non seulement épuisées, mais introuvables en librairies d’occasion (au terme d’une première investigation) et même dans la bibliothèque du coin. J’ai demandé Chimère via le prêt inter-bibliothèques – très impatient de poursuivre mon périple barthien.
Commentaire by th 10.18.06 @ 7:58 pmLe Courtier en Tabac, en outre, est une pochade majeure et la traduction française (de Christophe Claro) procède de l’exploit (tout comme celle qu’il a faite du Tunnel de William Gass). Ces titres étant assez récents en version traduite, ils ne sont pas durs à trouver.
Commentaire by Ernst Lanzer 11.04.09 @ 2:29 am





En fait, 7 des 15 oeuvres de fiction de Barth ont été traduites en français : en plus de l’Opéra flottant, on a Fin de parcours, le Courtier en tabac, l’Enfant-bouc, Perdu dans le labyrinthe, Chimère et la Croisière du Pokey. La majorité de ces titres sont indisponibles, parce que personne ne semblait s’y intéresser en France. On note aussi que, pour la majeure partie, les traductions ne couvrent que les titres ayant reçu un bon accueil du public US. Les romans parus au cours des 25 dernières années n’ont pas eu cette chance.
Commentaire by fausto 10.17.06 @ 3:08 pmEn matière de succès commercial, Barth a manqué de pot sans doute – à la fin des années 60, Nabokov le nommait comme un des jeunes auteurs de qualité, avec Updike -, peut-être n’a-t-il pas su frotter le public dans le bon sens. Et de ça, on ne va pas se plaindre, puisque cela nous a donné quelques textes majeurs.