Bill Holman de côté


Au risque de me répéter, Reckless Records, dans Soho, est la providence des amateurs de jazz (et aussi de rock et pop de toutes tendances, pour autant que je puisse en juger). À chaque passage on est certain d’y pêcher l’une ou l’autre rareté, et à un prix d’occasion abordable et sensé, non aux prix délirants que pratiquent certains spéculateurs sur le net.
Pour cette fois, on frétille d’avoir mis la main sur deux albums qu’on cherchait depuis des lustres, Evidence of Things Unseen de Don Pullen (1983) et surtout A View from the Side de Bill Holman (1995), disque fort excitant de big band moderne orchestré de main de maître par un vétéran de la West Coast ayant débuté chez Stan Kenton. Du même, on recommande aussi, enregistré deux ans plus tard avec le même groupe, Brillant Corners, où Holman relève brillamment le défi d’arranger dix thèmes de Monk pour un big band.
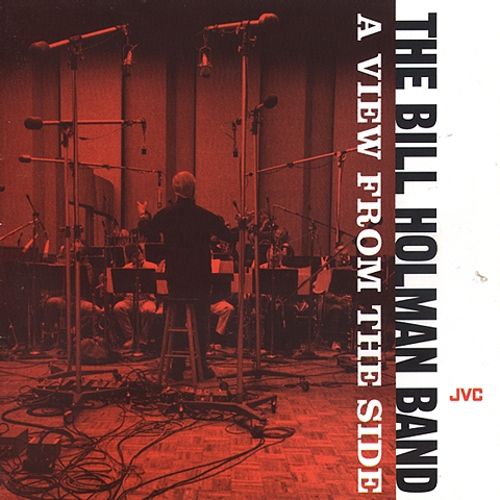
Anyone Can Whistle

Reprise d’Anyone Can Whistle de Stephen Sondheim à l’Union Theatre, où l’on avait vu l’an dernier une production très réussie de Road Show. Dans l’intervalle, ce sympathique bistro-théâtre de poche a déménagé sur le trottoir d’en face, dans des locaux plus spacieux mais fleurant toujours bon l’entrepôt réaménagé.
Anyone Can Whistle (1964) est le deuxième show dont Sondheim écrivit paroles et musique. Ce fut aussi son premier bide retentissant, à la fois public et critique : le spectacle quitta l’affiche après neuf représentations à Broadway. L’œuvre a été réhabilitée depuis et a connu quelques reprises à partir du milieu des années 1990. Bien. J’avoue n’avoir pas été du tout convaincu, et la faute en revient avant tout au livret d’Arthur Laurents. Cela se veut une farce volontairement absurde et sans queue ni tête sur l’avidité et la corruption des notables. Dans une petite ville américaine au bord de la banqueroute, la mairesse et ses séides (le juge, le chef de la police) inventent un pseudo « miracle » pour attirer les foules de pèlerins, relancer l’activité locale et s’en mettre plein les poches au passage. Parallèlement, les pensionnaires d’un asile d’aliénés (seule institution du cru encore en état de marche) s’égaillent dans la nature et se mêlent à la population, ce qui ajoute à la folie ambiante – mais qui est vraiment fou et qui est sain d’esprit ? Alerte, allégorie sociale. Dès la première scène, on est embarrassé par le ton laborieux et forcé de la satire, la platitude convenue du propos. Ce devrait être une joyeuse pagaille orchestrée crescendo à la Preston Sturges mais la machine tourne à vide. L’énergie de la mise en scène et de l’interprétation n’en paraît que plus artificielle, au bord parfois de l’hystérie. En un mot, on s’ennuie ferme. Alors, on se concentre sur le travail millimétré du trio de musiciens et des choristes, au service d’une partition exigeant comme toujours la plus grande précision. On observe un Sondheim encore jeune tester divers procédés qui deviendront sa marque de fabrique : un grand numéro de parler-chanter de près d’un quart d’heure, d’une virtuosité étourdissante (intitulé par antiphrase Simple), le recours au collage et au pastiche musical. Toutes choses qui trouveront leur plein emploi quelques années plus tard dans son premier chef-d’œuvre, Company (1970), sur un livret exceptionnel, celui-là, de George Furth.

Sharon Tandy
Grâce à Sheila Burgel, férue de chanteuses et de groupes féminins des années 1960 interviewée dans Dust & Grooves, on découvre quelques pépites du genre : Scratch my Back de Jan Panter, Good Woman de Barbara Lynn, You Just Gotta Know my Mind de Dana Gillespie… et surtout les singles de Sharon Tandy, notre chouchou du moment.
Tandy (1943-2015) est née en Afrique du Sud où elle a rencontré toute jeune son mentor-producteur-Svengali et futur époux Frank Fenter, avec qui elle s’est envolée en Angleterre en 1964. Elle a eu son petit succès d’estime durant quelques années sans parvenir à effectuer une percée majeure. Le talent était là, la voix et l’énergie ; n’a manqué que le coup de pouce de la chance qui permet de décrocher la timbale. À écouter ses singles dont plusieurs valent bien des hits de l’époque, on se dit que c’est injuste. Il est vrai que la concurrence était vive dans le monde de la pop vocale féminine.
Tandy a enregistré pour Pye, Atlantic et Stax (avec Booker T & the M.G.’s et Isaac Hayes, à l’occasion d’un séjour à Memphis en 1966), et s’est fréquemment produite avec le groupe Les Fleur de Lys (sic). En 1970, son mariage en miettes et sa carrière battant de l’aile, elle est rentrée en Afrique du Sud où elle a encore enregistré quelques titres qui furent des succès locaux, avant de se ranger des voitures.
On se fera une idée agréable de son talent en écoutant Our Day Will Come et Daughter of the Sun. Les gourmands iront tout droit à l’anthologie You Gotta Believe It’s… Sharon Tandy (Big Beat CDWIKD 233), qu’on peut ouïr intégralement ici.

Sillons et poussière

Tout a commencé comme un projet du dimanche, sans dessein particulier : quelques photos prises au vol chez un disquaire new-yorkais, d’autres chez des particuliers entourés de leurs trésors. Au fil de ses voyages, de l’Afrique au Japon, Eilon Paz a continué de rencontrer des collectionneurs de vinyles et de les portraiturer. De fil en aiguille, cet ensemble de photos a alimenté un site qui a connu un succès de bouche à oreille dans le landernau des vinylophiles, avant de devenir ce splendide coffee table book qui ravira les amateurs.
Cent trente fanatiques y sont photographiés dans leur intérieur débordant de 33, de 45 ou de 78 tours, cordés en rangs serrés du plancher jusqu’au plafond. Chacun présente une pièce de sa collection – album de chevet, rareté ou curiosité incongrue. En complément à ce copieux portfolio, de longs entretiens nous font faire plus ample connaissance avec une douzaine de collectionneurs, leur histoire, leurs goûts, leurs trouvailles, leur méthode de classement.
L’échantillon n’a aucune prétention sociologique. La tranche d’âge des trente-cinquante ans prédomine. On y croise beaucoup de gens appartenant au monde de la musique, producteurs, DJ, musiciens ou disquaires, férus le plus souvent de musique pop anglo-saxonne, au sens le plus large. Il y a peu d’amateurs de jazz (hormis une passionnée de Jackie McLean) et pas du tout d’amateurs de musique classique, population qui compte pourtant pas mal de bêtes curieuses. Il y a beaucoup d’hommes et quelques femmes, comme toujours en matière de collectionnite. Les uns se disciplinent pour maintenir leur collection dans des limites raisonnables, les autres se laissent inexorablement envahir : Ahmir Thompson avoue posséder soixante-quinze mille vinyles et ne pas pouvoir envisager de se départir d’un seul. Mais bien entendu, l’accumulation n’est pas une fin en soi, plutôt une conséquence annexe de ce qui est avant tout une passion pour la musique (il va sans dire qu’aucune de ces personnes ne collectionne dans un but de spéculation). Passion indissociable de votre vie et qui peut la transformer : fan de groupes féminins des années 1960, Sheila Burgel a appris le japonais durant cinq ans et vécu un an à Tokyo pour mieux comprendre le monde de la pop féminine nippone de cette décennie.
Les excentriques abondent : un ancien routier fan de rock progressif turc, photographié dans son domicile de la banlieue d’Istanbul ; un jeune nerd de Philadelphie, à la limite de l’autisme, collectionnant les disques de Sesame Street (il y en a beaucoup plus que vous imaginez) ; un Anglais BCBG attiré par les galettes les plus improbables : disques de prévention du suicide, B.O. de films pornos allemands, albums de « musique d’ameublement » (ces disques de musique d’ambiance aquatique ou spatiale ou ce qu’on veut, servant à illustrer reportages et documentaires télévisés). Et, mind you, il les écoute ! On retrouve enfin une vieille connaissance, déjà rencontrée dans le livre d’Amanda Petrusich, Do Not Sell at Any Price, consacré aux collectionneurs de 78 tours de blues (voir entretien ici) : Joe Bussard, octogénaire bourru pour qui l’âge d’or de la musique enregistrée se situe entre 1929 et 1933. Après, comprenez-vous, le son a changé, et ça n’a plus jamais été pareil.
 Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.
Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.

Geoffrey Weiss

Sheila Burgel

Joe Bussard dans son sous-sol tapissé de 78 tours
Jazz Center


Le Jazz Center de La Haye est le plus important magasin de disques de jazz des Pays-Bas. Il propose des CD (neufs), des vinyls (neufs et d’occasion), des DVD, un choix de livres, ainsi qu’un important rayon d’imports japonais. On aurait pu y rester des heures. Les prix sont ceux d’un magasin indépendant spécialisé, donc un peu plus élevés que ceux d’une chaîne de grande distribution, mais le choix évidemment sans comparaison, et l’aimable tenancier connaît son sujet. On a eu la joie d’y trouver plusieurs disques officiellement épuisés qu’on cherchait depuis longtemps, et que des petits malins proposent à des prix scandaleux sur le net. On sera tenté de retourner à La Haye rien que pour y faire une nouvelle visite.
Beau rayon de musique classique aussi (vinyls et CD).
125a Wagenstraat
2512 AT Den Haag
Tél. : +31 (0)70 3639129
www.jazzcenter.nl
info@jazzcenter.nl
Dimanche en jazz

Big Two réunit deux concerts enregistrés au Fasching Club de Stockholm les 18 et 19 avril 1980. J’ai hésité à le prendre chez le disquaire d’occasion. Du Warne Marsh, il y en a déjà plein ma discothèque, dont un excellent récital chez Fresh Sound enregistré durant la même tournée. J’aurais eu bien tort de me priver. Peu de disques, ces temps derniers, m’ont procuré autant de joie.
Marsh est dans une forme impériale. Ses lignes mélodiques sinueuses et volatiles se déploient dans l’air comme des rubans de fumée bleue. Son répertoire, on le connaît par cœur, mais on est épaté de la fraîcheur intacte et de la vélocité souvent stupéfiante avec lesquelles il enfourche des standards ou des thèmes dérivés de standards qu’il a dû jouer plusieurs centaines de fois en concert, en parvenant une fois de plus à les réinventer.
Rompu à l’art du duo, Red Mitchell est un partenaire de jeu idéal 1 : un son magnifique de chaleur et de profondeur, une walking bass élastique ponctuée d’arrêts, de rebonds, d’accords arpégés qui font chanter la contrebasse.
Il y a des soirs de club comme ça où l’alchimie est palpable, où des musiciens qui se connaissent depuis trente-cinq ans et sont en accord télépathique réussissent encore à se surpasser. Ce fut le cas ces deux soirs d’avril 1980. La prise de son est de premier ordre.
1 Voir par exemple ce chef-d’œuvre cosigné avec Lee Konitz sur des thèmes de Cole Porter, I Concentrate on You (SteepleChase).
Dimanche en jazz
Formé par Anthony Braxton et Jackie McLean, Steve Lehman combine en un alliage personnel l’apport de ces deux maîtres : le goût de Braxton pour les compositions élaborées, un timbre urticant à l’alto, moins porté cependant que McLean sur le falsetto. Après des débuts dans l’ensemble de Braxton, il a enregistré une douzaine d’albums sous son nom à partir de 2001, essentiellement pour les labels Pi et Clean Feed. De ceux que j’ai pu entendre, Manifold, en quatuor sans piano à la Ornette Coleman, est celui qui m’a le moins emballé : c’est un bon concert de free-bop, balancé avec le punch qui convient, mais comme on en connaît des dizaines. En revanche, les albums en trio sont très excitants (Interface avec Mark Dresser et Pheeroan akLaff, Dialect Fluorescent avec Matt Brewer et Damion Reid). Ma préférence va toutefois aux ensembles d’On Meaning et de Mise en abîme. On Meaning est un quintette alto, trompette, vibraphone, contrebasse et batterie. Mise en abîme, un octuor alto, ténor, trombone, vibraphone, tuba, contrebasse et batterie. Leur combinaison instrumentale, la présence du vibraphone, le travail sur la texture sonore, le mariage stimulant de complexité harmonique et d’improvisation libre rappellent les albums Blue Note de la grande époque, d’Out to Lunch ! d’Eric Dolphy aux disques de Bobby Hutcherson. Nullement sur le mode du pastiche, mais à la manière d’un prolongement, frayant de nouveaux possibles dans le courant ouvert par les modernistes des années 1960 sans ignorer ce qui est advenu dans l’intervalle.
Pure Imagination (trio).
Autumnn Interlude (octuor).



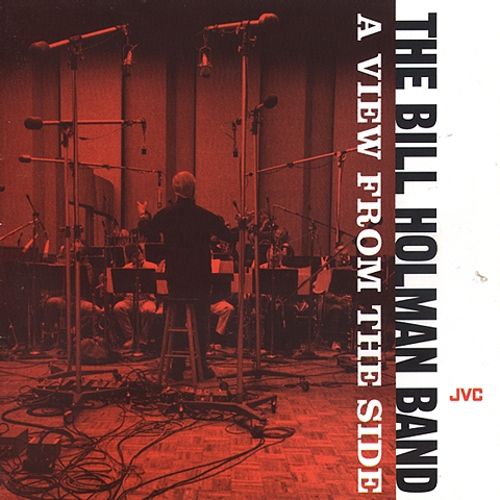










 Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.
Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.





