Métadétections (2)
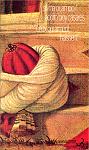 En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
 Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.
Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.
1. La victime est traductrice de romans policiers, ses brouillons et sa bibliothèque jouent un rôle crucial dans le développement et la résolution de l’énigme ; quant au couple de voyageurs, « dilettantes en littérature », que rencontre le narrateur dans le train de nuit pour Salinas, ne seraient-ce pas des avatars d’Ocampo et Bioy ?
Métadétections (1)
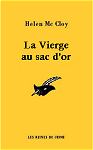 Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
 Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.
Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.
1. Sur ce roman, voir le remarquable essai de réinterprétation de Pierre Bayard, Qui a tué Roger Ackroyd ? (Minuit).
2. Perec construira sur un principe analogue le fascinant jeu de cryptogrammes et de poupées russes emboîtées de « 53 jours ».
3. Autre correspondance borgesienne, l’importance des rêves et des paramnésies : c’est un rêve qui aiguillera le flic sur la voie de la vérité.
Westlake, tir groupé
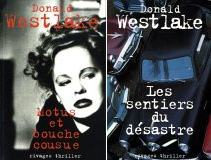 Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Motus et bouche cousue met en scène un petit braqueur que deux cadres politiques tirent de prison, sous condition qu’il dérobe une cassette vidéo compromettante pour le président en exercice, laquelle servira d’arme de chantage dans la prochaine campagne électorale. Frank Meehan est une sorte de composé des deux héros récurrents de Westlake, Dortmunder et Parker. Comme le premier, c’est un guignard pas possible. Comme le second, c’est un professionnel du casse (mais sans la brutalité de Parker), qui déteste travailler avec des amateurs et a horreur de perdre son temps. (Le texte anglais rend bien, dans son écriture même, le caractère du personnage : les phrases ont un côté cassant, agacé, comme impatient d’en finir, qui s’est perdu dans la traduction.) Cet alliage a priori intéressant ne tient malheureusement pas ses promesses. Les deux registres se contrecarrent au lieu de s’épauler, si bien que le livre semble assis entre deux chaises. La satire des coulisses du monde politique est trop légère pour prêter à conséquence, mais en même temps pas assez hénaurme pour être jubilatoire. Les deux terroristes d’opérette, qui ne dépareraient pas une aventure de Dortmunder (on en retrouve d’ailleurs une paire semblable dans Pourquoi moi ? cf. plus bas), sont trop manifestement incompétents pour réellement inquiéter ; or Westlake tente de construire un suspense « sérieux » sur leur intervention intempestive, etc. Plus grave, le livre pâtit d’une construction déséquilibrée. Les préparatifs du coup, narrés avec un luxe savoureux de détails et de circonvolutions, occupent les quatre cinquièmes du volume, après quoi son exécution et le dénouement sont trop rapidement expédiés. Le soufflé, patiemment cuisiné, retombe brutalement à plat et nous laisse sur une impression mitigée.
Plus réussi, les Sentiers du désastre souffre du même syndrome du pétard mouillé. L’intrigue repose sur le principe éprouvé du jeu de dominos, qu’on pourrait résumer par une phrase du cher John Crosby : « Chacun avait son plan, soit quatre plans au total, qui avaient des répercussions mutuelles et, à partir de cet instant, tous les quatre commencèrent à foirer. » Autour de la fortune de Monroe Hall, affreux bébé gâté de milliardaire universellement haï, et assigné à résidence à la suite d’un scandale financier de type Enron, gravitent d’une part l’ineffable Dortmunder et sa bande habituelle, qui veulent mettre la main sur sa collection de voitures anciennes, et d’autre part les actionnaires qu’il a plumés et les ouvriers qu’il a privés de pension, également assoiffés de vengeance. Le livre captive par sa mise en place extrêmement élaborée, qui fait se croiser avec une maestria consommée une bonne quinzaine de personnages, tous portraiturés de réjouissante manière. Sauf qu’après avoir, en savant horloger, assemblé sous nos yeux une mécanique de haute précision et en avoir tendu le ressort, Westlake néglige d’en exploiter les possibilités et bâcle le dénouement, comme s’il était soudain pressé d’en finir.
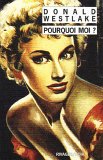 L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
 Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.
Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.
 Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.
Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p. 
Pourquoi moi ? (Why Me?). Traduction de Sophie Mayoux révisée et complétée par Patricia Christian. Rivages/Noir, 2006, 313 p.
L’art et la manière
 Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.
Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.
Thomas est un cas intéressant de maniériste. Bien sûr, ses livres présentent des personnages hauts en couleur et avancent une vision du monde sarcastique et désabusée. Mais ils tiennent d’abord par l’écriture, qui se caractérise par une sorte d’hypertrophie du style matter of fact – aux confins de la parodie pince-sans-rire. (C’est en quelque sorte une anamorphose du style hard-boiled de l’école Hammett-Chandler, de la même manière que les maniéristes italiens anamorphosaient le canon de la Renaissance classique.) Leur humour à sec est réjouissant et les dialogues, avec leurs joutes au fleuret et leurs échanges du tac au tac, jubilatoires. Et quand ce style rencontre une trame forte et complexe, riche en rebondissements et en coups fourrés, comme dans les Faisans des îles, on obtient un sacré bon livre.
jeudi 11 mai 2006 |
Rompols |
Commentaires fermés sur L’art et la manière
La course du rat
 Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.
Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.
À la limite, l’intrigue peut se passer de violence et de meurtre sans cesser d’être «noire». En témoigne le remarquable la Tête sur le billot de l’excellent John D. MacDonald (A Key to the Suite, 1962), polar sans crime ou presque (pas de mort avant la page 150, l’enquête aussitôt étouffée au soulagement général), situé dans l’univers impitoyable d’un congrès de grosse société (soûlographie, intrigues de couloir et chantages divers), où le tueur n’en est un qu’au sens figuré : il s’agit d’un inspecteur délégué par la direction pour restructurer les branches provinciales de la compagnie et faire tomber les têtes superflues. Mais si notre homme accomplit cette sale besogne sans état d’âme apparent, cet épisode le déniaisera moralement et lui laissera un goût amer dans la bouche. À l’orée des années 1960, le monde du travail se modernise et se déshumanise sous la houlette d’une nouvelle génération de cadres obsédés de rendement et de rationalité aveugle. Moralité : tous des rats dans un labyrinthe. Toute ressemblance avec notre époque n’est pas le fruit du hasard.
Alice crime
 « Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
« Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
 Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.
Hurl BARBE, Alice crime. 1979. Rééd. Ginkgo éditeur, 2004.
John Crosby
Qu’attend-on d’un bon polar ? Une intrigue serrée, évidemment, et qui tient en haleine, comme on dit. Mais au-delà, un regard décapant sur le monde actuel et ses turpitudes, porté par une écriture, un ton original. Avec John Crosby, on est royalement servi. Horatio Cassidy, son héros récurrent, est l’un des personnages les plus originaux de la série « grands détectives » de 10/18. Cassidy est un ex-agent de la CIA qui s’est fait virer de cette auguste maison pour des motifs mal élucidés. La vérité est que cet Irlandais brillant et cultivé est un idéaliste sans illusions, si l’on peut dire, qui ne croit ni en dieu ni en diable, un franc-tireur qui ne mâche pas ses mots. Autant de péchés qui ne pardonnent pas dans le monde peu reluisant de l’espionnage. Fin lettré, il enseigne à présent l’histoire médiévale. La CIA fait ponctuellement appel à ses services pour des affaires auxquelles elle ne veut pas être officiellement mêlée, en la personne de Hugh Alison, l’homme qui a survécu à toutes les guéguerres internes de l’Agence parce qu’il maîtrise comme pas un l’art de mouiller les autres en passant lui-même entre les gouttes. Le portrait de ce fonctionnaire de l’espionnage hypocrite et onctueux et fiéffé salopard est particulièrement réussi, et ses échanges à fleurets mouchetés avec Cassidy valent leur pesant de cacahuètes – car Crosby est un dialoguiste hors-pair. C’est aussi un amateur d’intrigues touffues, crédibles sur le fond et peuplées cependant de personnages excentriques et de péripéties hénaurmes, que Cassidy débrouille à sa manière inorthodoxe : à la fois érudit et homme d’action, ce pédagogue anticonformiste puise régulièrement dans ses connaissances en histoire antique et médiévale des leçons de stratégie pour mener à bien les guerres contemporaines. Ce regard surplombant de l’Histoire fait le sel de ces romans qui composent en sous-main une épopée à la fois cruelle, violente et dérisoire de notre temps – ou du temps d’avant-hier, puisque, écrits entre 1979 et 1985, ils se déroulent sur fond de guerre froide finissante, mais les choses ont-elles tellement changé [1]? Le Clou de la saison dépeint notamment la décadence des riches cloîtrés dans un immeuble-bunker pourvu de tous les gadgets de surveillance dernier cri (et bientôt pris d’assaut par des armadas de terroristes). Dans Tu paies un canon ?, un rafiot bourré d’engins explosifs sophistiqués, oublié en rade dans le port de New York, excite la convoitise de puissances diverses (la Syrie, Israël, l’OLP et bien entendu la mafia). Pas de quartier ! s’en prend au trafic de la drogue, fondement de l’économie de régimes latino-américains corrompus jusqu’à la moelle où l’on torture et tue à tout-va – et accessoirement fer de lance de la Realpolitik américaine (la CIA et jusqu’à la Maison Blanche sont mouillées jusqu’au cou). Mais avec tout ça, j’oublierais presque l’essentiel, qui est que ces livres formidablement drôles sont un régal pour l’intelligence, et que leur humour cinglant est source d’une intense jubilation.

1. « Il avait choisi pour sujet la sorcellerie et la place qu’elle occupait dans les sociétés médiévales. Il projetait de ranger le christianisme parmi ces superstitions, classification qui lui avait valu quantité d’ennuis par le passé et qui ne pourrait que lui en valoir davantage encore en cette époque de fanatisme religieux à outrance. Le président des États-Unis n’avait-il pas déclaré qu’il considérait que chaque mot de la Bible était d’inspiration divine ? Il faudra que je rappelle à mes petits monstres, songea Cassidy, que la Bible est la traduction de la traduction d’une traduction et qu’une bonne partie de son contenu a, en fait, été empruntée aux religions païennes par les chrétiens qui en ont fait leur miel au gré de leur fantaisie. » (Tu paies un canon ?).
Écrit sous Reagan, encore plus vrai sous Bush, Jr.
« – Je voulais simplement tenir [le président] au courant. L’opération a commencé. – Il ne veut pas le savoir, dit-elle en lui raccrochant brutalement au nez. Alison rougit et raccrocha à son tour. La nouvelle diplomatie. Le droit de savoir avait constitué le privilège suprême. Sous Reagan était apparu un privilège encore plus grand, celui de ne pas savoir. (Sous Reagan, les États-Unis avaient véritablement entamé des pourparlers avec l’OLP sans en avertir le président. S’ils avaient abouti, le mérite en aurait rejailli sur lui. Sinon, il n’avait jamais été au courant. Mieux encore, il ne s’était rien passé. » (Pas de quartier !)
Celle qui raccroche au nez d’Alison, c’est Harriet Van Fleet, conseillère du président et sosie prémonitoire de Condoleezza Rice (le roman, rappelons-le, a été écrit en 1985).
***
Par ordre de préférence : le Clou de la saison et Pas de quartier ! Ensuite : À la volée. L’intrigue de Tu paies un canon ? est plus faible mais le livre reste d’une lecture plaisante.
Le Clou de la saison et Tu paies un canon ? ont d’abord été publiés par la Série noire avant d’être réédités dans la série « grands détectives » de 10/18, où ont paru directement les deux autres.
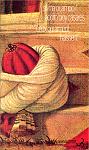 En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central. Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.
Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.





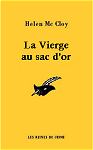 Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].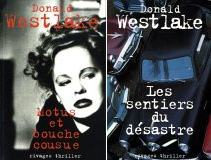 Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.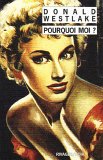 L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique. Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.
Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.  Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.
Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire. Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un
Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un  « Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.
« Canular pataphysico-oulipien » et « premier polar potentiel » (Michel Lebrun) ; « exercice de voltige mené tambour battant » (Jacques Baudou) ; « hétéroclite du roman policier » (Roland Sapiens). Appâté par ces éloges, on se précipite… et l’on déchante vite. Alors, oui, les pages et les chapitres sont numérotés à l’envers. Les personnages s’appellent Duroc, Duquel, Duboeuf, Dural, etc. L’intrigue n’a ni queue ni tête et cet arbitraire est bien entendu revendiqué. Le meurtrier Machin, quoique mort et enterré, commet ses crimes en référence à l’œuvre de Raymond Roussel. C’est truffé d’allusions aux membres de l’Oulipo. L’auteur multiplie les pieds de nez, les digressions saugrenues et les adresses au lecteur. Et ainsi de suite. En somme, tout ça est à prendre au énième degré… sauf que c’est totalement dépourvu d’intérêt. On a l’impression que le dénommé Hurl Barbe s’amuse tout seul et tire à la ligne en s’applaudissant à chaque page de son humour irrésistible (Dumoral ne l’a pas, ah ah ah ; Ducid est tragique, oh oh oh, arrêtez, c’est trop), sans affronter le défi de son postulat de départ (qui tourne autour de l’identité du coupable, et que je ne dévoilerai donc pas). Bref, on s’ennuie ferme et il faut se forcer pour aller jusqu’au bout.