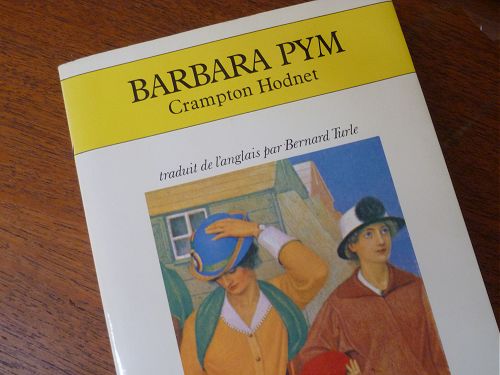Tea Time
Il se boit des hectolitres de thé dans les romans de Barbara Pym ; mais même à l’aune de cette consommation moyenne, Des femmes remarquables bat tous les records. Il ne se passe pas trois pages sans que quelqu’un ne mette la bouilloire sur le feu. Par cette insistance même, Pym s’amuse en sourdine de ce rite essentiel de la sociabilité anglaise. Or on ne plaisante pas avec ces choses-là, comme la narratrice en fait l’expérience dans les dernières pages du livre.
Sans doute passe-t-on trop de temps à préparer du thé, me dis-je en observant miss Statham qui remplissait la lourde théière. Nous avions tous dîné, ou du moins nous étions censés avoir dîné et nous nous réunissions pour discuter de la vente de charité de Noël. Avions-nous réellement besoin d’une tasse de thé ? J’allai même jusqu’à poser la question à miss Statham qui me renvoya un regard offusqué, presque scandalisé.
— Si nous avons besoin de thé ? répéta-t-elle. Mais, miss Lathbury…
Elle semblait abasourdie et profondément affligée. Je compris que ma question avait touché là un point essentiel et profondément ancré. C’était le genre de question susceptible de semer le désordre dans un esprit.
Je marmonnai que ce n’était là qu’une plaisanterie : il allait de soi que nous avions toujours besoin d’une tasse de thé, à toute heure du jour ou de la nuit.
Barbara Pym, Des femmes remarquables
(Excellent Women, 1952).
Traduction de Sabine Porte.
Julliard, 1990, rééd. Belfond, 2017.

Noël
La perspective de téléphoner à sa femme, surtout pour lui parler de la réunion familiale de Noël, accrut sensiblement la dépression de Gerald.
Angus Wilson, Attitudes anglo-saxonnes
(Anglo-Saxon Attitudes, 1956). Traduction de Claude Elsen.
Stock, 1957. Rééd. 10/18, 1984.
— Oh ! Noël…
Viola soupira, car elle devait passer les vacances avec ses parents à Sydenham. Elle considérait comme son devoir d’aller les voir, tandis qu’eux, de leur côté, avaient le sentiment qu’ils se devaient de l’inviter, alors qu’ils auraient mille fois préféré être seuls. À Noël, pensa Dulcie, c’était comme si les gens perdaient leur statut d’individus de plein droit et, pour ainsi dire, diminuaient d’envergure, devenant de simples unités dans leurs familles, quand, le reste de l’année, ils étaient audacieux et originaux, et souvent des personnes qu’il était impossible d’imaginer rattachées à quelque chose d’aussi banal que des parents.
Barbara Pym, les Ingratitudes de l’amour
(No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff.
Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
La vie des colloques
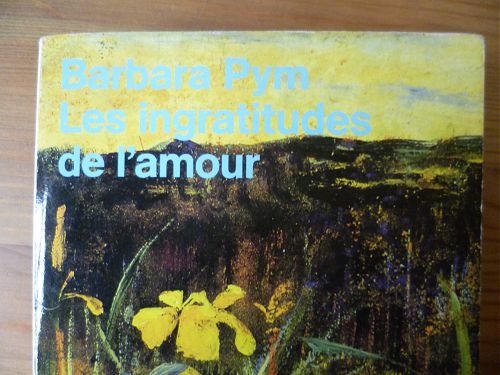
Il existe plusieurs façons de réparer un cœur brisé, mais se rendre à un colloque savant compte sans doute parmi les plus insolites.
Vingt-cinq ans avant Un tout petit monde de David Lodge, il y eut Barbara Pym. Les deux premiers chapitres des Ingratitudes de l’amour se déroulent dans un colloque de province, petit monde en vase clos où circulent les commérages, où se jaugent sans aménité les réputations, où se nouent des idylles. On y trouve en germe tout ce qui fera le sel des romans de Lodge et de tant d’autres campus novels.
Quoi de plus singulier qu’une foule de grandes personnes, la plupart d’un certain âge ou carrément âgées, rassemblées dans un pensionnat de jeunes filles du Derbyshire afin de débattre de subtilités savantes qui, pour la majorité des gens, ne signifiaient rien ? Même les chambres — par bonheur on n’allait pas les entasser dans des dortoirs — semblaient un peu irréelles, avec leurs lits jumeaux en fer et la perspective de passer plusieurs nuits si près de quelqu’un d’inconnu.
[…]
L’autre article important que contenaient ses bagages — le dossier de notes pour la conférence qu’il devait faire sur « Les problèmes d’un directeur de revue » — il le plaça sur la chaise à côté de son lit. […]
Les pas feutrés de la femme dépassèrent sa porte et s’arrêtèrent, lui sembla-t-il, à la chambre d’à côté. C’est alors qu’il se rappela qu’il s’agissait de Miss Faith Randall, conférencière comme lui. En imagination, il vit le titre de la conférence qu’elle allait donner : « Les problèmes de l’établissement d’un index ». Est-ce que toutes les interventions allaient traiter des « Problèmes de quelque chose » ?
Barbara Pym fut éduquée à Oxford. Elle gagna sa vie, trente ans durant, comme secrétaire de rédaction de la revue Africa, publiée par l’International African Institute. Elle se trouvait aux premières loges pour observer les travers du monde académique (voir par exemple Moins que des anges, qui présente un assortiment d’étudiants et de professeurs d’anthropologie diversement pittoresques) et son plus fin exégète français, René de Ceccaty, a pu rapprocher son regard de celui d’un ethnologue, « avec pour objet d’étude, non pas des tribus africaines, mais une assemblée d’intellectuels, de secrétaires frustrées, de vieillards passionnés ». Sa peinture de l’ennui de la vie de bureau, des mesquineries entre collègues, de l’attente impatiente de l’heure du thé sentent, comme on dit, le vécu (voir Jane et Prudence ou Quatuor d’automne). Et si David Lodge met en scène des universitaires flamboyants imbibés de déconstruction et de French theory (l’inoubliable Morris Zapp, dans Changement de décor et Un tout petit monde), Pym est le seul écrivain, à ma connaissance, à avoir élevé au rang d’héroïnes romanesques les « petites mains » de l’édition : relectrices d’épreuves, compilatrices de bibliographies et d’index de publications savantes… Métiers mal payés et peu considérés, donc généralement féminins, exercés par des fourmis invisibles vouées à des tâches ingrates et nécessaires, vivant par procuration dans l’ombre de leurs grands hommes qui récolteront seuls les lauriers de la gloire académique.
 Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
Cancans à l’heure du thé
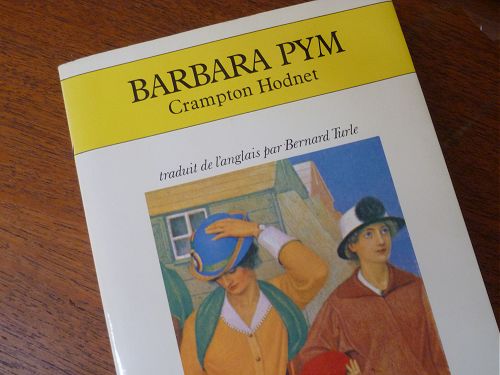
À l’instar de Molly Keane, Barbara Pym connut une curieuse carrière littéraire en deux temps : six romans publiés avec succès dans les années 1950, puis une traversée du désert de seize ans, ses manuscrits se voyant refusés par tous les éditeurs qui la jugeaient démodée ; enfin un come-back triomphal à la fin des années 1970, avec quatre nouveaux romans qui la consacrèrent outre-Manche comme « l’écrivain le plus sous-estimé de notre siècle ».
Pym est la quintessence de la romancière anglaise. Ses livres sont remplis de presbytères et de jardinets, de vicaires et de vieilles filles, de kermesses paroissiales et de ventes de charité, de sous-entendus perfides et de commérages échangés à l’heure du thé : utterly delightful, quoique les existences bornées qui sont dépeintes soient objectivement déprimantes. À côté de cette veine provinciale, un autre ensemble de ses romans se situe dans le landerneau universitaire (Moins que des anges, Une question purement académique), petit monde que Pym connaissait bien de par son travail de secrétaire de rédaction d’une revue d’anthropologie. Parfois, ces deux veines se croisent : ainsi dans Jane et Prudence, qui narre l’amitié d’une souris des villes et d’une souris des champs ; l’une, Prudence, secrétaire à Londres d’un savant professeur, et l’autre, Jane, femme d’un pasteur de village.
D’un roman à l’autre, la peinture de mœurs oscille entre l’humour en demi-teintes et le profond cafard (ainsi dans le déchirant Quatuor d’automne, qui narre les destins croisés de quatre collègues de bureau à la veille de la retraite). Pym excelle en particulier à instiller un sous-texte insidieux derrière l’insignifiance trompeuse des péripéties. Un motif récurrent : la liaison impossible entre personnes que sépare la différence d’âge ou d’orientation sexuelle, ou les deux : par exemple, l’attirance forcément sans espoir d’une quinquagénaire pour un jeune homosexuel dans La douce colombe est morte. René de Ceccaty parle à ce propos de l’« ambiguïté d’une sexualité abstraite et nécessairement insatisfaisante », un trait qui rapproche Pym de Henry James 1.
Crampton Hodnet, l’un de ses premiers romans, appartient à sa veine la plus légère. On y suit, à Oxford dans les années trente, le temps d’une année académique, les progrès en dents de scie de deux idylles inconvenantes qui font causer dans les chaumières : l’une entre un professeur quinquagénaire et son étudiante, l’autre entre un vicaire et une demoiselle de compagnie. On y observe avec amusement les rites sociaux d’une ville universitaire, aussi cancanière qu’un village de province. Lecture de fin d’année idéale, sous le plaid, la théière à portée de la main.
1 Jean Borie avait consacré un essai formidable au Célibataire français (Flaubert, Huysmans, les Goncourt). Il y aurait une étude comparable à écrire sur les écrivains célibataires anglais : Jane Austen, Henry James, Barbara Pym…
 Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.
Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.







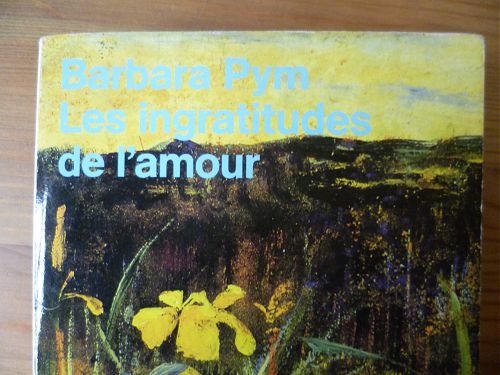
 Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.
Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.