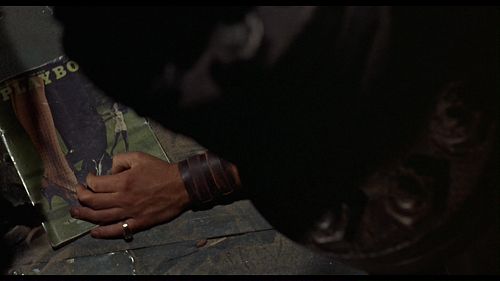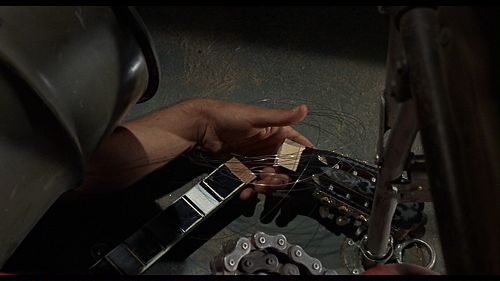La Part de l’ombre en salles

La Part de l’ombre d’Olivier Smolders sera projeté, en programme double avec la Légende dorée, le 24 avril à 20 heures à Liège, au Churchill, en présence du réalisateur.
Dix autres projections, en couplage avec Mort à Vignole, suivront en avril et mai au Churchill. Horaires ici.
Une projection aura également lieu à Bruxelles à la Cinémathèque, le 21 mai à 19h30, en présence d’Olivier Smolders.
La Part de l’ombre
Un film d’Olivier Smolders
Scénario : Olivier Smolders et Thierry Horguelin
Photographies : Jean-François Spricigo
Les Films du Scarabée et Yuzu Productions, 2013
28 minutes
L’image fantôme d’Oskar Benedek, par Tieri Briet.
Entretien avec Olivier Smolders.
Casa Boschi Di Stefano
J’ai un faible pour les musées-maisons, maisons d’artistes ou de collectionneurs. Il y en a quelques-uns à Milan : le museo Poldi Pezzolli et le museo Bagatti Valsecchi, deux demeures de riches collectionneurs du XIXe siècle, à l’opulence un peu écrasante. Le plus secret d’entre eux, à l’écart du centre, est l’appartement d’Antonio Boschi et Marieda Di Stefano. Je dois sa découverte inopinée à une aimable petite dame du Fondo Ambiante Italiano, rencontrée à Santa Maria presso San Satiro devant le trompe-l’œil de Bramante.
Il se trouve au deuxième étage d’un immeuble de la via Giorgio Jan dessiné par Piero Portaluppi — architecte auquel on doit le museo del Novocento et l’incroyable villa Necchi Campiglio, triomphe de la ligne claire des années 1930, qui mérite elle aussi la visite.







Antonio Boschi (1896-1988) et Marieda Di Stefano (1901-1968) se sont rencontrés en vacances en 1926 et mariés l’année suivante. Elle était céramiste et fille de collectionneur ; et lui, ingénieur. Boschi, si j’ai bien compris, fit fortune grâce au brevet d’une petite roue dentée appelée à jouer un rôle essentiel aux usines Pirelli — grâce à quoi les époux purent assouvir leur passion de collectionneurs. En quarante ans d’existence commune, ils acquirent pas moins de deux mille œuvres, tableaux, sculptures et dessins. Trois cents d’entre elles sont exposées dans leur appartement ; les autres ont rejoint les collections du museo del Novocento.
L’accrochage de la casa Boschi Di Stefano est chronologique. Il compose, pièce après pièce, un panorama de la peinture italienne des années 1910 aux années 1960. Savinio, Carrá, De Chirico, Morandi, De Pisis, Sironi, Fontana côtoient des artistes aux noms oubliés ou connus des seuls spécialistes de la période. Tout n’est pas d’égale valeur, mais l’on fait quelques découvertes 1 et c’est évidemment l’ensemble qui fait sens, et se charge d’une électricité supplémentaire d’être exposé dans le cadre de vie de ses propriétaires. On sent ici le contact vécu au quotidien avec des œuvres choisies et aimées, qui rend la visite d’autant plus émouvante.




1 Si j’avais pu emporter une toile sous le bras, ce n’est pas sur le grand Chirico (d’époque tardive et plutôt laid, il faut bien l’avouer) ni même sur un Morandi que j’aurais jeté mon dévolu, mais sur un adorable petit tableau de Renato Paresce, peintre inconnu de moi, Statua e scala (1929).

 Casa Boschi Di Stefano, 15 via Giorgio Jan, Milan. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures. Entrée libre.
Casa Boschi Di Stefano, 15 via Giorgio Jan, Milan. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures. Entrée libre.
Thèmes et variations

Renchérissons sur l’Éditeur singulier : l’exposition Piero Fornasetti est un enchantement. Les mille pièces présentées témoignent de la prolixité dont fit preuve ce peintre-imprimeur-designer-décorateur milanais, à la fois éclectique et monomane dans la déclinaison obstinée de certains motifs de prédilection dont il habillait les objets du quotidien avec une fantaisie inépuisable : foulards et vêtements, rideaux, papier peint et carreaux de faïence, chaises, lampes, buffets et paravents, vaisselle et plateaux, corbeilles et porte-parapluies, et même des bicyclettes… Thèmes et variations, ce fut la grande affaire de ce créateur multiforme doublé d’un archiviste et collectionneur obsessionnel, qui puisait l’inspiration dans le monde naturel (soleil et lune, fruits, fleurs, poissons, chats, papillons, minéraux et coquillages), le monde de l’imprimé (livres et journaux, jeux de cartes, étiquettes de vin), l’architecture antique, les personnages de la commedia dell’arte, les figures mythologiques ; sans oublier le visage de la courtisane Lina Cavalieri réinventé plus de cinq cents fois sur des assiettes, des théières et des vases. Les traits d’humour abondent, alliés au goût du trompe-l’œil : cravates à motifs de nœuds papillons, porte-journaux déguisés en cartables, store vénitien dont les pales fermées font apparaître une façade aux cent fenêtres. Le décor proliférant de ses intérieurs est un antidote euphorisant au minimalisme chic qui est devenu le grand poncif du design contemporain.










Fornasetti et son store doublement vénitien :
la façade reproduite provient de la place Saint-Marc.
 Piero Fornasetti, la folie pratique. Au musée des Arts décoratifs de Paris, jusqu’au 14 juin.
Piero Fornasetti, la folie pratique. Au musée des Arts décoratifs de Paris, jusqu’au 14 juin.
La marche brisée

Grosse déception devant The 39 Steps, qui fait salle comble au Criterion Theatre depuis quelques années. La pièce adapte le film d’Alfred Hitchcock bien plus que le roman original de John Buchan — lequel était le premier à reconnaître la supériorité narrative du film sur son livre. On apprécie le tour de force (quatre comédiens interprétant une quarantaine de rôles), les trouvailles astucieuses de la mise en scène pour figurer les changements rapides de lieux, les déplacements ferroviaires au moyen d’un train miniature, les scènes en extérieur, voire même des champs-contrechamps ; en somme, pour suggérer, au sein d’un espace scénique, un espace cinématographique. On regrette le jeu souvent outré des comédiens, qui tire le spectacle vers la parodie sans finesse en cherchant les rires faciles du public.
Approche et tue un président !

Assassins, sur un livret de John Weidman, est l’un des concept musicals les plus radicaux de Stephen Sondheim. Il s’agit d’une revue grinçante évoquant neuf tentatives d’assassinat, couronnées ou non de succès, sur la personne de présidents américains, d’Abraham Lincoln à Ronald Reagan. Comme d’autres Sondheim (Company, Merrily We Roll Along), la construction est non-chronologique. L’action se déroule dans un espace-temps imaginaire — l’antichambre des Enfers ? — où les candidats meurtriers de toutes les époques se croisent, s’apostrophent, s’encouragent ou s’invectivent. Le décor de ce carnaval macabre est une baraque de tir forain. Deux maîtres de jeu : un forain sinistre et un ménestrel, lequel endossera par la suite le rôle de Lee Harvey Oswald. En ouverture, le forain interpelle les meurtriers putatifs en tendant à chacun un revolver. Et de chanter en substance : « Eh toi ? Ta vie est un échec ? Tu n’as pas de travail, ta petite amie t’a lâchée ? Tu ne sais pas quoi faire ? Approche et tue un président ! » Entendre par la suite le chœur des meurtriers entonner gaiement Everybody’s Got the Right to their Dreams éclaire soudain d’un autre jour le droit proclamé de chacun à la poursuite du bonheur.
C’est bien entendu de cela qu’il est question dans Assassins : les ratés du rêve américain, le sentiment de rage et de frustration qu’il engendre chez ses laissés-pour-compte, la culture des armes à feu — au-delà des meurtres de présidents, impossible de ne pas penser à cet autre sport national que sont les tueries de masse dans les collèges et les supermarchés. Tout cela est si évident que Weidman et Sondheim se gardent de surligner le propos. Loin du didactisme plat qui plombe tant de pièces de théâtre contemporaines dès qu’elles s’emparent d’un sujet dit « de société », ils jouent la carte d’un humour noir autrement plus inconfortable, qui n’exclut ni la réflexion sur la violence dans l’Histoire, ni çà et là un étrange fond de mélancolie. Les aspirants assassins sont suivant les cas des illuminés atteints de la folie des grandeurs, des sociopathes tristes, de purs exaltés, des bras cassés (Sara Jane Moore, aussi gaffeuse et maladroite que sa cible, le président Gerald Ford). Un seul d’entre eux, l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz, obéit à des mobiles politiques un tant soit peu articulés. Sur le fil du rasoir, Weidman et Sondheim examinent leurs motivations avec une finesse qui évite les poncifs de la psychosociologie de comptoir.
Assassins date de 1990. Sa carrière off Broadway fut brève. Outre que le sujet en est peu aimable, le déclenchement de la première guerre du Golfe, au milieu des représentations, compromit ses chances de succès. D’aucuns firent au spectacle un procès en antipatriotisme de mauvais goût. Par la suite, le show fut remonté à Broadway et Londres, toujours pour de courtes séries de représentations. Sa nouvelle reprise à la Menier Chocolate Factory de Londres est tout bonnement époustouflante. La densité de l’ouvrage (1 h 45 sans entracte), le lieu même de la représentation — une ancienne chocolaterie comme son nom l’indique, devenue restau-bar-galerie, avec petite salle de théâtre de deux cents places en sous-sol, aux murs de béton brut —, le dispositif scénique à l’élisabéthaine où les spectateurs sont assis de part et d’autre d’une aire de jeu centrale, presque le nez sur les comédiens : tout s’accorde au propos du spectacle et concourt à son intensité. La mise en scène dynamique de Jamie Lloyd, la scénographie de Soutra Gilmour et les chorégraphies précises de Chris Bailey abondent en trouvailles de détail. Par exemple, ces enseignes de baraque de tir « Hit » and « Miss » qui s’allument suivant que la tentative d’assassinat a réussi ou échoué. En cas de succès, une petite pluie de tickets rouges de foire tombe doucement sur la tête du meurtrier. Et lorsque Oswald touchera le jackpot à Dallas, c’est un véritable déluge de tickets qui noiera la scène. Effets visuels et sonores parcimonieux mais percutants, qui rendent impressionnantes les exécutions de Charles Guiteau et Giuseppe Zangara. Le tout est porté par la belle énergie d’une troupe si soudée qu’il est presque impossible d’isoler une performance. Tout de même, on a été épaté par le charisme de Simon Lipkin, Michael Xavier et Andy Nyman, l’abattage comique d’Anna Francolini et Carly Bawden.
Assassins n’est sans doute pas la partition la plus éclatante de Sondheim. On n’en admire pas moins comme toujours son invention langagière (privilégiant les mots courts, les réitérations, l’antithèse et la paronomase), son goût du pastiche et des citations déguisées (chaque chanson adopte le style musical de l’époque où elle est située), sa science des dissonances calculées, des chansons-conversations et des chorals entrelacés — d’autant plus que cette virtuosité, loin d’être gratuite, est toujours au service des personnages et de l’impact émotionnel des situations.
P.-S. : Assassins est le cinquième musical de Sondheim repris en dix ans à la Menier Chocolate Factory. On a pu voir l’an dernier, brièvement disponible en streaming, une captation de leur Merrily We Roll Along (mise en scène de Maria Friedman), filmée au Harold Pinter Theatre où le show s’était transporté. Une autre grande réussite, à ne pas louper si d’aventure elle ressurgit sur le net.

L’esprit de famille



The Flight of the Phoenix (1965) de Robert Aldrich vient à peine de commencer que le vieux coucou piloté par James Stewart, secoué dans une tempête de sable, s’écrase au cœur du Sahara en faisant deux victimes : William Aldrich et Peter Bravos, soit le fils et le gendre du cinéaste ! Pour ajouter à l’humour noir, ils meurent écrabouillés moins d’une minute après avoir été dûment mentionnés au générique, sur le même pied que les vedettes du film (outre Stewart : Richard Attenborough, Hardy Krüger, Peter Finch, Ernest Borgnine, Dan Duryea, George Kennedy, Christian Marquand, etc.) C’est un peu comme si Aldrich moquait le népotisme bien connu du monde du cinéma : oui, j’emploie mes proches comme tout le monde, mais moi je m’en débarrasse dès la première bobine ! En outre, ledit générique parodie par anticipation celui des films catastrophes du genre Airport et leur casting all-star, qui fleuriront quelques années plus tard (en fait, tout le film peut se voir comme une critique anticipée du cinéma catastrophe). Humour et clin d’œil familial à part, tout Aldrich est présent dans ces quelques minutes : ruptures de ton, esthétique du paroxysme, dynamitage des genres et de leurs conventions. Et si The Flight of the Phoenix est sans conteste un film mineur au sein d’une filmographie riche en chefs-d’œuvre, il est passionnant de voir le cinéaste y malaxer quelques-uns de ses thèmes de prédilection : les conditions de survie d’un groupe affrontant une situation-limite, les tensions et les rapports de force au sein de ce groupe, la monomanie poussée jusqu’à la folie et au délire de grandeur (Krüger), l’ambiguïté des conduites d’héroïsme. Le moment où Stewart et Attenborough découvrent le « secret » de Krüger (j’essaie de ne rien révéler) est stupéfiant.
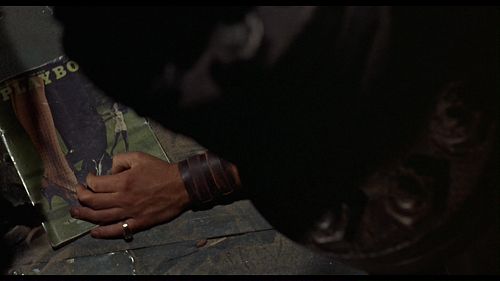
William Aldrich…
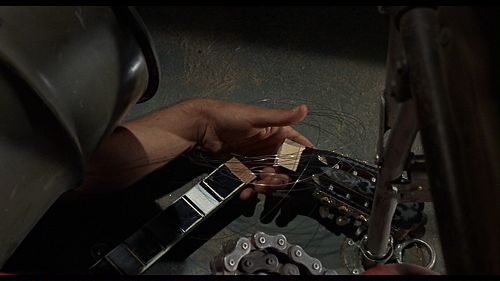
… et Peter Bravos, ou ce qu’il en reste après dix minutes de projection.
On a eu la curiosité d’en savoir plus sur le fiston. William Aldrich, nous apprend IMDB, tint des petits rôles dans quatre films de son père et occupa la fonction de producteur associé sur quatre autres. Producteur exécutif de The Sheltering Sky de Bertolucci, il produisit également les remakes de The Flight of the Phoenix et What Ever Happened to Baby Jane ?
High Time

High Time de Blake Edwards (1960). Quoique réalisé après des films complètement edwardsiens comme Mister Cory et Operation Petticoat, cette comédie de campus servant de véhicule à Bing Crosby sent la commande de studio. Le scénario et le dialogue sont bien nunuches, les gags (souvent plus tashliniens qu’edwardsiens 1) pas toujours drôles. Mais Edwards s’acquitte avec compétence de la tâche, et sa patte est au moins sensible à trois niveaux : 1. Élégance formelle : sûreté du cadre et du découpage, dynamisme des plans à figuration nombreuse, contraste entre la vitalité estudiantine et le statisme du monde des adultes. 2. Un tact réel dans les scènes sentimentales entre Crosby et la prof de français (Nicole Maurey), qui évitent la mièvrerie de mise dans ce genre de comédie (on pense aux relations Julie Andrews-Omar Sharif dans cette petite merveille qu’est The Tamarin Seed). 3. Une scène de travesti : déguiser Bing Crosby en dondon en robe rose, il fallait oser ! Et Crosby, il faut le dire, se tire remarquablement d’affaire en la circonstance.
1 De façon générale, l’influence du cartoon se fait sentir sur la comédie américaine des années 1950-1960, chez les réalisateurs de la nouvelle génération comme chez les vétérans (par exemple Leo McCarey dans Rally Round the Flag, Boys !).