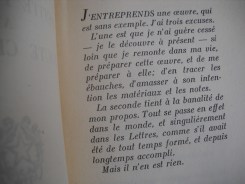Libre promenade
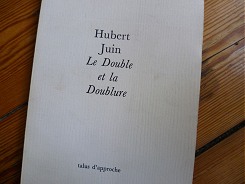
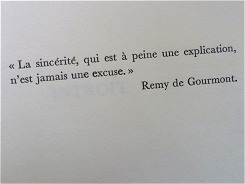
La veille, Christian Bourgois et moi avions couru quelques librairies, feuilletant d’incroyables gravures et des tirages rares. L’amour des livres est qu’il y a en nous de plus subtil et de plus tenace. Un livre, cela se dévore et se hume, c’est un parfum qui est une nourriture, une odeur qui est un incendie. […]
Il conviendrait de s’interroger sur la singulière union de l’absence et de la permanence, de la mémoire et de l’oubli, puis, d’une façon générale, sur le peuplement des terres, les mécanismes de la lecture, le rangement des livres, l’invention des images, les libertinages de la raison, les incertitudes du réel et les perversions du songe.
On est heureux d’avoir mis la main sur ce livre d’Hubert Juin, paru en 1981 au Talus d’approche dans une maquette de Pierre Faucheux. Livre inclassable, on aurait dit autrefois : recueil de mélanges, où s’entrelacent inextricablement le réel et l’imaginaire, l’autobiographie réinventée et l’essai. Juin s’adonne à un libre vagabondage dans sa bibliothèque et ses lectures, qui étaient colossales ; ranime les images d’une enfance rurale à Athus, où se cristallisa déjà son rapport aux livres, au langage et à la poésie ; s’invente un double, Théodore, sans doute en souvenir du bibliophile de Nodier, ou bien se met en scène écumant les bouquinistes en compagnie de Christian Bourgois. On va des grilles de mots croisés de Robert Scipion à Patrice de la Tour du Pin, en passant par Ovide, Pic de la Mirandole et Pierre Louÿs, sans oublier Feuillet de Conches qu’on ne connaissait pas (1798-1887, érudit et collectionneur, auteur de Causeries d’un curieux). La promenade réveille à chaque coin de rue le fantôme des écrivains aimés. Ailleurs, Juin écrivait en substance qu’une bibliothèque n’est jamais immobile ; elle est vivante et peuplée, et se modifie du même pas que nous. Ce livre en fait l’illustration.
Un festin de Caradec


La Quinzaine littéraire nous apprend, sous la plume de l’excellent Jean-Paul Goujon1, la parution d’un gros recueil d’articles de François Caradec, que complètent des entretiens. Près de mille pages où se déploient l’éventail des curiosités d’un insatiable lecteur à l’érudition aussi précise que légère : les figures littéraires hors normes, le dessin d’humour et la bande dessinée, les farces et les mystifications littéraires, le music-hall et le café-concert, la langue argotique et populaire, sans oublier le monde du livre, des imprimeurs aux typographes et des éditeurs aux libraires (lui-même avait débuté comme ouvrier typographe). C’est un sacré défilé : Allais, Cami, Sade, Lautréamont, Jarry, Roussel, Willy, Paul Masson, Georges Auriol, Léo Malet, Leiris et Queneau, André Blavier et Boris Vian, Töpffer, Christophe, Descloseaux et Forest, Pauvert, Losfeld et Robert Carlier, l’Oulipo et le Collège de ’Pataphysique. Derrière la variété des sujets, « une grande unité de vision et de goûts, aiguillonnée par une curiosité incessante », écrit justement Goujon. De quoi enchanter les longues soirées d’hiver.
 François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.
François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.
1. À l’instar de Caradec à qui l’on doit tant de travaux pionniers, Goujon a signé de passionnantes biographies de Léon-Paul Fargue, Jean de Tinan et Pierre Louÿs. De ce dernier dont il est un des plus fins connaisseurs, il a édité nombre d’écrits inédits et de correspondances (avec son frère Georges, Tinan, Hérédia, Marie de Régnier), en plus de réunir l’édition la plus complète de ses œuvres érotiques. Il est aussi l’auteur d’une anthologie de la poésie érotique française.
Visages de l’ombre


Plus vif que le plaisir de recevoir par la poste un livre qu’on attendait, il y a celui d’en recevoir un qu’on n’attendait pas. C’est ainsi qu’est arrivé inopinément le nouveau numéro du Visage vert — joie, bonheur et félicité. Au sommaire : E.F. Benson, John Buchan, Paul Busson, Jean Des Roches, Paul Frank, Judith Gautier, Rhys Hughes, Cristián Vila Riquelme, Jessica Amanda Salmonson et Romain Verger — soit, comme toujours, des auteurs d’hier et d’aujourd’hui, des qu’on a lus, des qu’on ne connaît que de nom, et d’autres dont on ne soupçonnait même pas l’existence — et des titres qui font rêver : « la Fleur-serpent », « la Corne d’épouvante », « la Pierre qui fume », « la Femme qui avait épousé un phoque ». Avec, pour fil rouge, les présences cachées au sein de la nature : monstres marins, créatures préhumaines, végétaux assoiffés de vengeance, esprits menaçants des forêts, des lacs et des montagnes.
Ce sera mon prochain festin, dès que j’aurai fini les lectures en cours, le Cardinal Napellus de Gustav Meyrinck (FMR, « La Bibliothèque de Babel »), lequel me séduit bien davantage dans le format condensé de la nouvelle que dans ses romans proliférants ; et puis l’Angoisse de la première phrase de Bernard Quiriny (Phébus), le premier et peut-être le meilleur livre de son auteur, en tout cas mon préféré tant qu’à présent : comme dans les Contes carnivores qui ont suivi, on oscille entre Borges et Marcel Aymé, on croise à tous les coins de rue l’ubiquiste et protéiforme Pierre Gould, Bartleby littéraire qui est un peu le Pierre Ménard de Quiriny, et il y a une nouvelle en particulier, « la Ville à l’infini », que je suis atrocement jaloux de n’avoir pas écrite à la place de son auteur.
Hawks, Faulkner, Trauner et les autres au travail

Dans notre série « les livres qu’on a depuis vingt ans dans sa bibliothèque et qu’on se décide enfin à lire », Hollywood-sur-Nil se révèle à la hauteur de sa réputation. Il s’agit bien d’un des récits de tournage les plus drôles jamais écrits.
Peintre de formation, Noël Howard a débuté après la deuxième guerre comme décorateur de vitrines de grands magasins avant d’aboutir tout à fait par hasard dans le cinéma. Parfait bilingue, il fait la navette entre la France et les États-Unis, devient conseiller historique pour des productions situées dans un cadre français (depuis la Jeanne d’Arc de Victor Fleming jusqu’aux Trois Mousquetaires de George Sidney), puis assistant metteur en scène et réalisateur de seconde équipe. Hollywood-sur-Nil fait revivre une période charnière de l’histoire d’Hollywood. Grisé par les recettes records engrangées dans l’immédiat après-guerre, le système des studios l’ignore encore, mais il vit déjà la fin de son âge d’or, pour des raisons bien connues : lois anti-trusts obligeant les Majors à se défaire de leurs parcs de salles, chasse aux sorcières, et concurrence croissante de la télévision. Les studios contre-attaquent par une surenchère dans le bigger than life. C’est l’avènement du CinémaScope, et le retour en grâce des superproductions à grand déploiement situées dans l’Antiquité. C’est aussi le temps de la délocalisation des tournages en Europe, pour une double raison économique : les coûts de production y sont moins élevés, et les dépenses permettent d’amortir des capitaux désormais gelés sur place. Et c’est ainsi qu’un jour d’été sur une plage de la Côte d’Azur, après s’être fait indiquer la direction de l’Égypte, Howard Hawks déclare soudain à Noël Howard, le regard tourné vers la Méditerranée : « Noooël, je vais construire une pyramide. »
Pour comprendre comment l’idée initiale d’un film sur la construction d’un aéroport en Chine durant la guerre, motivée par une seule raison : tourner en CinémaScope (format que Hawks détestera pour finir, tout comme Lang1), s’est transformée en projet de fresque pharaonesque vendu en quelques heures à Jack Warner au bord d’une piscine, il faudra lire le récit chaleureux et spirituel de Noël Howard. On y trouvera de précieux portraits au naturel de Sydney Chaplin et surtout de Robert Capa, avec lesquels Howard menait à Paris une joyeuse vie de patachon. On y vivra quelques soirées très arrosées en compagnie du sympathique Gene Kelly et de sa bande. On y apprendra pourquoi il est plus avantageux d’être cascadeur qu’acteur à Hollywood. On y verra s’agiter des directeurs de production aussi colériques qu’incompétents. On y suivra l’astucieux Alexandre Trauner au travail. On y assistera au tournage d’une superproduction dans le chaos et l’impréparation la plus complète, pendant que le scénario s’écrit au jour le jour. On y mesurera la difficulté de diriger dix mille figurants dont on ne parle pas la langue, et plus encore quelques taureaux rétifs à toute instruction. On y croisera en coup de vent Hemingway, Jacques Prévert et l’extravagante Kay Kendall, qui eut le temps d’illuminer de son alliage unique de raffinement et de fibre clownesque les Girls de Cukor et le merveilleux The Reluctant Debutante de Minnelli (quand se décidera-t-on à rééditer ce petit bijou ?), avant d’être emportée par la leucémie à l’âge de trente-deux ans. On y verra surtout Howard Hawks, flegmatique et mythomane imperturbable, raconter des histoires à dormir debout dont il est toujours le héros, blinder ses nerfs au golf, user d’une élocution extraordinairement lente ponctuée de silences infinis comme d’une arme de négociation redoutable, retarder un voyage de quelques jours pour pouvoir voler en jet, perspective qui l’excite comme un gamin, et manquer pour une rare fois de perdre son sang-froid en apprenant de son conseiller historique qu’il n’y avait ni chevaux ni chameaux en Égypte au temps de la construction des pyramides : « Je vous propose un marché, j’abandonne les chevaux. Mais Noël, pour l’amour de Dieu, laissez-moi les chameaux ! »
1. Lang : « Le CinémaScope n’est bon qu’à filmer les enterrements et les serpents.»
 Noël Howard, Hollywood-sur-Nil, Fayard, 1978, rééd. Ramsay Poche Cinéma, 1986, 2008.
Noël Howard, Hollywood-sur-Nil, Fayard, 1978, rééd. Ramsay Poche Cinéma, 1986, 2008.
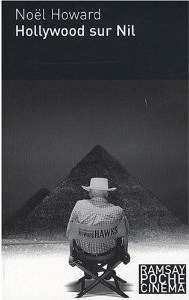
Sociologie du design

 Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.
Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.
 Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.
Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

In cauda venenum
Paulhan derechef, et sa brièveté légendaire. À partir de mars 1937, la Nouvelle Revue française proposa à la fin de chaque livraison un bulletin des événements, des livres et des spectacles. La rubrique était tantôt anonyme et tantôt signée Jean Guérin — alias Paulhan lui-même, qui avait comme on sait le goût du secret, des masques et de la mystification1. La concision lapidaire de ces brèves et leur ironie à froid doivent beaucoup, ce me semble, à notre cher Fénéon, auquel Paulhan consacrera en 1943 un essai fondamental, F.F. ou le Critique (repris cinq ans plus tard en préface à un volume d’Œuvres de Fénéon ; réédité en 1998 par Claire Paulhan, cette femme admirable, avec un important dossier critique).
Comme chez l’auteur des « Nouvelles en trois lignes », un fait parfaitement épinglé, en l’absence apparente de tout commentaire, devient en soi un commentaire. Par exemple dans cette brève, qui date de septembre 1937 :
Berlin. On fête la vente du trois millionième exemplaire de Mein Kampf, qui est en Allemagne le plus répandu des cadeaux de noces.
Et, comme Fénéon (voir ici), Paulhan est passé maître dans l’art de la dernière petite phrase assassine :
La mythologie pour tous, le donjuanisme petit-bourgeois, la philosophie première, l’apothéose d’un immonde crémier, ce sont autant de sujets que Jean Dutourd traite, dans un style élégant, avec éclat, abondance, désinvolture. Avec succès. Et quoi de plus ? On souhaite timidement qu’il ait un jour quelque chose à dire qui lui tienne à cœur.
Mais ce qui a rappelé Jean Guérin à mon bon souvenir, c’est ce « Bulletin » publié dans la livraison d’août 1938 de la N.R.F. (premier numéro paru après les accords de Munich), et reproduit en annexe à la correspondance Leiris-Paulhan (Claire Paulhan, 2000) dont j’achève la lecture. C’est un pense-bête pour se rappeler qu’il serait grand temps d’acquérir le choix des chroniques de Guérin proposé en deux volumes aux éditions des Cendres.
LES ÉVÉNEMENTS
Leningrad. Du 21 au 28 septembre, interdiction de prier pour la paix (d’après l’Osservatore romano).
Munich. Par les accords de Munich, la paix est sauvée. La paix dans ce qu’elle a de plus plat et de plus périssable.
Paris. Les tailleurs répandent le slogan : la paix nous donnant la joie de vivre, l’on s’habillera en clair cet hiver.
Paris. Il est question d’élever un monument à la Tchéco-Slovaquie martyre. L’on peut douter si les Tchèques attendaient de nous tant de prix et de statues.
Leipzig. L’une des nouvelles rues de Leipzig s’appelle Rue des Sudètes. Une autre Rue de la Sarre. Une autre encore Rue d’Alsace.
Berlin. Tout Israélite, porteur d’un prénom aryen, s’appellera dorénavant Israël, ou Sarah.
LES LIVRES
E. LUDWIG : la Nouvelle Sainte-Alliance (N.R.F.). — C’est l’alliance que formeraient les trois démocraties de l’Angleterre, de la France et des États-Unis. M. Ludwig nous assure qu’elle empêcherait à jamais la guerre. Peut-être.
SPECTACLES
AU THÉÂTRE SAINT-GEORGES : Duo, de Paul Géraldy. — Du roman manqué mais « nature » de Mme Colette, Paul Géraldy a tiré trois actes brillants, en trompe-l’œil. C’est un civet transformé en soufflé.
1. En fait, il semble que ce soit plus compliqué et que jusqu’à 1953, le pseudonyme ait servi parfois à d’autres auteurs. Quoi qu’il en soit, les extraits proposés ci-dessus portent incontestablement la griffe (c’est le cas de le dire) de Paulhan.
Un des noms de l’attention

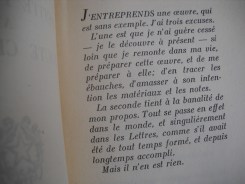
Édition originale (Minuit, 1951), acquise au Port de tête pour une dizaine d’euros. Paulhan a passé sa vie à semer des bombes à retardement, sous la forme de textes brefs, intempestifs, d’apparence limpide, et dont le sens pourtant mystérieusement se dérobe au moment où l’on croit s’en saisir. On avance en confiance, bercé par le ton aimable et modéré, les hésitations et les repentirs feints d’un causeur de bonne compagnie ; on ne voit rien venir et puis c’est trop tard : ce diable d’homme a retourné quelques vérités premières comme des gants et vous a tiré le tapis de sous les pieds.
L’ironie est sa seconde nature. Dans Petite Préface à toute critique, elle s’insinue dès l’avant-propos, qui annonce « trois excuses à ce livre », mais n’en formule que deux. (Fausse distraction : la troisième surviendra quelques chapitres plus loin.) En une centaine de pages, Paulhan se collette une fois encore avec son cher sujet, celui qu’il n’a cessé de triturer en l’envisageant chaque fois sous un angle différent, de Jacob Cow le pirate aux Fleurs de Tarbes : les équivoques du langage, le rapport problématique du mot et de l’idée, du signe et de la chose signifiée. Il le fait à sa manière sinueuse mais sûre, comme un chat matois qui fait patte de velours — mais la griffe est au bout. (Sartre en fait notablement les frais.)
[…] Car le poète ou le prosateur ne compose pas son œuvre sans se régler sur certains choix ou préférences, qui forment à la longue la raison et comme l’armature secrète du poème ou du roman. Tantôt les choix sont préparés de longue date, et tantôt subits. Mais que ce soit en dix ans ou en deux heures, la grande part du travail d’un auteur se passe en repentirs et retours, corrections, vérifications, retouches. D’un mot, en critiques — ai-je dit secrètes ? Elles ne le sont guère en tout cas de nos jours, où l’on ne trouve point de création qui ne se double d’un système critique. Observez plutôt Valéry, Proust, Gide, Claudel, Joyce, Breton, Sartre, et les autres : une bonne moitié de leur œuvre se dépense à prouver qu’ils ont eu raison d’écrire l’autre moitié.
[…] Or nous n’arrêtons guère plus haut d’évaluer les opinions, les propos, les événements mêmes, qui viennent à notre portée — et les hommes du même coup. Qui prononce sur la question sociale et la situation politique, ou décide seulement si le fond de l’air est chaud ou froid, fait de la critique, comme il fait de la prose, sans le savoir. Ce qu’on appelle penser, c’est à tout moment choisir, jauger, distinguer le vrai du faux et le valable du médiocre. Critique est l’un des noms de l’attention.
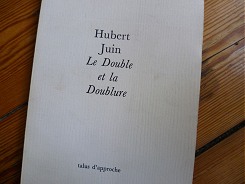
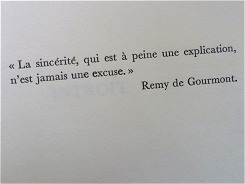








 François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.
François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.


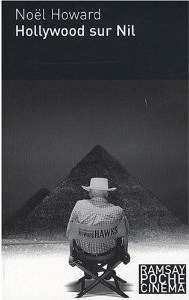

 Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.
Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.