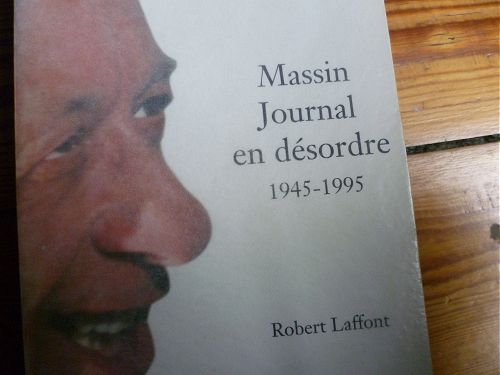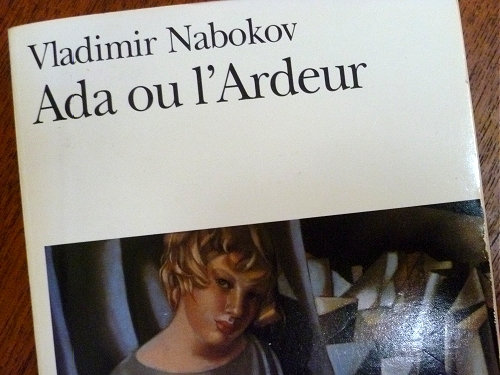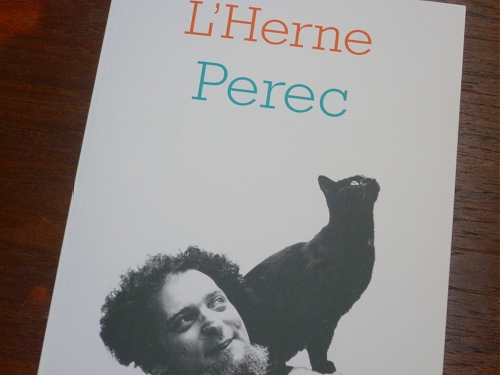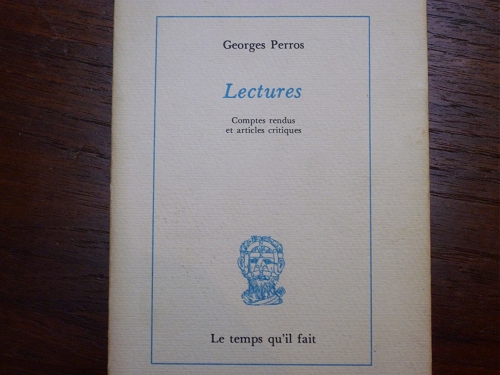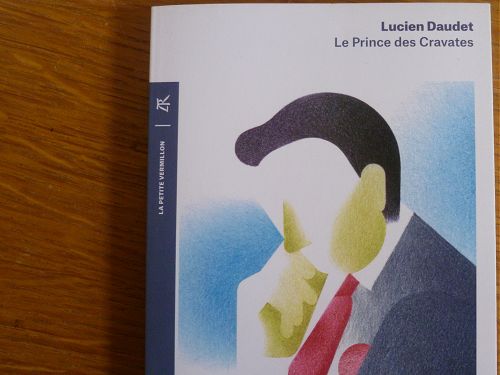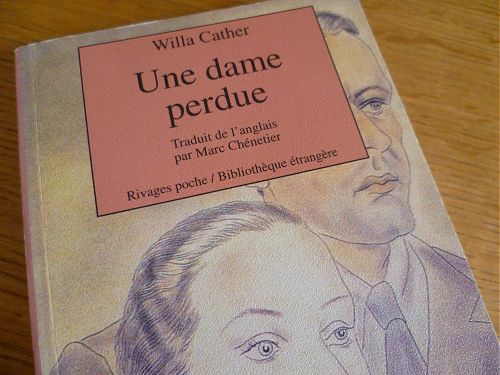Massin dans le désordre
Il y a à boire et à manger dans le gros Journal en désordre de Massin, pêle-mêle de souvenirs, d’anecdotes, de rencontres, de curiosités, d’aphorismes et de considérations sur l’air du temps. L’auteur nous amuse et nous instruit souvent, nous agace ou nous ennuie parfois ; c’est le lot de ce genre de livre. Il nous intéresse certainement davantage lorsqu’il parle de l’art de l’affiche, ou de la pratique de la photographie par Hugo et Zola, que lorsqu’il étale ses conquêtes féminines. Mais qu’on le lise dans l’ordre en sautant les longueurs ou qu’on y butine au hasard, on y trouvera de quoi faire son miel. Tout ce qui touche à l’histoire de l’écriture et du livre est évidemment de premier intérêt. On découvre aussi que le maquettiste-typographe a non seulement un œil hors pair mais l’oreille aux aguets, aussi bien pour épingler des tics de langage que pour parler de musique – des baroques à Schönberg –, Massin, en plus d’être lecteur, cinéphile et amateur d’art, se révélant mélomane et, par-dessus tout peut-être, épris de correspondances entre les arts.
Deux extraits presque au hasard, un court et un long ; on pourrait en citer bien d’autres.
Le lendemain du jour où j’ai montré à Claude Gallimard les prémaquettes de la collection «Folio», la plupart des «commerciaux» de la maison (des garçons jeunes, intelligents, cultivés) sont venus me voir l’un après l’autre pour me dire :
« Ce que tu as fait est très bien, c’est élégant…
— Mais ?
— Ça ne se vendra pas. »
*
J’ai rendez-vous avec Ionesco à mon bureau. (Nous nous connaissons à peine, à cette époque.) Or, promenant mon chien sur le boulevard du Montparnasse, je le vois qui sort de chez lui et s’apprête à monter dans un taxi. Je le hèle, il m’aperçoit :
« Excusez-moi, je suis pressé, j’ai rendez-vous avec Massin chez Gallimard. »
Une autre fois, c’était quelques années plus tard, nouvelle rencontre au même endroit, et au petit matin. Je le vois qui attend un autobus; puis regarder de tous les côtés, alors qu’il fait à peine jour, car on est en hiver, et les rues sont désertes. Il fait mine de chercher un taxi ; il hésite ; enfin, lentement, il descend les marches du métro Vavin ; et l’instant d’après, il refait surface en remontant de la station, de l’autre côté du boulevard ; d’un pas tranquille, il emprunte le passage pour piétons, et c’est alors seulement que je me découvre :
« Que cherchez-vous donc, Eugène ?
— Un taxi, mais il n’y en a pas. Des autobus, il n’y en a pas non plus. Quant au métro, c’est une autre histoire. (Il rit.) Je ne sais plus comment faire pour le prendre.
— Où allez-vous ?
— À Béziers, où l’on m’attend.
— Vous allez à Béziers.
— Oui, mais je n’y vais pas.
— Comment cela ?
— C’est-à-dire que je n’ai pas envie d’y aller.
— Eh bien ! n’y allez pas.
— Non, parce que ce ne serait pas bien. Le libraire a tout préparé, des invitations, des affiches, retenu une salle, que sais-je encore ? Alors, je fais semblant d’y aller. »
Nouveau rire.
Il me donne l’heure de son train à la gare de Lyon.
« Voyons, Eugène, votre train part dans cinq minutes. Quoi que vous fassiez, il est trop tard.
— Oui, mais j’y vais quand même. »
Puis il me quitte et se décide enfin à prendre le métro.
Et le voilà parti, pour aller rater son train.
Massin, Journal en désordre (1945-1995). Robert Laffont, 1996.
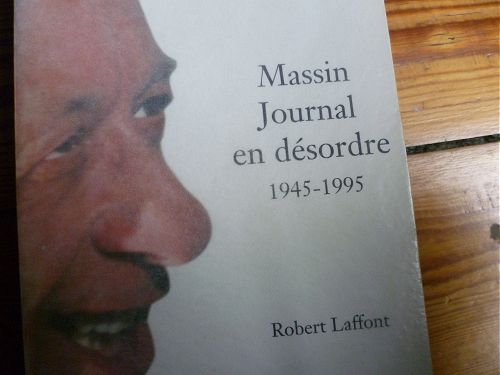
Le détail qui cloche
Hommage, souvenir involontaire ou pure coïncidence ? Voici un moment hitchcockien dans un roman qui ne l’est aucunement.
Dès le lendemain matin, et tous les jours suivants, Objat a entrepris d’arpenter la région, s’étant procuré des cartes IGN au 1/25 000e. Quelque chose lui disant que Constance, disparue de la ferme sans laisser aucune trace de sa présence, ne pouvait pas se trouver très loin, il a systématiquement exploré le périmètre, voie par voie, écart par écart, pendant près d’une semaine, cochant ces lieux l’un après l’autre, sans aucun résultat. Jusqu’au moment où ces investigations lui ont paru vaines, qu’il n’a pas été loin de se décourager – ni de se demander comment il allait expliquer les choses au général Bourgeaud.
Jusqu’au moment où, passant pour la dixième fois sur une départementale dont il avait prospecté chaque dérivation, il a longé un vaste pré au fond duquel, déjà, sa vision périphérique avait enregistré un champ d’éoliennes alignées, tournant paisiblement. Mais un déclic a dû se produire cette fois dans son organisation perceptive, comme la prise de conscience floue d’un détail qui clochait, car il a soudain freiné, s’est arrêté, repartant en marche arrière jusqu’à stopper encore en plein milieu de la route à hauteur de ces aérogénérateurs dont il a considéré plus attentivement le tableau, sous un beau soleil d’arrière-saison. Il lui a fallu peu de temps pour constater que l’hélice d’une des éoliennes tournait en sens inverse des autres et, à nouveau, il a souri.
Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Minuit, 2016.
Impossible de ne pas penser à la scène de Foreign Correspondent d’Hitchcock, située aux Pays-Bas, où Joel McCrea remarque un moulin dont les ailes tournent dans le sens contraire de la direction du vent – signal adressé à un avion espion. Motif hitchcockien par excellence du détail qui cloche, de l’anomalie qui fait accroc dans une réalité jusque-là stable et désigne la présence du mal au cœur de l’ordre naturel. C’est le grand mouvement d’appareil qui va isoler tout au fond de la salle de danse, comme on épingle un papillon, le visage du batteur de l’orchestre affecté d’un clignement anormal des yeux (Young and Innocent). C’est le point rouge d’une cigarette grésillant dans un appartement plongé dans l’obscurité, qui accuse l’assassin (Rear Window). C’est l’avion anodin survolant le désert dans North by Northwest, petit point qui grossit dans le ciel, jusqu’à ce que quelqu’un remarque : « C’est curieux, voilà un avion qui sulfate des cultures, et pourtant il n’y a pas de cultures. »
D’où l’importance, pour Hitchcock, d’établir fermement au préalable le caractère conventionnel et rassurant de la réalité. L’un de ses trucs préférés, on le sait, consiste à recourir sans vergogne aux clichés touristiques nationaux. En Suisse, ils font du chocolat, alors le repaire des espions sera une chocolaterie (Secret Agent). Aux Pays-Bas, il y a des moulins et, confie Hitchcock à Truffaut, si Foreign Correspondent avait été filmé en couleur, il aurait ajouté une scène de meurtre dans un champ de tulipes qui se serait conclue par des gouttes de sang tombant sur des fleurs rouges. Et qu’est-ce que North by Northwest, sinon un travelogue nous baladant dans un certain nombre de lieux emblématiques des États-Unis, depuis le siège de l’ONU à New York jusqu’aux têtes géantes du mont Rushmore, en passant par une maison à la Frank Lloyd Wright ?
Je me demande si Joe Dante ne s’est pas souvenu de la leçon hitchcockienne dans la scène de la cuisine de Gremlins où les diablotins verts attaquent sauvagement une mère de famille. Quoi de plus rassurant, de plus domestique qu’une cuisine ? Mais voici que les appareils électroménagers, le grille-pain, le broyeur à légumes, le couteau électrique, se changent en instruments de mort, comme l’avion sulfateur de North by Northwest. Le confort du foyer se retourne contre lui-même.

Foreign Correspondent
À l’aventure
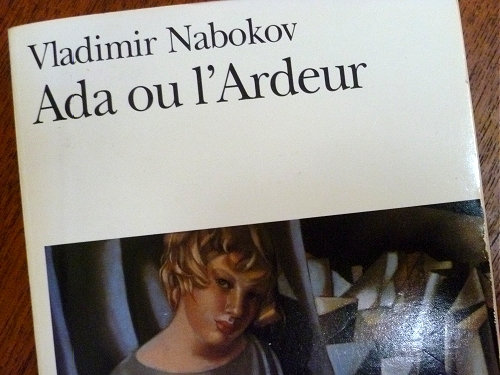
On l’a reconnu dès les premières pages, ce petit frisson dans l’échine qui vous avertit que ce ne sera pas un livre comme les autres ; que sa lecture sera une aventure où tout peut arriver – non seulement aux personnages, mais à la forme romanesque elle-même. Ada ou l’Ardeur est la dernière œuvre majeure de Nabokov, celle pour laquelle il voulait que la postérité se souvienne de lui. On sent qu’il ne s’est rien refusé. Le roman se présente comme une parodie de saga familiale à la russe, écrite dans un style volontairement entortillé où abondent les crochets, les détours, les parenthèses digressives. C’est, en outre, un festival intertextuel : Tolstoï cité dès le premier paragraphe (un peu plus loin : Jane Austen, Marcel Proust…), appareil critique fictif dû à une certaine Vivian Darkbloom (anagramme de Vladimir Nabokov). Bien. On croit avoir identifié le code de lecture, on se cale dans les rails, on ressent la gourmandise narrative de Nabokov, on partage sa jubilation. Mais l’aventure ne fait que commencer. Car voici qu’une deuxième couche apparaît entre les lignes. Elle nous murmure qu’Ada est en fait un roman de science-fiction situé dans une réalité parallèle, variante extravagante de la nôtre. Et, bien entendu, pour les habitants de cet alter-monde, c’est leur réalité qui est la vraie, et la nôtre une version parallèle, étrange et défectueuse. On n’en est qu’au dixième de ce gros roman. Quelles surprises nous attendent encore ?
G. P. et G. P.
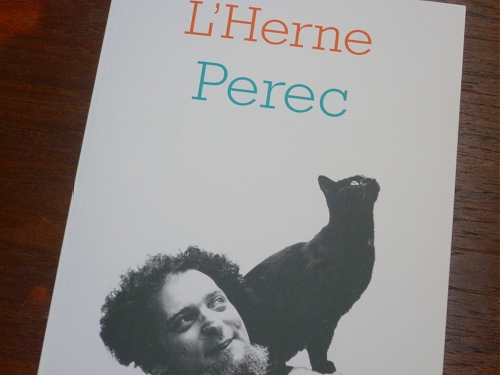
Les Cahiers de l’Herne consacrent leur dernière livraison à Georges Perec, et c’est justice. Au sommaire, des études, des témoignages, des entretiens. Et puis un copieux ensemble de textes de Perec, inédits ou peu accessibles : une BD entreprise avec son condisciple Bernard Quilliet pour tromper l’ennui des cours d’hypokhâgne, un manuscrit de jeunesse longtemps égaré (Manderre), des lettres adressées à divers correspondants, des textes liés au projet de la Ligne générale ; et enfin, des notes de lecture parues dans la Nouvelle Revue française. Et là, pataquès. Les éditeurs ont confondu deux G. P., et certaines recensions sont en réalité de Georges Perros, comme en fait foi le recueil de notes et notules de Perros paru en 1981 au Temps qu’il fait. Au demeurant, les deux G. P. avaient des centres d’intérêt, une appréhension de la littérature et des styles si éloignés que la différence saute aux yeux.
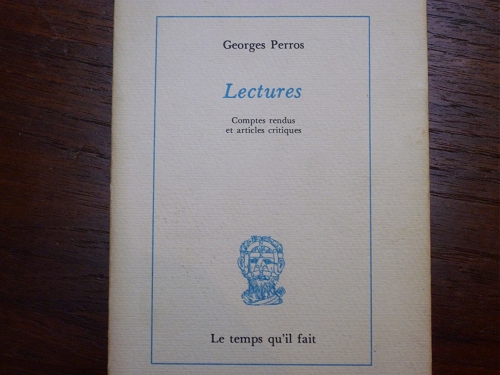
Prénom Lucien
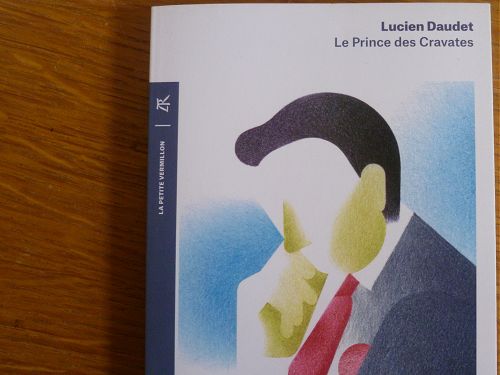
On doit à Jean-Christophe Napias l’exhumation d’Eugène Marsan, la publication des chroniques de Pierre de Régnier, la remise en circulation du premier livre de Patrick Mauriès devenu introuvable, une anthologie des droodles de Roger Price. C’est dire si cet homme est précieux, et si l’on a acquis de confiance la réédition du Prince des cravates procurée par ses soins. On n’a pas été déçu.
Lucien Daudet est un malchanceux de la littérature. Écrasé par un patronyme illustre, il est de ces figures toujours citées par référence à autrui : fils d’Alphonse et frère du redoutable Léon, ami de Proust et de Cocteau. Le seul de ses livres couramment disponible, comme par un fait exprès, est un choix de lettres de Proust. Au demeurant, ce modeste touche-à-tout (il s’essaya à la peinture avant d’opter pour la littérature) désira rester un amateur à l’écart des intrigues qui assurent le succès littéraire. Son œuvre compte une quinzaine de livres : des romans et des nouvelles, des souvenirs et des biographies (il était toqué de l’impératrice Eugénie) ; mais aussi, plus singulièrement, un recueil de lettres imaginaires, ainsi que des poèmes en prose d’inspiration moderniste parus après la Première Guerre, qui témoignent d’un complet renouvellement de sa manière.
Parue en 1908 dans le Mercure de France, le Prince des cravates est une nouvelle délectable. Son argument ténu aurait pu inspirer Jean de Tinan. Invité à séjourner chez un lord ami de son père, dans les environs de Londres, un jeune gandin fort satisfait de sa personne entreprend, par pure vanité, de séduire l’épouse de son hôte. Il faut dire qu’elle est beaucoup plus jeune que ce dernier, se prénomme Guanhamara et répand un entêtant parfum de rose. En un peu moins de cinquante pages, Daudet se révèle aussi discret satiriste des mondanités que fin psychologue de l’émoi amoureux. Doté d’un trait rapide et sûr, il sait choisir l’adjectif inattendu qui épingle un personnage ou suggère un caractère : voici « une baronne coûteuse et divorcée », un jeune homme « très bien relié dans un vêtement délicieusement gris ». Parce que le récit se déroule en Angleterre et que Daudet a le sens de l’understatement ironique, on songe, pour l’ambiance, à certaines nouvelles de Max Beerbohm, voire même de Cyril Connolly.
Cette édition est chapeautée d’une préface impeccable qui nous rend le personnage Lucien Daudet diablement attachant. Elle s’accompagne d’un dossier comprenant une fort utile bibliographie commentée, deux articles de Proust sur Daudet et un autre de Daudet sur Proust.

Lucien Daudet, le Prince des cravates. La Table ronde, « La Petite Vermillon », 2016, 109 pages.

Lucien Daudet vers 1910
Un monde complet
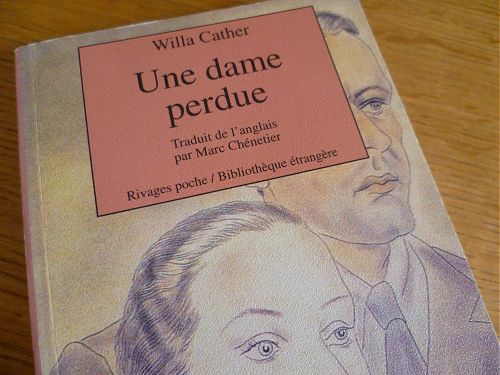
Apogée et déclin de Marian Forrester, mariée à un homme nettement plus âgé qu’elle, qui fut un pionnier de la construction des chemins de fer de l’Ouest américain. À Sweet Water, le ménage Forrester jouit d’un prestige enviable. La demeure du couple, perchée sur une colline dominant le village, est le point de ralliement de la bonne société locale, objet d’admiration, plus tard de convoitise. Belle et troublante, alliant à une grâce rayonnante un sens inné de l’hospitalité, Marian règne calmement sur ce petit monde, adorée de tous, secrètement aimée de certains. Au rang de ses admirateurs discrets figure Niel Herbert, dont on fait la connaissance petit garçon, qu’on retrouve plus tard jeune homme intègre et sérieux, après son retour de la grande ville où il a fait ses études. Bien que le récit soit écrit à la troisième personne, presque tout y est vu par les yeux de Niel, et ce point de vue décentré ajoute une touche jamesienne à la narration : importance des non-dits, des regards échangés, des secrets surpris par inadvertance, qui bouleverseront l’image que se faisait Niel de Marian Forrester, cette image première liée pour lui au paradis perdu de l’enfance. Le jugement de Niel procède par nuances et corrections successives ; mais au bout du compte, et c’est ce qui fait la beauté de ce portrait de femme, Marian conservera jusqu’à la fin quelque chose d’insaisissable.
Willa Cather est de ces romancières qui savent, en deux cents pages, vous donner l’impression d’entrer dans un monde complet, saisi dans ses vibrations les plus intimes comme dans ses dehors les plus larges. Les personnages d’Une dame perdue appartiennent à un microcosme social, qui a ses rites et ses usages, sa hiérarchie de classes. Ils sont aussi inscrits dans un espace et une durée. Autour du village, il y a des paysages, une faune et une flore ; au-delà, des villes et la vaste étendue d’un pays. Plus large que la vie quotidienne, il y a le cycle des saisons, le passage du temps, le renouvellement des générations. La destinée malheureuse de Marian Forrester coïncide avec un changement d’époque : l’ère héroïque (et quelque peu idéalisée) des pionniers de l’Ouest cède inexorablement le pas à l’âge ingrat de l’exploitation capitaliste. Cather nous fait profondément sentir tout cela à la fois.
 Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
La femme aux deux visages
— C’est vrai, dit-elle, il y a deux femmes en moi…
— Oui, reprit-il distraitement… deux femmes qui se combattent… et qui, par moments, s’excluent l’une l’autre… deux femmes qui n’ont pas le même sourire. Car c’est le sourire qui diffère dans tes deux images… tantôt naïf et jeune, avec des coins de bouche relevés… et tantôt plus amer et comme désabusé.
— Laquelle aimes-tu le mieux, Raoul ?
La Femme aux deux sourires
La femme, chez Maurice Leblanc, est double. Dans la Comtesse de Cagliostro, récit fondateur de la jeunesse de Lupin, Raoul d’Andrésy oscille entre un amour fleur bleue pour sa cousine Clarisse d’Étigues et un amour-passion dévastateur pour la maléfique et magnifique Joséphine Balsamo. Ce motif, avec des variantes, des atténuations, des déplacements, circule dans toute l’œuvre de Leblanc.
Deux femmes, Régine, actrice, et Arlette, mannequin, partagent l’aventure de Jean d’Enneris dans la Demeure mystérieuse. Deux sœurs, Elizabeth et Rolande, sont mêlées au drame de La Cagliostro se venge. Il y a deux cousines dans l’Aiguille creuse, Suzanne de Gesvres et Raymonde de Saint-Véran, qui sera le grand amour de Lupin. Deux sœurs à nouveau dans la Barre-y-va, Bertrande et Catherine, entre lesquelles balance le cœur de Raoul d’Avenac :
Au fond, peut-être les aimait-il toutes deux, et, en les aimant toutes deux, l’une si pure et si ingénue, l’autre si tourmentée et si complexe, peut-être n’aimait-il qu’une seule et même femme, qui était, sous deux formes différentes, la femme de l’aventure à laquelle il consacrait toutes ses forces et toutes ses pensées.
Une seule et même femme en deux incarnations qui tour à tour se confondent et se distinguent : voilà résumé le tropisme amoureux de Lupin. Il reparaît dans la Femme aux deux sourires, sous la forme de deux demi-sœurs prises l’une pour l’autre, Antonine, la petite provinciale ingénue, et Clara, l’aventurière ardente et tourmentée. Lupin aimera l’une à travers l’image de l’autre 1, le souvenir inoubliable de sa première apparition — exemple singulier, finement analysé par Leblanc, de cristallisation amoureuse.
Deux femmes encore dans la Demoiselle aux yeux verts : l’Anglaise aux yeux bleus, Constance Bakefield, lady cambrioleuse de haut vol, l’émule féminine de Lupin, qui eût fait un adversaire admirable (on croit d’abord que le roman prendra ce chemin) si elle n’avait la mauvaise idée de périr assassinée à la fin du premier chapitre ; et Aurélie, la blonde aux yeux verts, nouvel avatar de l’innocence persécutée 2. Mais voici qu’Aurélie se dédouble à son tour, devient multiple, insaisissable :
Raoul n’en revenait pas. Cela dépassait tout ce qu’il avait pu imaginer à propos de la demoiselle aux yeux de jade. […] Il ne se lassait pas d’admirer l’étrange créature qu’il n’avait aperçue, depuis la jolie vision initiale, que par éclairs et en des crises d’horreur et d’effroi. C’était une autre femme, chez qui tout prenait caractère d’allégresse et d’harmonie. Et c’était pourtant bien celle qui avait tué et participé aux crimes et aux infamies. C’était bien la complice de Guillaume.
De ces deux images, si différentes, laquelle devait-on considérer comme la véritable ? Raoul observait en vain, car une troisième femme se superposait aux autres et les unissait dans une même vie intense et attendrissante […]
Les deux grands types féminins de la geste lupinienne — la victime innocente, l’aventurière mêlée à des crimes de son plein gré ou à son corps défendant — ressortissent à des stéréotypes de roman-feuilleton. L’originalité de Leblanc est de les avoir fondus en un seul. Son incarnation la plus stupéfiante sera, dans 813, ce monstre formidable qu’est Dolorès Kesselbach.
1 L’image, littéralement. Avant même qu’il la rencontre en chair et en os, Antonine apparaît à Lupin sur l’écran d’un très moderne visiophone, lorsqu’elle sonne par erreur à son appartement. Lupin, en somme, s’éprend d’une image avant de s’éprendre d’une femme, et c’est cette image-écran qui l’empêchera longtemps d’appréhender la vérité.
Notons en passant l’intérêt précurseur de Leblanc pour le cinéma : le Film révélateur, dans les Huit Coups de l’horloge (1923), est peut-être le premier exemple, dans le domaine français, d’emploi du cinéma comme pivot narratif d’un récit de fiction.
2 Cette figure a toujours partie liée avec un secret d’enfance, tantôt oublié, tantôt inavouable (la Barre-y-va, la Demoiselle aux yeux verts, la Femme aux deux sourires).