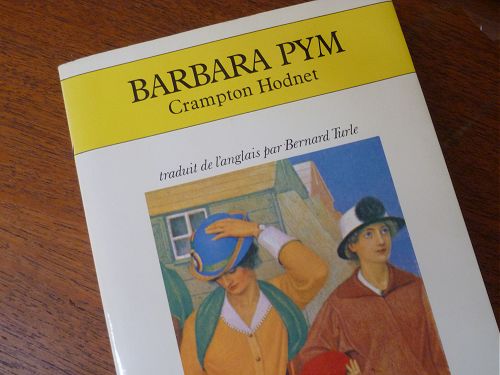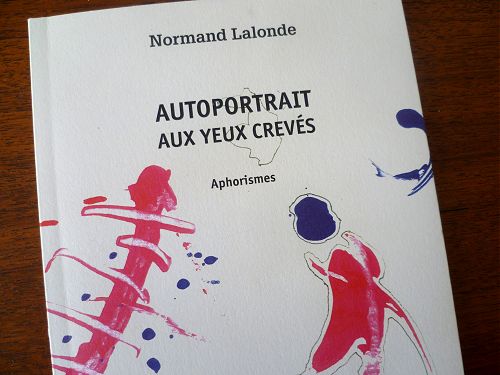Le singe sanglant
Balaoo. Toujours, chez Gaston Leroux, cette vivacité de l’écriture, cette fièvre narratrice qui vous emportent. Balaoo constitue à certains égards une version simiesque du Fantôme de l’opéra et de la Poupée sanglante. Ces romans mettent en scène trois figures de parias aux marges de l’humanité : le défiguré, l’anthropopithèque, l’automate, amoureux sans espoir d’une blanche et pure créature qu’ils veulent ravir à la société des hommes, et dont l’amour déchaîne la pulsion meurtrière : tantôt par jalousie, tantôt pour protéger l’objet de leur passion. Balaoo et la poupée sanglante sont deux presque humains, traqués comme des bêtes. D’où le thème récurrent (sans blabla pontifiant, ce n’est pas le genre de la maison) de l’humanité de l’animal (ou de l’automate) opposée à la monstruosité de l’espèce humaine. Figure concomitante, celle du savant fou et démiurge raté.
 Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.
Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.
La chasse aux papillons
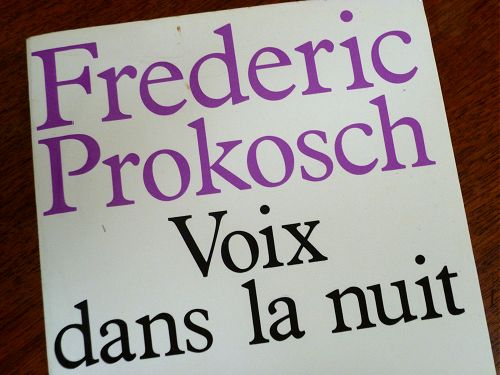
Frederic Prokosch (1908-1989) fut l’écrivain cosmopolite par excellence. Né dans le Wisconsin de parents autrichiens, il vécut entre les États-Unis et plusieurs pays d’Europe, s’adonna passionnément à la chasse aux papillons à l’instar de Nabokov, tâta de l’édition à petit tirage, remporta un championnat de squash à Paris, passa à tort pour un agent secret en Suède avant d’exercer brièvement, pour de vrai, cette activité en Espagne. En 1935, la parution de son premier roman, les Asiatiques, lui valut un succès d’estime qui lui ouvrit les portes du monde artistique et littéraire. C’est bien simple, il a rencontré tout le monde et ses mémoires, publiés à la fin de sa vie, composent une incroyable galerie de portraits : Alice Toklas et Gertrud Stein, Joyce et Pound, T. S. Eliot et William Auden, Gide et Colette, Karen Blixen, Norman Douglas, Peggy Guggenheim, Virginia Woolf, Giorgio De Chirico, Hemingway, Cyril Connolly, Sinclair Lewis, Malaparte, Malraux, les trois Sitwell, Nabokov, Somerset Maugham, Thomas Beechan, Hannah Arendt, Dylan Thomas, Edmund Wilson et l’on en passe.
Les premiers chapitres de Voix dans la nuit raniment les premières impressions de l’enfance : escapades solitaires le long des rivières et sur les collines du Wisconsin, visites chez ses parents de « célébrités » en la personne de Thomas Mann et de la danseuse Anna Pavlova. On est d’emblée conquis par le talent de prosateur de Prokosch, écrivain aux antennes ultra-sensibles qui sait admirablement restituer le frémissement d’un paysage, la vibration impalpable d’une ambiance. Qualités qui se retrouvent dans la suite du livre, où la plupart des chapitres s’articulent autour d’une rencontre avec chacun des personnages cités plus haut. Prokosch n’a pas son pareil pour épingler une silhouette comme il épinglait ses papillons, faire entendre la voix, le phrasé, le ton de la conversation de ses interlocuteurs, saisir pour ainsi dire l’aura, le rayonnement de leur personnalité.
Il s’est murmuré que le mémorialiste avait pris quelques libertés avec ses souvenirs et qu’il y entrait une bonne part de reconstruction a posteriori, sinon de pure imagination. À vrai dire, on s’en doute un peu à la lecture. Il est manifeste que tel récit de rencontre en condense plusieurs afin de lui conférer un surcroît d’intensité, que la chronologie a été aménagée pour donner au livre la courbe parfaite d’un itinéraire ; et l’on sourit de ce que Prokosch semble incapable de tourner un coin de rue sans tomber par hasard sur un grand écrivain. Néanmoins, ces portraits sont criants de justesse et le livre rend un accent de vérité essentielle, celui d’une vie réinventée par la littérature.
 Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.
Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.
Trollope par lui-même
Que je puisse lire et être heureux en lisant, c’est pour moi une grande bénédiction. Aurais-je pu me rappeler, comme d’autres, ce que je lisais, j’aurais pu me dire instruit. Mais je n’ai jamais possédé cette faculté. Quelque chose subsiste toujours — quelque chose de vague et d’imprécis, mais tout de même suffisant pour me conserver le goût de continuer. J’incline à croire qu’il en va ainsi pour la plupart des lecteurs.
Anthony Trollope, Autobiographie (An Autobiography).
Traduction de Guillaume Villeneuve.
Aubier, « Domaine anglais », 1994.
 Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
C’est à l’âge de dix-neuf ans, après une enfance pénible (déboires familiaux ; scolarité très malheureuse), que Trollope décroche un emploi modeste à la Grand Poste de Londres. À force de culot, d’abord, puis d’assiduité et de détermination, il parviendra à s’élever dans la hiérarchie jusqu’au grade d’inspecteur. Ces nouvelles fonctions lui vaudront d’être affecté en divers coins d’Irlande et d’Angleterre, puis de voyager en tournée d’inspection aux quatre coins de l’Empire britannique. Au passage, il mettra sur pied quelques réformes utiles destinées à améliorer la distribution du courrier : on lui doit notamment l’installation des fameuses boîtes aux lettres rouges, toujours en usage au Royaume-Uni. La quarantaine venue, il écrit et publie son premier roman, sans éveiller grand écho. Il lui faudra dix ans pour connaître le succès et devenir un des romanciers les plus lus de l’ère victorienne.
Si Trollope a entrepris, à la toute fin de sa vie, de rédiger son autobiographie professionnelle, c’est entre autres choses pour être utile aux jeunes aspirants romanciers. Il y va donc de ses conseils de vieux routier, ce qui nous vaut des remarques intéressantes sur la narration, la construction des personnages et l’art du dialogue. Il y insiste à plusieurs reprises, il fait peu de cas de l’inspiration et ne croit qu’à la régularité du travail. Lui-même s’astreignait à une discipline de fer en écrivant dix pages par jour en toute circonstance, qu’il se trouve à domicile ou en déplacement inconfortable pour une de ses tournées d’inspection postale. S’il terminait un roman au cours d’une de ses séances d’écriture quotidiennes, il commençait le suivant dans la foulée, pour remplir son quota de dix pages.
Dans le même ordre d’idées, il détaille par le menu ses négociations avec les éditeurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et va jusqu’à fournir, en fin de volume, la liste complète de ses œuvres avec en regard le montant des droits d’auteur perçus pour chacun de ses livres. On pourra froncer les sourcils et juger qu’il s’agit là d’une attitude de petit boutiquier ; mais on pourra tout au contraire trouver cette approche des plus rafraîchissante, en regard du cliché romantique de l’artiste travaillant pour la gloire dans sa tour d’ivoire, qui avait cours en son temps et n’a pas disparu de nos jours.
Trollope considère son travail avec un mélange d’orgueil pour sa réussite et de modestie (il se dépeint comme un artisan en se plaçant sur le même pied qu’un ébéniste ou un cordonnier). S’il n’est pas toujours tendre avec ses confrères dont il discute dans un chapitre les mérites et les faiblesses, c’est avec le même détachement lucide qu’il analyse les qualités et les défauts de ses propres livres, ne dissimulant pas plus ses ratages que ses réussites. Au surplus, il ne se fait aucune illusion quant au sort que la postérité réservera à son œuvre aussitôt qu’il aura quitté ce monde.
La postérité, en l’occurrence, lui a joué un tour à sa façon. Il y a deux manières pour un écrivain de tomber dans l’oubli. La première est de n’avoir connu aucun succès de son vivant : inconnu vous étiez, négligé vous serez. La seconde est d’avoir eu trop de succès, si bien que la génération suivante de lecteurs vous remise illico au grenier comme une chose poussiéreuse, au même titre que les meubles et les vêtements démodés de ses parents. C’est cette aventure qui est arrivée à Trollope, dont le purgatoire aura duré trois bons quarts de siècle, avant sa réhabilitation au premier rang des écrivains victoriens.
Anthony Trollope dans Locus Solus

Installée à Guernesey vers 1852 sur la recommandation d’Anthony Trollope, une des plus anciennes boîtes aux lettres encore en service au Royaume-Uni.
Cancans à l’heure du thé
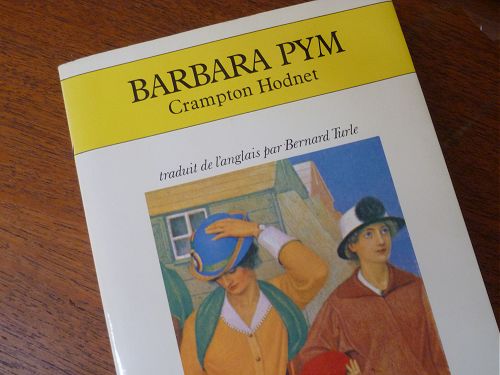
À l’instar de Molly Keane, Barbara Pym connut une curieuse carrière littéraire en deux temps : six romans publiés avec succès dans les années 1950, puis une traversée du désert de seize ans, ses manuscrits se voyant refusés par tous les éditeurs qui la jugeaient démodée ; enfin un come-back triomphal à la fin des années 1970, avec quatre nouveaux romans qui la consacrèrent outre-Manche comme « l’écrivain le plus sous-estimé de notre siècle ».
Pym est la quintessence de la romancière anglaise. Ses livres sont remplis de presbytères et de jardinets, de vicaires et de vieilles filles, de kermesses paroissiales et de ventes de charité, de sous-entendus perfides et de commérages échangés à l’heure du thé : utterly delightful, quoique les existences bornées qui sont dépeintes soient objectivement déprimantes. À côté de cette veine provinciale, un autre ensemble de ses romans se situe dans le landerneau universitaire (Moins que des anges, Une question purement académique), petit monde que Pym connaissait bien de par son travail de secrétaire de rédaction d’une revue d’anthropologie. Parfois, ces deux veines se croisent : ainsi dans Jane et Prudence, qui narre l’amitié d’une souris des villes et d’une souris des champs ; l’une, Prudence, secrétaire à Londres d’un savant professeur, et l’autre, Jane, femme d’un pasteur de village.
D’un roman à l’autre, la peinture de mœurs oscille entre l’humour en demi-teintes et le profond cafard (ainsi dans le déchirant Quatuor d’automne, qui narre les destins croisés de quatre collègues de bureau à la veille de la retraite). Pym excelle en particulier à instiller un sous-texte insidieux derrière l’insignifiance trompeuse des péripéties. Un motif récurrent : la liaison impossible entre personnes que sépare la différence d’âge ou d’orientation sexuelle, ou les deux : par exemple, l’attirance forcément sans espoir d’une quinquagénaire pour un jeune homosexuel dans La douce colombe est morte. René de Ceccaty parle à ce propos de l’« ambiguïté d’une sexualité abstraite et nécessairement insatisfaisante », un trait qui rapproche Pym de Henry James 1.
Crampton Hodnet, l’un de ses premiers romans, appartient à sa veine la plus légère. On y suit, à Oxford dans les années trente, le temps d’une année académique, les progrès en dents de scie de deux idylles inconvenantes qui font causer dans les chaumières : l’une entre un professeur quinquagénaire et son étudiante, l’autre entre un vicaire et une demoiselle de compagnie. On y observe avec amusement les rites sociaux d’une ville universitaire, aussi cancanière qu’un village de province. Lecture de fin d’année idéale, sous le plaid, la théière à portée de la main.
1 Jean Borie avait consacré un essai formidable au Célibataire français (Flaubert, Huysmans, les Goncourt). Il y aurait une étude comparable à écrire sur les écrivains célibataires anglais : Jane Austen, Henry James, Barbara Pym…
 Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.
Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.
Les fantômes du muet

Didier Blonde est l’auteur d’un essai intitulé les Voleurs de visages. Sur quelques cas troublants de changements d’identité : Rocambole, Arsène Lupin, Fantômas et Cie. Il a également publié plusieurs livres sur des figures négligées du cinéma muet. Ces deux motifs s’entrelacent dans Faire le mort.
C’est un roman-enquête à la Modiano mêlant la réalité historique et l’affabulation, plein de recherches dans des annuaires obsolètes et des collections de revues jaunies, de déambulations dans un Paris fantôme où la ville d’hier continue de hanter la ville d’aujourd’hui. Passionné de cinéma muet 1, le narrateur fréquente assidument la Cinémathèque. Il y met en œuvre, comme spectateur, une pratique méthodique de l’attention flottante. Indifférent aux intrigues, ce sont les détails insignifiants, les arrière-plans qui le retiennent et stimulent sa rêverie : le geste d’une figurante, le trajet silencieux d’une voiture, un accessoire à peine visible au fond du décor, un jardin aperçu par une fenêtre – tout ce que la caméra enregistre à son insu sans lui assigner de fonction narrative précise et qui pourtant raconte en secret une autre histoire.
C’est ainsi qu’un soir, revoyant pour la énième fois le Fantômas de Feuillade, le narrateur est frappé par une anomalie. Les yeux, perçant la cagoule du génie du crime, ne sont pas ceux de son interprète René Navarre. Alors, à qui appartiennent-ils ? Navarre, absent du plateau le jour où l’on a tourné la scène, s’est-il fait remplacer par une doublure ? Et voilà notre narrateur désœuvré lancé sur la piste ténue de ce figurant à identités multiples, qui s’appelait peut-être Sudor ou peut-être Louis Manekine.
On n’en dévoilera pas davantage. On ajoutera seulement que ce narrateur sans nom est lui-même un caméléon. Employé comme nègre dans une maison d’édition, il se moule dans la personnalité des autres, en prêtant sa plume à des célébrités de troisième ordre dont il est chargé de rédiger les mémoires. Mis au chômage technique au début du roman, sans amitiés ni relations connues, il se dépouille progressivement de son peu d’épaisseur sociale. Plus il s’absorbe dans l’élucidation des énigmes du passé et plus il se vide de sa substance – à l’image de son appartement qui se déleste peu à peu des livres qu’il revend pour assurer sa subsistance.
1 Didier Blonde suggère que cette passion a partie liée avec la nostalgie de l’enfance et la figure d’un père évanescent. C’est finement esquissé, sans s’appesantir, sans psychanalyse de comptoir.
 Didier BLONDE, Faire le mort, Gallimard, 2001, 132 pages.
Didier BLONDE, Faire le mort, Gallimard, 2001, 132 pages.
Les petites flèches de Normand Lalonde
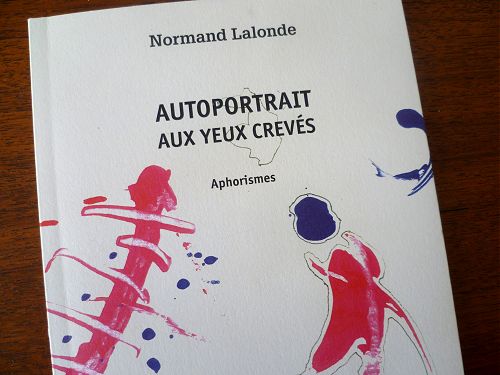
En 1988, Normand Lalonde consacrait un mémoire de maîtrise aux Bibliothèques de Bouvard et Pécuchet. Un ami me recommanda la lecture de ce travail vif, plein d’aperçus stimulants (il y était question notamment de l’imaginaire des bibliothèques dans la littérature française du XIXe siècle, avec des excursus sur les collections de livres de Jean des Esseintes et du capitaine Nemo) ; essai si peu académique que son directeur d’études, m’a-t-on dit, dut ferrailler pour le faire accepter par le jury, et pourtant voilà un mémoire qui apportait du neuf tout en se signalant par ses qualités d’écriture. Les deux clercs de Flaubert furent derechef le sujet de la thèse de doctorat de Lalonde, Flaubert et la faute du temps. Éternité, évolution et origine dans Bouvard et Pécuchet (celle-là, je ne l’ai pas lue). Par la suite, il devint professeur de littérature et de cinéma au Collège de Maisonneuve. En 2007, il fut diagnostiqué d’une tumeur au cerveau. Il est mort le 1er juillet 2012, à l’âge de cinquante-deux ans.
Nous avions plusieurs relations communes, j’aurais aimé le rencontrer, les hasards de l’existence en ont décidé autrement. La lecture d’Autoportrait aux yeux crevés ne fait qu’aviver ce regret. Ce précieux petit livre réunit un choix de ses aphorismes, écrits durant les cinq dernières années de sa vie. La maladie, l’hôpital, la certitude de la mort proche sont évidemment très présents en ces pages, mais ils sont traités avec un humour noir, un détachement stoïque qui laissent pantois. Le détachement de soi, la juste distance me semblent du reste la qualité principale du regard de Normand Lalonde, qu’il considère le monde et ses petites vanités ou qu’il s’observe lui-même, sujet vivant, sujet pensant, sujet écrivant. On ne s’étonnera pas non plus que cet amoureux de Bouvard et Pécuchet soit des plus attentifs à la part de bêtise qui sommeille en chacun, aux lieux communs, aux idées reçues, aux expressions toutes faites, qu’il sait à merveille détourner, à peine, juste ce qu’il faut pour vous obliger à vous arrêter sur le sens des mots. Lalonde est un maître de la déstabilisation douce.
L’aphorisme est un genre qui ne pardonne pas. Trop souvent triomphent le jeu de mots facile, le moralisme plat et l’astuce de comptoir, qui ferment le sens ou le rabattent sur le trivial au lieu de l’ouvrir sur l’imaginaire. S’il faut pinailler, je n’ai relevé dans ces soixante pages que deux jeux de mots un peu convenus, comme on en a tous fait à quinze ans. Partout ailleurs, le paradoxe, l’humour, la faculté d’étonnement rendent le langage et la pensée à leur pouvoir poétique d’ébranlement. Le trait d’esprit porte pour une fois bien son nom, petite flèche affutée d’un esprit rare et fin qui avait l’élégance du cœur.
 Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.
Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.
Sillons et poussière

Tout a commencé comme un projet du dimanche, sans dessein particulier : quelques photos prises au vol chez un disquaire new-yorkais, d’autres chez des particuliers entourés de leurs trésors. Au fil de ses voyages, de l’Afrique au Japon, Eilon Paz a continué de rencontrer des collectionneurs de vinyles et de les portraiturer. De fil en aiguille, cet ensemble de photos a alimenté un site qui a connu un succès de bouche à oreille dans le landernau des vinylophiles, avant de devenir ce splendide coffee table book qui ravira les amateurs.
Cent trente fanatiques y sont photographiés dans leur intérieur débordant de 33, de 45 ou de 78 tours, cordés en rangs serrés du plancher jusqu’au plafond. Chacun présente une pièce de sa collection – album de chevet, rareté ou curiosité incongrue. En complément à ce copieux portfolio, de longs entretiens nous font faire plus ample connaissance avec une douzaine de collectionneurs, leur histoire, leurs goûts, leurs trouvailles, leur méthode de classement.
L’échantillon n’a aucune prétention sociologique. La tranche d’âge des trente-cinquante ans prédomine. On y croise beaucoup de gens appartenant au monde de la musique, producteurs, DJ, musiciens ou disquaires, férus le plus souvent de musique pop anglo-saxonne, au sens le plus large. Il y a peu d’amateurs de jazz (hormis une passionnée de Jackie McLean) et pas du tout d’amateurs de musique classique, population qui compte pourtant pas mal de bêtes curieuses. Il y a beaucoup d’hommes et quelques femmes, comme toujours en matière de collectionnite. Les uns se disciplinent pour maintenir leur collection dans des limites raisonnables, les autres se laissent inexorablement envahir : Ahmir Thompson avoue posséder soixante-quinze mille vinyles et ne pas pouvoir envisager de se départir d’un seul. Mais bien entendu, l’accumulation n’est pas une fin en soi, plutôt une conséquence annexe de ce qui est avant tout une passion pour la musique (il va sans dire qu’aucune de ces personnes ne collectionne dans un but de spéculation). Passion indissociable de votre vie et qui peut la transformer : fan de groupes féminins des années 1960, Sheila Burgel a appris le japonais durant cinq ans et vécu un an à Tokyo pour mieux comprendre le monde de la pop féminine nippone de cette décennie.
Les excentriques abondent : un ancien routier fan de rock progressif turc, photographié dans son domicile de la banlieue d’Istanbul ; un jeune nerd de Philadelphie, à la limite de l’autisme, collectionnant les disques de Sesame Street (il y en a beaucoup plus que vous imaginez) ; un Anglais BCBG attiré par les galettes les plus improbables : disques de prévention du suicide, B.O. de films pornos allemands, albums de « musique d’ameublement » (ces disques de musique d’ambiance aquatique ou spatiale ou ce qu’on veut, servant à illustrer reportages et documentaires télévisés). Et, mind you, il les écoute ! On retrouve enfin une vieille connaissance, déjà rencontrée dans le livre d’Amanda Petrusich, Do Not Sell at Any Price, consacré aux collectionneurs de 78 tours de blues (voir entretien ici) : Joe Bussard, octogénaire bourru pour qui l’âge d’or de la musique enregistrée se situe entre 1929 et 1933. Après, comprenez-vous, le son a changé, et ça n’a plus jamais été pareil.
 Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.
Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.

Geoffrey Weiss

Sheila Burgel

Joe Bussard dans son sous-sol tapissé de 78 tours
 Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.
Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.





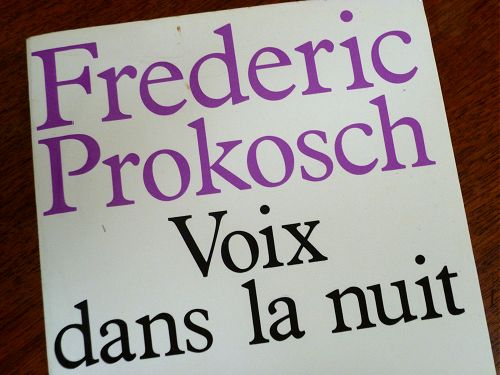
 Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.
Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.