Un aveu déguisé
J’avais d’abord pensé que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait le dernier récit consacré aux exploits de Sherlock Holmes. Cette résolution ne m’avait pas été inspirée par un manque de matériel : je possède en effet des notes sur plusieurs centaines d’affaires auxquelles je n’ai jamais fait allusion. Je ne l’avais pas prise non plus parce que j’aurais noté de la part du public un affaiblissement de l’intérêt qu’il avait accordé à la singulière personnalité et aux méthodes extraordinaires de cet homme remarquable. Mais M. Holmes manifestait de la répugnance à l’égard d’une publication prolongée de ses expériences. Tant qu’il exerçait, la publicité faite autour de ses succès revêtait pour lui une valeur pratique. Depuis qu’il s’est définitivement retiré, et qu’il se consacre à la science et à l’apiculture, il a pris sa renommée en grippe, et il m’a sommé de ne pas contrarier son désir de silence. Il a fallu que je lui représente que la Deuxième Tache ne serait éditée que lorsque les temps seraient propices, et que je lui démontre à quel point la plus importante affaire internationale qu’il ait jamais prise en main serait une conclusion appropriée à cette longue suite d’épisodes. J’ai réussi à arracher son consentement, sous réserve des précautions habituelles.
 Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.
Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.
Et de quoi parle-t-il ? Sachant ses nombreux et vains efforts pour se débarrasser de son encombrant personnage (d’abord en le précipitant dans les chutes du Reichenbach ; ensuite, ayant été contraint de le ressusciter sous la pression du public, en le poussant à la retraite anticipée), il est difficile de ne pas lire dans ces lignes un aveu. Et un aveu déguisé de la plus savoureuse manière : en prêtant à Holmes en personne - comme pour leur donner plus de poids - l’aversion que lui inspire la «publication prolongée de ses expériences» et le souhait comminatoire de voir son biographe y mettre un terme. Ironie suprême, mais ruse à double tranchant, en ce qu’elle renforce le mythe holmésien au moment même où l’auteur entend lui signifier son congé [1].
Doyle, comme on sait, était exaspéré par la renommée excessive du détective de Baker Street, dont il jugeait qu’elle portait ombrage au reste de son œuvre (le reste, c’est-à-dire les romans historiques, les seuls à ses yeux qui méritaient de survivre et qui sont à présent bien oubliés). Cas classique du créateur dévoré par sa créature, de l’écrivain qui se méprend sur le verdict de la postérité. Oui. Mais il est peu d’exemples d’un auteur à ce point excédé par la célébrité d’un de ses personnages qu’il ne peut s’empêcher d’en faire état dans la fiction même dont celui-ci est le héros ; et par un tel jeu de cache-cache encore, puisque résumons-nous Watson/Doyle affirme à mots couverts son intention de mettre un point final aux aventures de Sherlock Holmes en imputant ce désir à Holmes lui-même, qui est donc un peu Doyle lui aussi, et j’espère que vous suivez toujours. Aussi bien il est tentant de lire ce passage comme un message secret adressé par l’auteur à ses lecteurs, qu’il les inviterait - armés de la même perspicacité que Holmes perçant à jour le code des Hommes dansants - à décrypter comme suit :
J’avais espéré que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait l’ultime récit dédié aux exploits de ce fâcheux personnage qui m’empêche de me consacrer à mes romans sérieux, seuls dignes de ma vocation littéraire ; mon éditeur a réussi à m’en arracher encore un qui fasse une conclusion plus appropriée à cette longue suite d’épisodes, sous réserve que cette fois ce sera bien le dernier. Cette résolution ne m’est pas dictée par un manque d’inspiration : je pourrais, si telle était ma volonté, en écrire plusieurs centaines d’autres ! Je ne la prends pas non plus en raison de l’affaiblissement de la ferveur du public (hélas, ces sots en redemandent encore). Mais je ne peux plus dissimuler la répugnance que m’inspire la production prolongée de cette littérature alimentaire. Longtemps la publicité faite autour des aventures de Holmes revêtit pour moi une valeur pratique : leur succès foudroyant me permit d’abandonner la médecine pour me consacrer entièrement à mon œuvre. Mais à présent j’ai pris sa renommée en grippe, et puisque j’ai eu la bonne idée d’envoyer ce satané détective élever des abeilles dans une ferme du Sussex (grand bien lui fasse), je vous somme de ne plus contrarier mon désir de passer à autre chose.
Vœu pieux, bien entendu : tel le matou de la chanson, Holmes revient toujours le jour suivant… et Doyle lui prêtera encore vie dans un roman et dix-neuf nouvelles.
***
1. Le mythe en question tire précisément une part de sa puissance de divers procédés narratifs destinés à accréditer l’existence réelle de Holmes - petit jeu par lequel Doyle noue une connivence très forte avec son lecteur (et qui réussit à l’époque au-delà de toute espérance ainsi qu’en témoigna l’afflux de courrier à l’adresse fictive de Baker Street réclamant le secours du grand détective). Jeu que les exégètes holmésiens, regroupés en diverses sociétés à travers le monde, perpétuent avec le plus grand sérieux mystificateur, en considérant les récits où apparaît Holmes (le fameux « Canon ») comme historiquement avérés, et véritablement de la main du docteur Watson (dont Conan Doyle n’aurait été que l’agent littéraire).
Un goût de cendres
 Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Payne ressemble effectivement à Marlowe comme un frère. Détective privé de Chicago, il enquête dans la petite ville voisine d’Olympic Heights sur la disparition d’un collègue, et se voit mettre les bâtons dans les roues par la police locale, beaucoup trop polie pour être honnête, et fort empressée à camoufler un meurtre en suicide pour protéger du scandale une famille de notables aux rejetons dégénérés. Chantages, combines immobilières et secrets de famille se partagent une intrigue convenablement enchevêtrée, où l’on croise des édiles imbibés, des mafieux au coup de poing facile et quelques mouquères diablement ambiguës. Et tout ce petit monde se dispute un McGuffin dont, ironiquement, la teneur ne sera pas dévoilée. De la première ligne à l’épilogue, Browne se montre tout à fait digne de Chandler et signe un roman noir d’excellente facture, qui mériterait la réédition en Folio policier.
 Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.
Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.
Westlake (addendum)
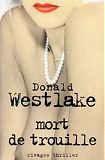 À la riche salve westlakienne de l’année, il faut ajouter Mort de trouille, suspense récréatif qui fut écrit dans la foulée du Couperet, sans autre ambition de la part de Westlake que de (se) divertir, et qui y réussit fort bien. Point de départ classique : Barry et Lola s’aiment d’amour tendre mais tirent le diable par la queue. Ils décident de monter une escroquerie à l’assurance-vie en Amérique latine, où est née Lola, et où il sera plus facile de brouiller les pistes en achetant quelques complicités locales. Barry simulera une mort accidentelle et se planquera chez des parents, Lola rentrera aux États-Unis jouer les veuves éplorées en attendant le versement de la prime ; après quoi il ne restera plus à Barry qu’à revenir à New York sous une fausse identité. Le plan fonctionne comme sur des roulettes, et puis les ennuis se mettent à pleuvoir en cascade, lorsque le prétendu défunt, paumé dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, se retrouve avec à ses trousses un flic corrompu, un enquêteur des assurances flairant anguille sous roche - parce que le dossier est trop parfait - et ses dangereux crétins de cousins par alliance qui guignent une part du pactole et calculent que l’arnaque aura plus de chance de réussir si le faux mort le devient pour de bon. C’est léger, drôle et rondement mené, avec des rebondissements qui ne sont jamais tout à fait ceux qu’on anticipe : du travail de pro, où l’on mesure une fois encore la variété d’inspiration de Westlake et son talent à se couler dans la peau d’un personnage, en adoptant le niveau de langue conforme à son caractère, son éducation, sa situation sociale (comme le Couperet, Adios Schéhérazade, le Pigeon d’argile ou Un jumeau singulier, le roman est écrit à la première personne). Recommandé aux insomniaques et aux ferroviaires, pour reprendre la formule de Manchette.
À la riche salve westlakienne de l’année, il faut ajouter Mort de trouille, suspense récréatif qui fut écrit dans la foulée du Couperet, sans autre ambition de la part de Westlake que de (se) divertir, et qui y réussit fort bien. Point de départ classique : Barry et Lola s’aiment d’amour tendre mais tirent le diable par la queue. Ils décident de monter une escroquerie à l’assurance-vie en Amérique latine, où est née Lola, et où il sera plus facile de brouiller les pistes en achetant quelques complicités locales. Barry simulera une mort accidentelle et se planquera chez des parents, Lola rentrera aux États-Unis jouer les veuves éplorées en attendant le versement de la prime ; après quoi il ne restera plus à Barry qu’à revenir à New York sous une fausse identité. Le plan fonctionne comme sur des roulettes, et puis les ennuis se mettent à pleuvoir en cascade, lorsque le prétendu défunt, paumé dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, se retrouve avec à ses trousses un flic corrompu, un enquêteur des assurances flairant anguille sous roche - parce que le dossier est trop parfait - et ses dangereux crétins de cousins par alliance qui guignent une part du pactole et calculent que l’arnaque aura plus de chance de réussir si le faux mort le devient pour de bon. C’est léger, drôle et rondement mené, avec des rebondissements qui ne sont jamais tout à fait ceux qu’on anticipe : du travail de pro, où l’on mesure une fois encore la variété d’inspiration de Westlake et son talent à se couler dans la peau d’un personnage, en adoptant le niveau de langue conforme à son caractère, son éducation, sa situation sociale (comme le Couperet, Adios Schéhérazade, le Pigeon d’argile ou Un jumeau singulier, le roman est écrit à la première personne). Recommandé aux insomniaques et aux ferroviaires, pour reprendre la formule de Manchette.
 Donald WESTLAKE, Mort de trouille (The Scared Stiff). Traduction de Natalie Beunat. Rivages Thriller, 2006, 241 p.
Donald WESTLAKE, Mort de trouille (The Scared Stiff). Traduction de Natalie Beunat. Rivages Thriller, 2006, 241 p.
Le Bibliothécaire
 Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant - dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. - est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure.
Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant - dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. - est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure.
Le meilleur du livre, c’est la description des coulisses d’une campagne présidentielle: cynisme à tous les étages, financements occultes, coups tordus pour salir l’adversaire, mariage incestueux bien connu du pouvoir et de l’argent. Le débat télévisé entre les deux présidentiables - et ses répercussions immédiates dans les sondages d’opinion - donne lieu à un morceau de bravoure fort bien enlevé. Beinhart, qui avait publié voici dix ans Reality Show (dont Barry Levinson avait tiré le film Wag the Dog/Des hommes d’influence), est manifestement sur son terrain lorsqu’il s’agit de démonter les mécanismes de la désinformation, en montrant qu’elle est moins le fruit d’une manipulation que le produit du fonctionnement même de la machine médiatique (mémoire sélective, emballements, ressassement, surenchère et suivisme). À cet égard, le personnage le plus réussi du livre est Calvin Hagopian, gourou en communication de la candidate démocrate, dont le point de vue à la fois lucide et cynique sur la télédémocratie mérite le détour. Au passage, Beinhart développe, exemples à l’appui, la notion intéressante de fog facts, ces faits qu’on connaît sans les connaître et qui, bien qu’exposés à la vue de tous, n’en restent pas moins enveloppés dans un écran de fumée, noyés qu’ils sont dans une information désormais si pléthorique qu’elle devient malaisée à percevoir clairement et à hiérarchiser.
Malheureusement, ce qui s’annonçait comme un roman noir documenté bascule bien vite dans le super-thriller précuit pour les Majors hollywoodiens, avec personnages en carton-pâte, abondance de clichés d’écriture et de situations, ficelles grossières et rebondissements énormes qui feraient passer 24 heures chrono pour un modèle de subtilité dramatique. Le ton oscille entre le sérieux et la charge outrée, tantôt efficace et tantôt mal ajustée. Le bibliothécaire dépourvu d’héroïsme se mue tout soudain en un émule de Jack Bauer, triomphe de tueurs sadiques et de barbouzes professionnels et conquiert au passage l’amour de la plus belle femme du monde. En somme, Beinhart nous refait le coup du petit homme seul qui vaincra le méchant système à lui tout seul en déjouant un complot visant à voler l’élection - sauf que la barque est si lourdement chargée que, même en acceptant les conventions propres au genre, le livre perd toute crédibilité en cours de route et sombre dans le ridicule. Ajoutons qu’aussi légitime soit-elle en soi, la dénonciation des agissements de l’administration Bush et de l’establishment républicain (mesures fiscales favorables aux plus riches, coupes claires dans les services publics, restrictions des libertés publiques consécutives aux attentats du 11 septembre et au Patriot Act) vire fréquemment à la dissertation plaquée sur la fiction, au point d’en devenir contre-productive.
 Larry BEINHARDT, le Bibliothécaire (The Librarian). Traduction de Patrice Carrer. Gallimard, Série noire, 2005, 450 p.
Larry BEINHARDT, le Bibliothécaire (The Librarian). Traduction de Patrice Carrer. Gallimard, Série noire, 2005, 450 p.
Métadétections (2)
 En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers - rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers - rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
 Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.
Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.
1. La victime est traductrice de romans policiers, ses brouillons et sa bibliothèque jouent un rôle crucial dans le développement et la résolution de l’énigme ; quant au couple de voyageurs, « dilettantes en littérature », que rencontre le narrateur dans le train de nuit pour Salinas, ne seraient-ce pas des avatars d’Ocampo et Bioy ?
Métadétections (1)
 Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi - d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi - d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
 Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.
Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.
1. Sur ce roman, voir le remarquable essai de réinterprétation de Pierre Bayard, Qui a tué Roger Ackroyd ? (Minuit).
2. Perec construira sur un principe analogue le fascinant jeu de cryptogrammes et de poupées russes emboîtées de « 53 jours ».
3. Autre correspondance borgesienne, l’importance des rêves et des paramnésies : c’est un rêve qui aiguillera le flic sur la voie de la vérité.
Westlake, tir groupé
 Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Motus et bouche cousue met en scène un petit braqueur que deux cadres politiques tirent de prison, sous condition qu’il dérobe une cassette vidéo compromettante pour le président en exercice, laquelle servira d’arme de chantage dans la prochaine campagne électorale. Frank Meehan est une sorte de composé des deux héros récurrents de Westlake, Dortmunder et Parker. Comme le premier, c’est un guignard pas possible. Comme le second, c’est un professionnel du casse (mais sans la brutalité de Parker), qui déteste travailler avec des amateurs et a horreur de perdre son temps. (Le texte anglais rend bien, dans son écriture même, le caractère du personnage : les phrases ont un côté cassant, agacé, comme impatient d’en finir, qui s’est perdu dans la traduction.) Cet alliage a priori intéressant ne tient malheureusement pas ses promesses. Les deux registres se contrecarrent au lieu de s’épauler, si bien que le livre semble assis entre deux chaises. La satire des coulisses du monde politique est trop légère pour prêter à conséquence, mais en même temps pas assez hénaurme pour être jubilatoire. Les deux terroristes d’opérette, qui ne dépareraient pas une aventure de Dortmunder (on en retrouve d’ailleurs une paire semblable dans Pourquoi moi ? cf. plus bas), sont trop manifestement incompétents pour réellement inquiéter ; or Westlake tente de construire un suspense « sérieux » sur leur intervention intempestive, etc. Plus grave, le livre pâtit d’une construction déséquilibrée. Les préparatifs du coup, narrés avec un luxe savoureux de détails et de circonvolutions, occupent les quatre cinquièmes du volume, après quoi son exécution et le dénouement sont trop rapidement expédiés. Le soufflé, patiemment cuisiné, retombe brutalement à plat et nous laisse sur une impression mitigée.
Plus réussi, les Sentiers du désastre souffre du même syndrome du pétard mouillé. L’intrigue repose sur le principe éprouvé du jeu de dominos, qu’on pourrait résumer par une phrase du cher John Crosby : « Chacun avait son plan, soit quatre plans au total, qui avaient des répercussions mutuelles et, à partir de cet instant, tous les quatre commencèrent à foirer. » Autour de la fortune de Monroe Hall, affreux bébé gâté de milliardaire universellement haï, et assigné à résidence à la suite d’un scandale financier de type Enron, gravitent d’une part l’ineffable Dortmunder et sa bande habituelle, qui veulent mettre la main sur sa collection de voitures anciennes, et d’autre part les actionnaires qu’il a plumés et les ouvriers qu’il a privés de pension, également assoiffés de vengeance. Le livre captive par sa mise en place extrêmement élaborée, qui fait se croiser avec une maestria consommée une bonne quinzaine de personnages, tous portraiturés de réjouissante manière. Sauf qu’après avoir, en savant horloger, assemblé sous nos yeux une mécanique de haute précision et en avoir tendu le ressort, Westlake néglige d’en exploiter les possibilités et bâcle le dénouement, comme s’il était soudain pressé d’en finir.
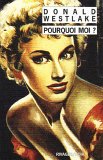 L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet - qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks - et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet - qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks - et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
 Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.
Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.
 Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.
Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p. 
Pourquoi moi ? (Why Me?). Traduction de Sophie Mayoux révisée et complétée par Patricia Christian. Rivages/Noir, 2006, 313 p.
 Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.
Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.





 Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague !
Howard Browne (1908-1999), donc, appartient à l’armée obscure des disciples de Chandler. « S’il n’y avait pas eu Philip Marlowe, il n’y aurait pas eu Paul Payne. Des auteurs m’ont influencé pour écrire, en particulier Mark Twain et James Cain, mais c’est Chandler qui m’a poussé derrière la machine à écrire »(cité par Mesplède et Schlerlet, les Auteurs de la Série noire). Il n’empêche que cet artisan capable a sa personnalité, sa petite musique amère et désenchantée, dont le titre original du roman, The Taste of Ashes, suggère certes mieux la tonalité que sa traduction brevetée Série noire d’À la schlague ! Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.
Howard BROWNE, À la schlague ! (The Taste of Ashes). Traduction de Marcel Duhamel. Série noire n° 470, 1957. Rééd. Carré noir n° 529, 1985.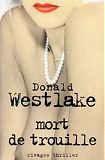 À la riche
À la riche  Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant - dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. - est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure.
Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant - dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. - est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure. En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers - rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.
En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers - rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central. Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi - d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].
Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi - d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3]. Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.
Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.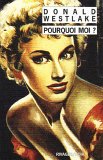 L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet - qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks - et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.
L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet - qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks - et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique. Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.
Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.