Nous circulons entourés de fantômes
Je découvris ainsi des immeubles d’apparence fort commune, mais qui révélaient à l’examen des caractères inattendus, toujours les mêmes.

Quittant l’École Militaire, vous franchissez l’avenue de Suffren et pénétrez ainsi dans le XVe arrondissement, dont le premier immeuble occupe l’angle qu’elle forme avec la rue du Laos. La maison est en biais et ne jouxte pas la suivante. Formant un angle aigu très prononcé, elle s’avance en porte-à-faux, de sorte que, dans une certaine perspective, elle paraît sans épaisseur et ne rien abriter. De nombreuses demeures du quartier de mes explorations sont construites sur le même modèle incongru. Un même mince profil, parfois crénelé de pierres d’attente, s’élève dans le ciel sans qu’aucun édifice ne vienne s’y adosser, s’y imbriquer. L’angle reste en suspens, dessinant un biseau si étroit qu’il décourage sans doute les architectes de construire l’édifice complémentaire.

L’ancien théâtre, le 55 de la rue de la Croix-Nivert, est enfermé dans un fer à cheval étiré, au fond duquel donnent les issues de secours et que constituent les rues Meilhac et Auguste-Dorchain. Courbe et austère, une seule façade occupe toute la longueur de cette dernière. Elle s’achève par le plus accompli des biseaux dont j’ai déjà parlé : une arête tranchante qui porte verticalement l’inscription BAINS-DOUCHES en capitales composées de gros clous à tête nickelée et réfléchissante. Ils prennent l’épaisseur entière de l’éperon terminal. Si l’on se place devant le bar du Soleil, sorte d’annexe du cinéma, sur le bord du trottoir, la longue façade, le biseau sont seuls visibles, de sorte que l’illusion d’une maison sans épaisseur s’impose absolument. Personne, sauf des êtres infiniment minces, ne pourrait habiter l’apparence d’immeuble, qui ne reprend consistance qu’à mesure qu’on dépasse la fine étrave et que s’évase lentement la haute muraille aveugle qui clôt l’édifice par derrière.

Un jour, je feignis par jeu que ces demeures étaient destinées à des persécutés que leur construction convenue, surprenante, avertissait qu’ils pourraient, sans crainte d’erreur, y trouver refuge, un peu à la manière dont les Compagnons du Tour de France connaissaient dans chaque ville le gîte qui les accueillerait pour la nuit.
Les demeures plates accueilleraient infailliblement des locataires fabuleux et fluides qui habitent en fraude les grandes villes, des êtres flottants venus d’on ne sait quels limbes, identiques pour l’apparence aux êtres humains, mais capables le moment venu de diminuer progressivement jusqu’à l’épaisseur d’une feuille de papier, afin de se trouver à l’aise dans les immeubles en biseau. Il s’agirait donc en premier lieu de créatures ductiles et mimétiques, susceptibles de donner le change aux humains, empruntant nos habitudes et notre allure, mais sans ressentir nos émotions ni partager notre philosophie, jamais tout à fait à l’aise dans notre atmosphère, encore moins dans notre société. Ce sont des voyageurs lointains, radicalement incompatibles avec notre espèce. Ils proviennent d’une autre planète, d’un univers parallèle, éventuellement non physique…
Roger Caillois, Petit guide du XVe arrondissement à l’usage des fantômes,
in Apprentissage de Paris. Fata Morgana, 1984.
(le dernier fragment est un montage.)
P.-S. 1 : Ce beau texte a donné lieu à un film de télévision produit par Pascale Breugnot et réalisé par Pierre Desfons, qui doit dormir dans les archives de l’INA. Toute info à ce sujet sera bienvenue.
P.-S. 2 : Sur Caillois et les fantômes du XVe, voir aussi l’intéressant Bloc-notes de Thierry Bézecourt.
Chambres

Montréal, rue Lacombe, 1975-1987
Mingus at Cornell
 Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
 Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
(Merci à l’indispensable uburoi de m’avoir signalé cette parution.)
Penguinophilie
Bien entendu, il existe des collectionneurs de Penguin. Naturellement, ils sont regroupés en association, la Penguin Collectors’ Society, qui réunit quelques centaines d’amateurs à travers le monde. Il s’agit de la seule association de collectionneurs d’outre-Manche à être exclusivement dédiée à un éditeur — ce qui en dit long à la fois sur l’importance historique d’icelui et sur l’attachement sentimental qu’il continue de susciter. Depuis sa fondation en 1974, elle œuvre à une meilleure connaissance de l’histoire de la maison en organisant des colloques et des rencontres, en publiant des essais, des bibliographies, ainsi qu’une excellente petite revue, The Penguin Collector.
 Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :
Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :
After more than 30 years of the Society’s existence you might quite confidently say that any such series and variations that existed had been noted and illustrated somewhere in our publications. But that’s the thing about collecting Penguins: everytime you reach a minor milestone, or think you’ve nailed a series — up pops something totally new and unexepected, and you start all over again.
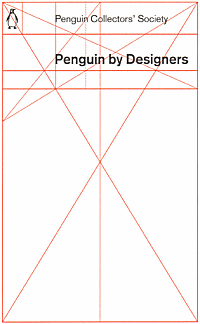 La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.
La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.
Au théâtre ce soir
VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT DEUX BILLETS PREMIÈRE NOUVELLE PIÈCE PYGMALION. VENEZ AVEC AMI, SI EN AVEZ UN.
G.B. SHAW

IMPOSSIBLE ASSISTER PREMIÈRE PYGMALION. VIENDRAI LENDEMAIN, SI DEUXIÈME REPRÉSENTATION.
W. CHURCHILL
Plus d’un livre dans son sac
L’amateur de livres rares est un bibliophile ; le collectionneur de signets, un chartasignopaginophile. Émile Van Balberghe est – accrochez-vous – un biblio-saccuplstikophile. Comprenez par là que ce libraire-éditeur érudit collectionne les sacs en plastique de libraires, de maisons d’édition, de manifestations littéraires…, témoins modestes mais riches d’enseignements de la vie du livre.
Une partie de cette collection sera présentée du 12 octobre au 23 novembre à la Maison du Livre (24-28, rue de Rome, 1060 Bruxelles). L’exposition retracera aussi les diverses facettes d’un amoureux du livre au parcours atypique. Lors du vernissage, le 11 octobre à 18 h 30, Émile Van Balberghe s’entretiendra avec Patrick Moens, lui-même ancien libraire et collectionneur, sur les raisons de ce grand rassemblement de sacs et autres ephemera littéraires (marque-pages, ex-libris, faux livres en plâtre, affichettes, etc.), ainsi que sur les origines et les fruits de ses passions éditoriales et bibliophiliques.

Ascensions
 Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (De la passion considérée comme une course de côte). Dans l’Amour en visites, le jeune Lucien part à l’assaut de ses conquêtes tantôt en gravissant un escalier, tantôt en escaladant le tuyau d’une gouttière, et ces ascensions prolongées semblent n’avoir pas d’autre but que de retarder la confrontation avec l’objet désiré/redouté de sa convoitise.
Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (De la passion considérée comme une course de côte). Dans l’Amour en visites, le jeune Lucien part à l’assaut de ses conquêtes tantôt en gravissant un escalier, tantôt en escaladant le tuyau d’une gouttière, et ces ascensions prolongées semblent n’avoir pas d’autre but que de retarder la confrontation avec l’objet désiré/redouté de sa convoitise.
Ce curieux livre a une étrange histoire. Jarry, désespérément en quête de phynance, fut mis en relation par Rachilde avec Pierre Fort, éditeur à peu près illettré spécialisé dans les ouvrages cochons de troisième ordre, du genre l’École du Vice ou le Couvent de Gomorrhe. Pour produire sans délai un volume standard de 224 pages, il confectionne quelques inédits, pioche à la hâte dans les brouillons des Jours et les Nuits, parodie Maeterlinck, y ajoute – il y tient – « Chez la vieille dame », règlement de comptes vachard avec la redoutable Berthe de Courrières, la maîtresse de Gourmont, qui inspira aussi la Chantelouve de Huysmans (Là-bas) ; et broche là-dessus un dialogue ubuesque, repris tel quel des Minutes de sable mémorial, et une prose symboliste, « le Vieux de la montagne », parue dans La Revue blanche. Quant à « la Peur chez l’amour », il s’agirait, selon Noël Arnaud, d’un pastiche (brillant) de Jarry par Rachilde, authentifié avec la pleine complicité de l’intéressé, où l’on croise un sublime alexandrin :
Au fond du corridor gire un escalier pâle
La clientèle ordinaire de Pierre Fort a dû faire une drôle de tête. Non seulement parce que la prose hermétique et saturée d’allusions de Jarry était peu apte à stimuler la masturbation, mais parce que l’amour est pour finir rarement consommé dans ces pages où circulent la terreur de la femme et des attouchements physiques, et l’angoisse de la mort.
Mais revenons au tuyau, rigide mât de cocagne évidemment phallique, dont Lucien entreprend l’ascension dans le premier chapitre, « Chez Manette ». Cette grimpette narrée comme un exploit sportif donne lieu à un morceau de bravoure extrêmement drôle, où se mêlent fragments de monologue intérieur (les pensées incongrues qui se pressent dans l’esprit du lycéen tandis qu’inexorablement il monte), sensation de vertige et peur de se rompre les os. Ça vaut le détour.
 Alfred JARRY, l’Amour en visites. Gallimard, L’Imaginaire n° 354, 106 p.
Alfred JARRY, l’Amour en visites. Gallimard, L’Imaginaire n° 354, 106 p.










 Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance. Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note. Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (
Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (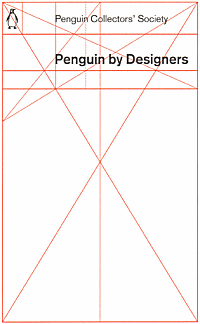 La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse
La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse 

 Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (
Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (