Valses pour Resnais
 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Pas de metteur en scène plus passionné de musique que Resnais ; pas de cinéaste plus musical non plus. C’est musique que les célèbres travellings envoûtants et le montage contrapuntique, les dialogues psalmodiés d’Hiroshima ou pulvérisés de Muriel, le récitatif obsédant de Marienbad, le goût des accents étrangers, les acteurs qui se mettent à chanter avec leur voix (Muriel, La vie est un roman, Pas sur la bouche) ou celle des autres (On connaît la chanson). Providence est un grand opéra fantasmatique, l’Amour à mort un opéra de chambre viennois ; Stavisky… ne fonctionne que si on le reçoit comme un musical onirique sans chorégraphies.
D’Hiroshima mon amour à Cœurs, ce Portrait musical d’Alain Resnais propose un panorama presque exhaustif de ses longs métrages (dommage qu’on n’ait pas fait une petite place à Kander, le tableau aurait été complet). Il dessine, en treize compositeurs, un paysage d’une grande variété et d’une surprenante cohérence, hanté par une certaine qualité de rêverie inquiète que résume idéalement le fox-trot lancinant de Sondheim pour Stavisky…, et dont témoigne aussi la récurrence de valses à la fois ironiques et vénéneuses. Car si la musique au cinéma, selon Resnais, a notamment pour fonction « de faire mieux sentir la construction du film », celle qu’il obtient de ses compositeurs a aussi pour vertu d’en laisser le sens ouvert, comme en suspens dans l’air — à l’image des méduses d’On connaît la chanson —, d’en épanouir et d’en prolonger la résonance en nous.
 Alain Resnais, portrait musical. Universal.
Alain Resnais, portrait musical. Universal.
1. Avec ce trait de monomanie sympathique révélé par Bruno Fontaine, où se reconnaîtront les complétistes acharnés : « [Resnais] m’a aussi avoué son grand problème : ne pouvoir appréhender un compositeur que dans sa stricte intégralité. S’il commence à écouter Honegger, il lui faut acheter tout Honegger. Il a ce fonctionnement encyclopédique avec tous les sujets qui l’intéressent. »
Ce qu’ils lisent
21 mai
Liège
– dans l’autobus 4 en direction des Guillemins, un élégant trentenaire à lunettes fines et au crâne rasé lit Popisme d’Andy Wharol et Pat Hackett.
Dans le train Liège-Bruxelles
– une jeune graphiste survoltée bavarde à voix forte avec son petit ami. De son sac dépasse un volume de fantasy, De Oorlog der Bloemen, de Tad Williams.
Bruxelles
– station Gare centrale, voici deux lecteurs sérieux, un homme et une femme, assis côte à côte et plongés dans deux fort volumes. Elle surligne des phrases au marqueur jaune, lui coche certains passages au bic noir. Ils ne semblent pas se connaître.
– dans le métro, direction Simonis, une jeune femme lit la Femme dans l’… Nous ne saurons jamais dans quoi, puisque sa main cache le dernier mot du titre et qu’elle descend à la station Arts-Loi.
– boulevard du Régent, une quadragénaire tenant sous le bras Inés de mon âme d’Isabel Allende entre au Consulat de France.
Dans le train Bruxelles-Liège
– une femme lit un roman d’Agnès Desarthe.
26 mai
Dans le train Liège-Bruxelles
– une sexagénaire interrompt sa lecture de Mitsuba d’Aki Shimazaki pour bavarder avec une connaissance qui vient d’entrer dans le wagon.
Bruxelles
– dans le métro, direction Simonis, une dame est plongée dans l’Enquête sur la mort de Jésus de Victor Loupen et Alain Noël.
Dans le train Bruxelles-Liège
– un quinquagénaire à barbe poivre et sel lit le Manuscrit de la Giudecca d’Yvon Toussaint.
– il y a trois autres lectrices dans le wagon.
Éloge de l’homme invisible (ou l’art du rebond)
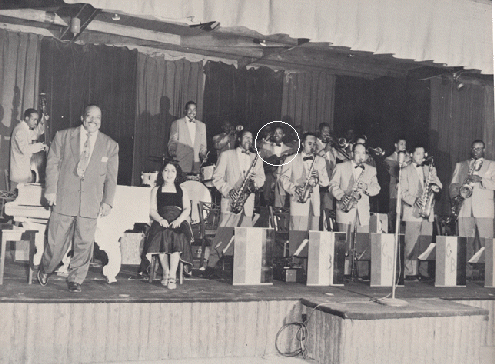
(photo de Popsie Randolph)
L’homme invisible en question, c’est le guitariste au fond de l’orchestre : c’est Freddie Green, qui fut quarante ans durant le pilier indéfectible du big band de Count Basie. Il faut se dévisser le cou pour l’apercevoir, assis derrière la section des saxos, son instrument posé presque à plat sur les genoux. Non seulement on ne le voit pas, mais au commencement on ne l’entend guère non plus. Sur les glorieuses faces Victor des années 1937-1939, enregistrements d’époque obligent, ses accords se fondent indistinctement dans la pulsation de ce qui fut la section rythmique de l’ère du swing — Walter Page à la contrebasse, Jo Jones aux baguettes —, unie comme un seul homme autour du piano de Basie, dont les relances et ponctuations sont aussi économes que judicieusement placées.

Freddie Green, Jo Jones, Walter Page et Count Basie (photo de Frank Driggs)
 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Alors, on débouche une bouteille pour fêter ça, d’autant plus que ces faces sont un pur bonheur. Comme beaucoup d’autres patrons de bigs bands, Basie avait dû dissoudre son orchestre dans les années 1940, pour raisons économiques. Le voici à la tête d’une nouvelle formation, et c’est comme une seconde jouvence, placée sous le signe du renouveau dans la continuité. On reconnaît d’emblée les riffs enchanteurs, la prédilection pour le blues, la science de l’équilibre et des contrastes (ying et yang, ténor robuste contre ténor volatil, le tandem Eddie Lockjaw Davis/Paul Quinichette prenant le relais du tandem Hershel Evans/Lester Young) ; mais ils se déploient au sein d’une masse orchestrale plus dense et plus éclatante, tonifiée par les orchestrations d’une nouvelle génération d’arrangeurs (Neal Hefti, Nat Pierce, Johnny Mandel, Thad Jones). Côté chanteurs, ni Al Hibbler ni même Joe Williams ne font oublier le merveilleux Jimmy Rushing, mais Ella Fitzgerald est l’invitée-surprise de quatre morceaux, et ces deux-là, la chanteuse et l’orchestre, étaient nés pour jammer ensemble (ils remettront ça quelques années plus tard, sur l’excellent Ella and Basie!).
Le swing n’est pas affaire de vitesse mais de jeu sur le temps et le contretemps, un art de l’élan et du rebond. Comme pour en faire la démonstration, c’est sur tempo médium plutôt que sur tempo vif que l’orchestre ici nous ravit le plus. On dirait alors une magnifique cylindrée capable de tourner sans effort à plein régime, mais dont le moteur serait tenu en réserve de puissance ; un félin prêt à bondir à tout moment, et qui bondit parfois, mais préfère autrement avancer d’un pas souple et décontracté, en libérant au passage un swing idéalement élastique et euphorisant — l’antidote de rêve aux jours de cafard.
 The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
Hazard et Fissile
 De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.
De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.
Fantômassienne à coup sûr, avec une touche de Maldoror, la scène foudroyante où un tentacule géant surgit de l’océan et s’empare du malheureux Pierre Réussi pour l’entraîner dans les abîmes marins. Parodico-feuilletonesques, les péripéties abracadabrantes et jonchées de cadavres, qui voient se croiser deux clowns rivaux, un magicien sardonique, un banquier suborneur de jeunes filles, un boxeur noir à l’accent alsacien (qu’il perdra un peu plus tard), divers comparses et quinze pieuvres de Guinée (qui seront dix-sept vingt pages plus loin), dont l’une, autre belle image maldororienne, flottera bientôt comme un dirigeable dans le ciel de Paris. Mais quenelliens, déjà, le ton des dialogues, les incongruités calculées, les personnages qui changent de nom en cours de route (comme dans Pierrot mon ami et les Fleurs bleues), le pirandellisme désinvolte (protagonistes conscients d’être prisonniers d’une fiction et se rebellant contre leur auteur, chose qui reparaîtra, avec beaucoup plus de finesse et de drôlerie, dans le méconnu Vol d’Icare). Reste que, passé un début prometteur, Queneau se désintéresse ouvertement de sa narration et peine à rebondir, ce qui explique sans doute qu’il ait laissé son manuscrit en plan. De sorte que cet inédit n’intéressera que les plus dédiés des queneauphiles.
 Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.
Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.
1. Album Queneau, Pléiade, Gallimard, 2002, p. 58.
Ce qu’ils lisent
Liège
– dans l’autobus 4 en direction des Guillemins, une étudiante a posé à côté d’elle Pivoine de Pearl Buck.
Bruxelles
– dans le métro, direction Hermann-Debroux, un trentenaire déplumé à sandales lit debout un manga (titre indéchiffrable).
– à Mérode, sous l’abribus, une petite dame est plongée dans un roman policier à couverture sanglante (titre indéchiffrable).
Gare du Midi
– face à l’escalator menant au quai n° 10, un trentenaire barbichu portant sac à dos sur l’épaule lit debout Deception Point de Dan Brown.
– sur le quai n° 14 passe un homme trapu tenant un exemplaire de Communio, revue catholique, ainsi qu’un sachet de chips.
Dans le train Bruxelles-Liège
– un trentenaire barbu portant une chaîne autour du cou lit Plateforme de Michel Houellebecq, mais son regard est bientôt attiré par le journal de sa voisine.
– une dame parcourt l’allée centrale, tenant sous le bras une biographie de Charles V (exemplaire de bibliothèque).
– une autre dame plus âgée lit l’Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun.
Liège-Guillemins
– sous l’abribus, une jeune femme à grandes lunettes referme un volume de la trilogie Millenium de Stieg Larsson et monte dans le 48.
La machine à fantasmes
Imaginez-vous donc un individu long, maigre, félin, les épaules hautes ; donnez-lui le front de Shakespeare et le visage de Satan, un crâne soigneusement rasé et des yeux verts – verts comme ceux des chats. Mettez à sa disposition toute la cruauté d’un vaste peuple d’Asie, concentrée en un esprit géant, toutes les ressources de la science du passé et du présent et peut-être bien toute la fortune d’un riche gouvernement […] Cet être effroyable, le voyez-vous en esprit ? Eh bien, je vous présente le Dr Fu Manchu.

Fu Manchu revient chez Zulma, dans une traduction nouvelle d’Anne-Sylvie Homassel (collaboratrice de la revue Le Visage vert, et traductrice bien connue des amateurs de littérature anglo-saxonne). Deux autres volumes sont annoncés, prélude – peut-être – à une retraduction intégrale d’un cycle qui compte treize romans et quelques nouvelles. Tout le monde connaît, au moins de réputation, les sinistres exploits du Fantômas d’Extrême-Orient ; mais, comme pour le héros d’Allain et Souvestre, le détour par le texte d’origine s’impose à tout amateur de fiction extravagante.
Chef de bande omniscient, savant fou et génie du crime aux pouvoirs tentaculaires, résolu par tous les moyens à mettre fin à la domination occidentale sur le monde, Fu Manchu, nul ne l’ignore, est l’incarnation du péril jaune. Sa geste, inaugurée en 1913, cristallise la hantise – déjà – du « choc des civilisations », les inquiétudes de l’Empire britannique vis-à-vis de ses colonies turbulentes, les fantasmes de l’homme blanc face aux peuples dits de couleur. Du mystère insondable de l’âme orientale à la cruauté perverse des fourbes Asiates, en passant par les parfums ensorcelants du levant (le sens olfactif est, ici, particulièrement sollicité), Sax Rohmer n’est jamais en manque d’énormités réjouissantes, assénées avec un imperturbable aplomb.
Une brise légère faisait bruisser les feuilles des arbres ; par longues bouffées un parfum exotique vint envahir la pièce.
C’était un vent d’est – un vent jaune, soufflant sur l’Occident. Il symbolisait le pouvoir subtil et insaisissable du Dr Fu Manchu, de même que Nayland Smith – nerveux, agile, hâlé par le soleil de Birmanie – symbolisait la saine efficacité britannique, mobilisée contre cet ennemi insidieux.
Ce délire paranoïaque – de facto désamorcé par sa candeur hénaurme : ah ! la «saine efficacité britannique » ! – prêterait seulement à sourire s’il ne stimulait la verve inlassable du feuilletoniste, pour la plus grande joie du lecteur. Les fantasmes de Rohmer sont peut-être banals, mais ce qu’ils produisent sous sa plume fiévreuse ne l’est certes pas. Des brouillards londoniens aux eaux glacées de la Tamise, de repaires souterrains en cauchemars hallucinatoires, les chapitres se succèdent à un rythme soutenu comme les épisodes d’un serial onirique. À la fois partout et nulle part, le diabolique Fu Manchu fait preuve, dans son œuvre de mort, d’une inventivité sans limites, en mobilisant tour à tour des poisons subtils qui font passer de vie à trépas (et inversement !), de répugnants insectes, un nuage toxique s’échappant d’un sarcophage, des champignons vénéneux géants (épisode démentiel), et bien d’autres choses encore. Ajoutons que la fascination de Sax Rohmer pour les dangereux mystères de l’Orient, comme la plupart des phénomènes d’attraction-répulsion, est bien entendu de nature sexuelle. En témoigne le vertige érotique qui subjugue le bon docteur Petrie à chaque apparition de Kâramanèh, la belle esclave de Fu Manchu, laquelle n’hésite pas à trahir son maître pour venir en aide aux preux défenseurs de l’Occident. (Par parenthèse, on voit où Henri Vernes a puisé les modèles de l’Ombre jaune et de Tania Orloff, sans oublier les dacoïts et leur célèbre cri – oui, ils sont là eux aussi.) La femme, cette « lame à double tranchant », cette « arme traîtresse », taraudait manifestement notre auteur au moins autant que la perfide Asie, puisqu’il lui consacra un autre cycle romanesque, Sumuru, dont on dit qu’il est au péril féminin (!) ce que Fu Manchu est au péril jaune (j’en parle par ouï-dire, ne l’ayant pas lu). On ne s’en plaindra pas.
Zulma a choisi de présenter le texte sans aucun appareil critique, et cette option est aussi défendable que celle de la précédente édition (chez Alta, il y a une trentaine d’années), qu’accompagnaient de passionnantes préfaces de Francis Lacassin. On peut en effet estimer que la saga de Fu Manchu dispense un plaisir de lire qui se suffit à lui-même, et que le lecteur est assez grand pour juger sur pièces. Or, et de manière quelque peu contradictoire, il faut découvrir sur la toile un entretien avec Anne-Sylvie Homassel pour apprendre ceci :
Rohmer n’est pas extrêmement difficile à traduire. Cela dit, je suis d’ordinaire plutôt adepte de la traduction qui colle au texte original. Dans cette affaire, Laure Leroy m’a quelque peu poussée au crime. Les personnages de Rohmer ont quelques tics et quelques phobies dont la répétition est parfois fastidieuse. J’ai parfois simplifié, parfois surtraduit pour obtenir un texte encore plus nerveux. Mais vous allez peut-être me parler du Péril jaune et des aspects racistes de la série… Très franchement, j’ai, d’un commun accord avec l’éditeur, réduit le nombre des références à la « race jaune » et autres traits déplaisants du texte, parce que notre but n’est pas de heurter, mais de distraire et de charmer. Réduit, mais pas gommé, ce qui n’aurait pas eu de sens. Qu’on se rassure, le terrible Fu Manchu incarne toujours le Péril jaune dans toute sa splendeur. Et les fantasmes du Dr Petrie sont toujours aussi lascivement moyen-orientaux.
N’y avait-il pas lieu d’en informer le lecteur par un bref avertissement ?
 Sax ROHMER, le Mystérieux Docteur Fu Manchu (The Mystery of Dr Fu Manchu). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 319 p.
Sax ROHMER, le Mystérieux Docteur Fu Manchu (The Mystery of Dr Fu Manchu). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 319 p.
So long, Jimmy

Conversation en chambre : Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer et Jim Hall
Jimmy Giuffre, c’était d’abord un art de la conversation mezzo voce. Conversations avec soi-même, en des soliloques méditatifs qu’il accompagnait en tapant du pied. Duos sinueux avec l’excellent André Jaume, qui fut l’artisan de sa redécouverte à la fin des années 1980 ; on l’entendit aussi – sur des enregistrements rarissimes radiodiffusés naguère par Alain Gerber – dialoguer à la clarinette avec la rumeur urbaine, et même avec une goutte d’eau tombant du robinet dans l’évier, et c’était magnifique. Conversations à trois, enfin ou d’abord, puisque le trio – sans batterie de préférence – fut son format d’élection. Avec Jim Hall et Ralph Peña (auquel succéda Bob Brookmeyer), mais surtout avec Paul Bley et Steve Swallow, ce pionnier discret a renouvelé en profondeur l’art de l’improvisation libre. Sans grand succès public à l’époque (le trio avec Bley et Swallow s’est dissous à l’issue d’un concert dans un café new-yorkais où chaque musicien avait gagné la somme mirifique de 35 cents), mais avec un retentissement considérable auprès des musiciens, il a frayé la voie aux musiques improvisées des décennies suivantes.
Musicien phare du jazz West Coast, Giuffre fait la jonction entre les deux avenues principales de ce courant multiforme : la science de l’arrangement pour moyenne et grande formation ; l’expérimentation sur son versant cool, avec ses combinaisons instrumentales inédites (saxo/trompette/batterie ; clarinette/trombone/guitare ; clarinette/hautbois/basson/cor anglais/contrebasse, etc.). Arrangeur hors-pair rompu à l’art du contrepoint, du mariage des timbres et de la forme concertante, il compose à ses débuts, pour le big band de Woody Herman, le célèbre et toujours enchanteur Four Brothers, qui deviendra le thème emblématique du jazz californien. À Lee Konitz, Anita O’Day et quelques autres, il offre des orchestrations ensorcelantes, tapis volants déployés sous leurs pieds avec un art consommé de la dramaturgie sonore. Parallèlement, avec Shorty Rogers et Shelly Manne, puis au sein de ses trios successifs, il explore une autre manière de jouer free, loin des fureurs de la New Thing, en inventant un jazz de chambre tenté par l’abstraction évanescente et les climats debussyens, sans cesser d’être profondément enraciné dans le blues et les folk-songs du sud-ouest américain. Cet alliage de blues-based folk jazz (comme il aimait à dire) et de chambrisme à l’européenne donne à sa musique rêveuse une couleur unique, sans équivalent dans le jazz moderne – dont s’est peut-être souvenu le clarinettiste Michael Moore en enregistrant un superbe disque en trio sur des thèmes de Bob Dylan.
Jimmy Giuffre, c’était encore le compositeur merveilleux de The Train and the River, mais aussi de Gotta Dance, Jesus Maria, Emphasis, Cry Want, Me Too,… qui reviennent me hanter au moment où j’apprends avec retard et tristesse la nouvelle de sa mort, survenue le 24 avril dernier, à l’avant-veille de son quatre-vingt-septième anniversaire.
 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma. Alain Resnais, portrait musical. Universal.
Alain Resnais, portrait musical. Universal.





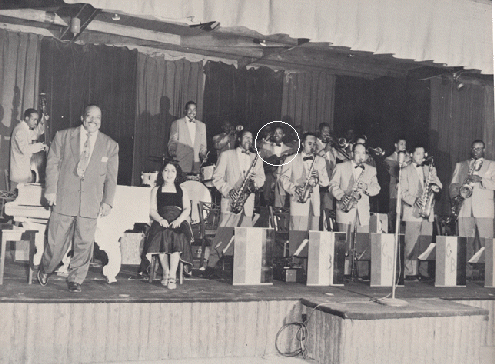

 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur. De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.
De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.
