
Paris, rue Gay-Lussac

Éblouissante reprise de Kiss Me, Kate (1948) au Théâtre du Châtelet, devenu sous la direction de Jean-Luc Choplin le temple parisien de la comédie musicale américaine. Ce backstage musical fut le plus gros succès critique et public de Cole Porter, à une époque où sa cote était à la baisse. Le livret de Sam et Bella Spewack propose un brillant exercice de théâtre dans le théâtre. Un comédien engage son ex-femme pour jouer une version musicale de la Mégère apprivoisée. Rivalisant de cabotinage et de muflerie, le couple se querelle autant en coulisses que les personnages qu’ils interprètent sur scène 1. Comme dans les comédies de Shakespeare, ce couple vedette est redoublé par un second couple du type valet et soubrette — ici, une comédienne volage et un danseur ayant la passion funeste des cartes. Et comme chez Shakespeare encore, un troisième tandem plébéien fournit un contrepoint burlesque — ici, une paire de gangsters incompétents venus encaisser une dette de jeu, qui s’invitent dans la représentation et finissent par prendre goût au théâtre.
Enfant des années folles, Cole Porter resta longtemps fidèle au musical de type revue, où l’on empile les numéros sans souci de cohérence narrative, et ne vint que tardivement au musical à livret, dont Kern et Hammerstein avaient imposé le modèle avec Show Boat. Tout en adoptant cette forme nouvelle dans Kiss Me, Kate, où tous les numéros sont en situation, il conserve ses vieux réflexes de revuiste procédant par morceaux de bravoure en variant les ambiances musicales pour maintenir son public en éveil. Il y a ainsi un hymne au show business et au trac des premières qui lorgne vers Irving Berlin (Another Op’nin’, Another Show), des pastiches de valses viennoises, une béguine émouvante (So in Love), du jazz cuivré qui swingue… et beaucoup, beaucoup de chansons à listes dont Porter s’était fait une spécialité (Gerald Mast parle à leur sujet de catalog songs), où il fait preuve d’une verve inépuisable dans l’énumération et la fausse fin à répétition (quand on croit que c’est terminé, il en vient encore). Les paroles sont un feu d’artifice verbal où les rimes acrobatiques et les paronomases font bon ménage avec le name dropping sarcastique et les sous-entendus sexuels2. L’humour chez Porter naît de la collision inattendue des registres. Le lexique soutenu se rencontre avec le slang déluré, les allusions culturelles chics et les clins d’œil pour initiés se heurtent sans crier gare à des références totalement triviales.
Kiss Me, Kate est un spectacle euphorisant parce qu’il procure trois heures durant le sentiment d’être au spectacle, tout en jouant avec les conventions de la représentation : l’enseigne lumineuse du théâtre se détraque, l’action des coulisses interfère avec la pièce dont elle perturbe le cours, en franchissant ponctuellement le quatrième mur au passage. De la distribution homogène — où l’on détachera Christine Buffle et David Pittsinger, aux voix superbes, et le tandem bouffon Martyn Ellis-Daniel Robinson — à la direction musicale de David Charles Abbel — qui a effectué un travail de recherche approfondi pour établir une édition critique de la partition originale —, en passant par les chorégraphies enlevées de Nick Winston, tout est épatant. La mise en scène de Lee Blakeley joue du contraste entre le monde de la scène et celui des coulisses. Au kitsch d’opérette assumé avec éclat de la pièce dans la pièce s’oppose l’ambiance nocturne années 1940 de la vie backstage (régie, loges et entrée des artistes, toit du théâtre où la troupe, écrasée par la chaleur des spots, monte se rafraîchir durant l’entracte, le temps d’un Too Darn Hot endiablé). En parfaite osmose, la scénographie de Charles Edwards ménage des transitions souples entre ces différents espaces au moyen d’un plateau tournant et d’un jeu de rideaux et d’écrans semi-transparents. Les arrière-plans sont constamment animés, de manière parfois si profuse (la scène d’ouverture) qu’on aimerait disposer d’un DVD pour goûter à loisir les trouvailles de détail de cette production, dont le faste flamboyant renoue avec le Broadway des grands jours.
1 L’argument fut inspiré au producteur Arnold Saint-Subber par un couple de comédiens des années 1930, Alfred Lunt et Lynn Fontanne, célèbre pour ses disputes perpétuelles. Pour ajouter à ces jeux de miroir, Sam et Bella Spewack étaient eux-mêmes en instance de séparation lorsqu’ils écrivirent le livret.
2 Lesdits sous-entendus valurent à Porter d’être fréquemment banni des ondes radiophoniques. Ils seront fort édulcorés dans l’adaptation hollywoodienne de Kiss Me, Kate, au demeurant la meilleure comédie musicale de George Sidney. « The Kingsley Report » y devient « the latest report » et les couplets les plus lestes du désopilant Brush up your Shakespeare ont été pudiquement supprimés.
On est toujours épaté par l’acuité visionnaire des romanciers du XIXe siècle. Le monde de l’argent dépeint par Balzac et Zola, la vie parlementaire vue par Trollope paraissent encore plus vrais aujourd’hui qu’en leur temps — peut-être parce que, pour qui sait voir, un phénomène s’observe mieux à l’état naissant. En 1903, Henry James publie un court roman, les Journaux (The Press). Il y annonce déjà l’ère de la presse people et le caractère tautologique de la notoriété: tout le monde parle de X parce qu’il est célèbre et il est célèbre parce que tout le monde en parle. Deux personnalités, qui sont le négatif l’une de l’autre, incarnent ici ce phénomène. Sir A.B.C. Beadel-Muffet, dont les moindres faits et gestes défraient quotidiennement la chronique, ferait l’impossible pour que son nom disparaisse à tout jamais des journaux (mais comment stopper l’engrenage fatal de la renommée une fois qu’il est lancé ?). Le pitoyable Mortimer Marshall, à l’inverse, est prêt à tout pour devenir célèbre à son tour ; mais l’attention publique se refuse à lui et le rejette, en somme, comme un corps étranger.
James procède à sa manière habituelle, qui est allusive et oblique. Ses héros, Maud Blandy et Howard Bight, sont des sans grade de l’information, un couple de jeunes journalistes désargentés qui vivotent au bas de l’échelle en vendant des potins au plus offrant. L’ambition, le cynisme et la lucidité se disputent en eux ce qui leur reste d’intégrité morale. Au passage, on notera le caractère androgyne de ces deux protagonistes — elle plutôt garçon manqué, lui ayant « par comparaison l’allure d’une jeune fille » — et l’ambivalence de leur camaraderie amoureuse. Le couple, chez James, a toujours quelque chose d’impossible, sinon d’impensable.
Avec Howard et Maud, nous circulons dans le Londres nocturne du Strand, des théâtres 1 et des pubs surchauffés, nous croisons dans le brouillard des crieurs de journaux aboyant les gros titres des éditions spéciales ; mais jamais nous ne franchirons les portes d’une rédaction de Fleet Street. Aucun romancier réaliste traitant d’un pareil sujet n’aurait résisté à la tentation de nous plonger dans l’ambiance fébrile d’une salle de presse au moment du bouclage. Rien de tel chez James. Son génie consiste au contraire à nous maintenir constamment à la périphérie des événements, dont l’écho nous parvient par ouï-dire en quelque sorte, filtré par la perception incomplète qu’en ont des personnages eux-mêmes marginaux. Il y a ainsi, au cœur des Journaux, une ébauche suggérée de roman criminel, et un terrible secret dont nous ne connaîtrons jamais le fin mot. Le pouvoir souterrain de la presse, le Moloch de l’opinion publique qui d’un jour sur l’autre fait et défait les réputations, la présence énorme et tentaculaire de la ville paraissent une menace d’autant plus incommensurable qu’elle reste tapie dans l’ombre, comme une bête dans la jungle. Une singularité toujours frappante chez James, c’est la manière dont la peinture sociale est insidieusement contaminée par le fantastique : « Après quoi, elle avait failli faire un saut, comme elle eût dit, jusqu’à cette boîte aux lettres d’en face dont la gueule vorace, ouverte dans la ténébreuse nuit londonienne, avait englouti tant de ses petites démarches infructueuses. »
1 James moque au passage la mode du théâtre « scandinave » éthéré, genre Ibsen, qui faisait fureur au tournant du siècle.
 Henry JAMES, les Journaux (The Press). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.
Henry JAMES, les Journaux (The Press). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Petit coup de foudre ce matin à la brocante. La lumière, la « poésie muette des choses » et l’effet de temps suspendu propres à tant de natures mortes, l’équilibre de la composition, la bouteille quasi morandienne, la facture — j’aime les tableaux qui ont de la « matière », où l’on sent le coup du pinceau : tout m’a mystérieusement attiré dans cette toile et je n’ai pas résisté.
Une recherche en ligne m’a permis de réunir quelques renseignements sur le peintre. Jean Luypaert (Vilvorde, 1893 — Ostende, 1954) est l’un de ces petits maîtres que les catalogues de vente rangent indistinctement sous l’appellation vague d’« école de Belgique ». Enseignant de profession, il se forme parallèlement à l’académie de Bruxelles. En 1918, avec trois amis peintres, il fonde un cercle artistique à Vilvorde où il exposera régulièrement. Il peint des paysages et des marines — dont il emprunte les motifs à la campagne et à la côte flamandes —, des intérieurs et des natures mortes. Après sa retraite, il s’établit à Coxyde où il installe son atelier dans un ancien moulin. Il séjourne et peint également en Provence. Une exposition rétrospective de son œuvre a été organisée un an après sa mort à la Maison des arts de Schaerbeek.

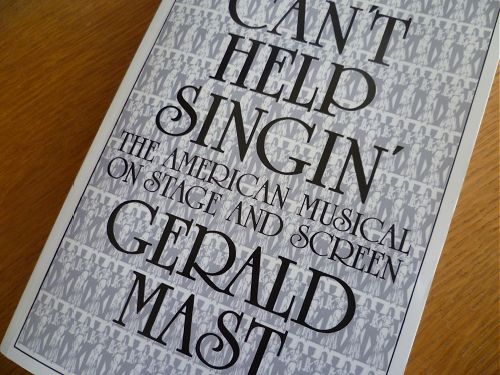
Repéré dans la bibliographie du Gene Kelly d’Alain Masson (Folio biographies, 2012), ce passionnant essai sur la comédie musicale américaine se recommande par de nombreuses qualités. Les ouvrages sur l’histoire de Broadway abondent ; de même ceux sur l’histoire de la comédie musicale hollywoodienne. L’intérêt de Can’t Help Singing est de raconter de front ces deux histoires étroitement imbriquées. Le fil rouge du livre — le musical, forme totalisante à l’instar de l’opéra européen du XIXe siècle, est par excellence l’expression artistique de la culture américaine du XXe siècle en même temps qu’un creuset multiculturel — est sans doute devenu un lieu commun. Mais l’approche stimulante de Gerald Mast lui conserve toute sa pertinence, conjuguant d’une plume vivante et précise la vue d’ensemble et le plan rapproché, l’information factuelle, la mise en contexte socio-historique et l’analyse esthétique souvent très fouillée. Les amateurs d’Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, Lorenz Hart, Ira et George Gershwin, Rodgers et Hammerstein y gagneront une connaissance approfondie de leurs auteurs et compositeurs de prédilection. Attentif au « fond » autant qu’à la « forme », Mast a le chic pour faire découvrir des détails inaperçus dans des œuvres qu’on croyait connaître par cœur, notamment parce qu’il envisage une chanson comme un tout organique cohérent, en montrant exemples à l’appui comment la ligne mélodique et la grille harmonique sont intimement accordées au propos, à la prosodie et à l’invention verbale du texte. Il en va de même pour le cinéma. Les chorégraphies de Busby Berkeley, le cycle Fred Astaire-Ginger Rogers à la RKO ou les films produits par Arthur Freed à la MGM sont analysés avec une grande attention au style visuel et à la mise en scène. On n’est pas surpris, en se renseignant sur l’auteur, d’apprendre qu’il fut un historien du cinéma réputé, auteur notamment de monographies sur la comédie et sur Howard Hawks, qu’on a du coup fort envie de lire.
Can’t Help Singing date de 1987. Il aurait mérité une édition mise à jour rendant compte de l’évolution ultérieure du genre. Hélas pour nous, Gerald Mast eut la mauvaise idée de mourir l’année suivante.