Wu Ming à Liège
 En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.
En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.
Voici donc New York à la fin des années 1960. Un mystérieux tueur en série, surnommé le Fils de Whiteman, assassine de jeunes musiciens de free jazz. Une journaliste, Sonia Langmut, couvre l’affaire pour un quotidien de Brooklyn, flanquée de son inséparable magnétophone avec lequel elle enregistre tout (concerts, conversations : des kilomètres de bandes). En toile de fond, le racisme ordinaire et la lutte pour les droits civiques, la montée du Black Power, les soulèvements qui suivent les assassinats de Malcolm X et Martin Luther King – tandis que dans l’ombre les officines des services secrets préparent à coups d’intox et d’infiltration la répression qui s’abattra sur les mouvements radicaux. Et, sur la bande-son, Ornette Coleman, Archie Shepp, Cecil Taylor, Albert Ayler, Sun Ra et un John Coltrane passé de l’autre côté de la musique – auquel l’auteur prête sans ridicule une sorte de monologue intérieur surgi d’outre-tombe.
 New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
L’auteur, comme son nom de plume ne l’indique pas, est italien. Wu Ming est un groupe de cinq écrivains qui ont adopté ce pseudonyme collectif autant par défiance envers le vedettariat littéraire que pour mettre l’accent sur leur rapport au politique (wu ming, qui signifie « sans nom » ou « cinq noms » selon la prononciation, est la signature employée par les dissidents chinois). Les Wu Ming militent pour le copyleft, la désobéissance civile, l’affirmation d’un autre monde possible, dans leurs livres et par le biais de canulars médiatiques.
Les membres du collectif ont publié plusieurs romans écrits tantôt à plusieurs mains, tantôt en solitaire (auquel cas ils sont signés Wu Ming 1, 2, 3, etc.). Deux d’entre eux ont paru en français chez Métailié : outre New Thing, Guerre aux humains de Wu Ming 2, qui narre une tentative utopique de fonder une nouvelle civilisation dans l’Italie du XXIe siècle.
Le 23 avril à partir de 19 heures, la librairie Livre aux Trésors propose une rencontre avec les deux auteurs, ainsi qu’avec leur traducteur français Serge Quadruppani. La soirée débutera par la projection d’un documentaire d’archives de jazz, et se conclura par deux concerts : le duo Adem (Alain Delbrassine et Éric Mingelbier) et le trio Riccardo Luppi, Manolo Cabras et Antoine Cirri.
 WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.
WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.

 Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.
Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.
On nous cache tout

Jean-Patrick Manchette avait un frère jumeau et nous n’en savions rien. Honneur au Nouvel Obs – toujours à l’affût du scoop – qui le trompette à la une.
Le chaos fertile
Qu’est devenu le Mount Everest Trio ? demandions-nous voici quelque temps. Eh bien des nouvelles nous sont parvenues de Suède de manière inattendue, d’où il ressort que ses membres n’avaient en réalité jamais cessé d’être actifs sur la scène suédoise. Récemment, Conny Sjökvist a dû malheureusement poser ses baguettes pour raisons de santé ; mais Gilbert Holmström et Kjell Jansson continuent de se produire et d’enregistrer, ensemble ou séparément.
 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
 Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
 Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
 On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
 Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Gustafsson et Nilssen-Love ont aussi cosigné un réjouissant disque bruitiste dont le titre annonce la couleur : I Love It When You Snore (Smalltown Supersound). Courts extraits ici.
Tas de beaux yeux
Je suis désolé pour les romanciers quand ils doivent mentionner la couleur des yeux de femmes : il n’y a pas beaucoup de choix et, quelle que soit la couleur retenue, on risque la banalité. Ses yeux sont bleus : innocence et honnêteté. Ses yeux sont noirs : passion et profondeur. Ses yeux sont verts : violence et jalousie. Ses yeux sont bruns : sûreté et sens commun. Ses yeux sont violets : le roman est de Raymond Chandler.
Julian Barnes, le Perroquet de Flaubert.
Fry and Laurie, wordsmiths
– Well, we come now to that part of the show where I say :
« Well, we come now to that part of the show where I say… »
 Recommandé ici-même par Owen Cox, A Bit of Fry and Laurie est donc une série à sketches écrite et interprétée par MM. Stephen Fry et Hugh Laurie, qui fit les beaux jours de la BBC de 1989 à 1995. Comme les Monty Python, les Goodies et tant d’autres, Fry et Laurie sont issus du Cambridge University Footlights Dramatic Club, qui fut la pépinière du comique anglais moderne à partir des années 1960. Les ingrédients de leur humour nous sont donc familiers : délire verbal extrêmement élaboré, parodie, satire sociale, commentaire politique et pur nonsense (à quoi s’ajoute un insistant sous-texte homosexuel). Mais le savant mélange de ces ingrédients leur appartient en propre.
Recommandé ici-même par Owen Cox, A Bit of Fry and Laurie est donc une série à sketches écrite et interprétée par MM. Stephen Fry et Hugh Laurie, qui fit les beaux jours de la BBC de 1989 à 1995. Comme les Monty Python, les Goodies et tant d’autres, Fry et Laurie sont issus du Cambridge University Footlights Dramatic Club, qui fut la pépinière du comique anglais moderne à partir des années 1960. Les ingrédients de leur humour nous sont donc familiers : délire verbal extrêmement élaboré, parodie, satire sociale, commentaire politique et pur nonsense (à quoi s’ajoute un insistant sous-texte homosexuel). Mais le savant mélange de ces ingrédients leur appartient en propre.
Fry et Laurie jouent non seulement avec les limites de la bienséance, mais avec celles de la représentation. Beaucoup de leurs sketches s’appuient sur des routines classiques, du type conversation de bureau, dîner au restaurant ou vendeur et client. Mais celles-ci sont constamment pulvérisées à coups de fausses fins, de télescopages, de mises en abyme et d’effets Helzapoppin. Le spectacle franchit la rampe et envahit le parterre. L’un des deux compères interrompt le dialogue parce qu’il n’apprécie pas la tournure que prend le sketch, ou bien pour faire remarquer combien subtil est le jeu de son partenaire (lequel ne fait rien de particulier à ce moment-là). Un sketch désopilant sur la privatisation de la police (nous sommes dans les années Thatcher-Major) est aussitôt commenté par deux critiques snobs dans une sorte de version télévisée du Masque et la Plume. Puis deux autres critiques, dans une autre émission, discutent à leur tour la performance de ces critiques, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du spectateur (la dernière émission-gigogne s’intitule Oh No, Not Another One). Une autre fois, nous devenons les confidents du monologue intérieur (sous-titré) d’une caméra, qui délaisse la scène pour s’égailler hors-champ vers les coulisses et le public.
C’est que la parodie, chez Fry et Laurie, prend pour cible privilégiée, outre les tropismes de la société de classes anglaise, la rhétorique et les dispositifs télévisuels. Jeux, talk-shows, soap operas, reportages sportifs, visites au domicile de personnalités, dramatiques historiques et séries d’espionnage sont passés à la moulinette, sans oublier les micros-trottoirs, aussi ineptes que les vrais, qui ponctuent régulièrement l’émission. Et ce qui est très fort, c’est la manière dont le tandem joue avec l’effet de déjà-vu propre à la télé. Tel pastiche de soap australien est drôle non seulement en soi, mais parce qu’il donne l’impression d’attraper au hasard, un soir de zapping, le 300e épisode d’une série en cours : on n’y comprend rien, on ne sait pas qui est ce Machin qui affirme à Chose que Bidule couche avec la femme de Truc, mais on a d’emblée reconnu les personnages, les situations et les dialogues pour les avoir mille fois vus et entendus. Idem avec John et Peter, deux yuppies hystériques qu’on verra successivement gérer, à coups de « damned » et de whisky, un gymnase, des toilettes publiques et le diocèse d’Uttoxeter (John est évêque et Peter, vice-évêque exécutif), comme si les mêmes personnages étaient chaque fois téléportés dans un espace-temps télévisuel différent. Mention spéciale enfin, parmi les autres personnages récurrents, à Tony Murchison et Control, les deux espions neuneus, dont les dialogues de bisounours sont interprétés avec une gaucherie délibérée de patronage.
Cela étant, le grand cheval de bataille de Fry et Laurie est incontestablement le langage, — ce langage qui structure fondamentalement l’homo britannicus, son habitus et sa culture (un des sports nationaux consistant à situer très exactement une personne dans l’échelle sociale en identifiant, d’après son accent, son lieu de naissance, son niveau scolaire et son appartenance de classe). La verve linguistique, la gourmandise verbale dont fait preuve le tandem — un festival de périphrases ornées et de doubles négations, de jeux de mots, néologismes, dialogues de sourds, digressions stériles, ambiguïtés et insinuations scabreuses — sont aussi jubilatoires que dévastatrices. L’humour langagier, chez Fry et Laurie, consacre le triomphe du signifiant. Des gros mots fictifs sont aussi savoureusement malsonnants que les vrais : peu importe leur signification, tout est dans la sonorité. Il suffit de déplacer une situation de communication dans une autre pour en révéler la foncière absurdité. Un tournoi d’éloquence de jeunes tories est commenté comme le concours Reine-Élisabeth. Des agents immobiliers reconvertis dans la gérance d’une station-service s’entêtent à vendre de l’essence comme des biens fonciers. Un plan drague et coucherie d’un soir est négocié comme un divorce par avocats interposés. Fry et Laurie jouent avec les mots jusqu’à les vider de leur substance, jusqu’à frapper la communication verbale d’une impossibilité fondamentale, d’un néant vertigineux. Ils essorent pareillement la langue de bois politique ou médiatique et les conversations de tous les jours pour mieux nous convaincre que le mécanisme du langage fonctionne tout seul et qu’à tout moment nous sommes parlés, qu’à la limite il est impossible de proférer une phrase qui ne soit pas déjà un lieu commun — y compris celle qui énonce que tout est lieu commun (le tandem tourne en dérision la censure et le politiquement correct en montrant simultanément que certain discours anti-censure et anti-politiquement correct est tout aussi conventionnel). Et lorsque deux psychiatres dialoguent de telle manière qu’il est impossible de déterminer lequel est le patient de l’autre, ou lorsque deux personnages engagés dans un échange purement phatique (— I know ! — Well of course you do ! — That’s right ! — Still… — Mind you ! — Anyway… — I mean…) passent insensiblement de l’accord parfait à la haine pure avant de retrouver l’apaisement du consensus, on est en plein Ionesco, ou dans le Théâtre de chambre de Jean Tardieu.
La série est composée d’un pilote et de quatre saisons. Les deux premières sont globalement les meilleures. Une certaine usure se fait sentir à partir de la troisième, et la quatrième est certainement la plus faible, l’introduction de guest-stars — même si elle est l’occasion de moquer cette pratique en soumettant les malheureux invités à un feu roulant de questions insanes — se révélant une fausse bonne idée qui plombe l’équilibre du show. Cependant, ces deux dernières saisons comptent plusieurs des meilleurs sketches imaginés par le tandem. C’est aussi à partir de la troisième saison que Fry clôt chaque émission en élaborant un cocktail imbuvable au nom délirant, tandis que Laurie interprète au piano le thème jazzy du générique de fin. La séquence est introduite par un dialogue dont la substance est immuable mais la forme chaque fois plus exagérément pompeuse et périphrastique, et immanquablement conclue par le génial Soupy twist (néologisme fryien pour Cheers). Ajoutons pour être complet que Laurie nous régale tout au long de la série de numéros musicaux parodiques absolument réjouissants (Mystery, America, Hey Jude et Sophistication Song valent la peine d’être traqués sur Youtube).
 A Bit of Fry and Laurie, The Complete Collection. Coffret BBC de cinq DVD. Sous-titres anglais.
A Bit of Fry and Laurie, The Complete Collection. Coffret BBC de cinq DVD. Sous-titres anglais.
Farces & attrapes
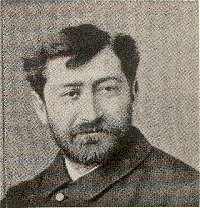 Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.
Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.
De retour en France après un nouveau détour par l’Afrique du Nord, Lemice-Terrieux passe à la vitesse supérieure. 1891 sera sa grande année. Tantôt il se déguise en maître d’hôtel et se poste à l’entrée d’un grand bal en annonçant à tous les arrivants que le gala est annulé. Tantôt il inonde le Tout-Paris de cartons d’invitation à une brillante soirée chez une victime non prévenue. À d’autres, il fait livrer des pianos à queue et autres meubles encombrants. Par voie de presse il fait anonymement annoncer que le riche Cernuschi met 100 000 francs à la disposition des grévistes de la Compagnie des omnibus pour les soutenir dans leur juste cause. Lui-même promet 30 000 francs de sa poche à la Société des Beaux-Arts pour l’encouragement des jeunes artistes — puis dément aussitôt en protestant vertueusement contre le mauvais plaisant qui a répandu ce canular. Il y en aura comme ça par dizaines. Dans Le XIXe siècle, Henry Fouquier s’épate : « Ce qui m’étonne par-dessus tout, c’est qu’il se trouve des gens pour avoir le temps de combiner ces farces, de les préparer, de les exécuter. Commander des lettres, les mettre dans des enveloppes, les envoyer, faire des adresses, voilà bien des affaires et je sais que, pour ma part, quand une obligation sociale, — le jour de l’an, par exemple, — me contraint à une semblable besogne, j’en suis excédé. Il faut donc qu’il y ait dans la mystification une bien grande joie, pour qu’on puisse y donner de tels soins et y perdre son temps ? » Il faut croire que si.
Toujours en 1891, Masson publie un faux célèbre, les Réflexions et pensées du général Boulanger, extraites de ses papiers et de sa correspondance intime. Deux ans plus tard, il récidive en faisant paraître un prétendu Carnet de jeunesse du prince de Bismarck. Selon Colette, cet opuscule faillit être cause de guerre entre la France et l’Allemagne. « Un peu plus tôt, un peu plus tard… », répond pour sa défense le fauteur de troubles.
1894 le voit poser sa candidature à l’Académie française en même temps qu’au poste de bourreau de la République. En avril, les journaux annoncent qu’il prononcera une conférence sur La fumisterie et les fumistes depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Le public se presse nombreux (on va bien rigoler) mais légèrement méfiant (que nous prépare-t-il ?). Beaucoup refusent de confier leur manteau au vestiaire (on ne sait jamais), certains redoutent que Masson ne se présente tout simplement pas, vous allez voir qu’il nous a posé un lapin. Mais non : à l’heure dite survient le conférencier, qui se lance dans un exposé extraordinairement technique, et d’un majuscule ennui, sur la fumisterie industrielle et tous les modes historiques de chauffage à travers les âges, en recommandant pour finir les poêles et tuyaux de cheminée d’une maison anglaise dont il est devenu pour la circonstance le représentant exclusif en France. Une stupéfaction navrée envahit peu à peu les visages et les bancs, un à un, se vident — tandis que l’orateur, imperturbable, poursuit son discours monotone. Henri Mazel donne un compte rendu détaillé de la soirée dans l’Ermitage d’avril 1894. Mais en novembre, le Voltaire affirme qu’elle n’a jamais eu lieu. Qui faut-il croire ? Tout le génie de Masson est là, dans cette manière de susciter quasi naturellement le doute sur les méfaits qui s’attachent à sa légende. « On m’a prêté, confie-t-il à Adolphe Brisson, beaucoup de facéties dont je ne suis pas coupable […]. J’en ai désavoué la paternité ; on n’a pas ajouté foi à mon démenti… Vous-même, en ce moment, vous ne savez pas au juste si je vous trompe ou si je suis sincère. Et votre perplexité me rend heureux. »
Deux ans plus tard, il lance une grande enquête sur les bruits dans l’amour, en promettant l’anonymat aux répondants : « Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître dans le plus bref délai quelles sont les phrases, interjections ou onomatopées qui vous échappent le plus habituellement aux heures d’extase. »
Mais voici ma préférée. Elle est rapportée par Colette dans Mes apprentissages. Masson travaille alors à la Bibliothèque Nationale. Durant les vacances de l’été 1894 qu’il passe à Belle-Île avec Willy et ladite Colette, celle-ci le voit parfois s’installer sur un rocher et sortir de sa poche un paquet de fiches vierges qu’il entreprend de remplir. Que mijote-t-il donc ?
— Je travaille. Je travaille de mon métier. Je suis attaché au catalogue de la Nationale. Je relève des titres.
J’étais assez crédule, et je m’ébahis d’admiration :
— Oh !… Tu peux faire ça de mémoire ?
Il pointa vers moi sa petite barbiche d’horloger :
— De mémoire ? Où serait le mérite ? Je fais mieux. J’ai constaté que la Nationale est pauvre en ouvrages latins et italiens du XVe siècle. De même en manuscrits allemands. De même en autographes intimes de souverains, et bien d’autres petites lacunes… En attendant que la chance et l’érudition les comblent, j’inscris les titres d’œuvres extrêmement intéressantes — qui auraient dû être écrites… Qu’au moins les titres sauvent le prestige du catalogue, du Khatalogue…
— Mais, dis-je avec naïveté, puisque les livres n’existent pas ?
— Ah ! dit-il avec un geste frivole, je ne peux pas tout faire.
Question : combien de ces fiches ont-elles franchi l’étape de la numérisation, et figurent encore au catalogue de la Bibliothèque nationale de France ?
***
Sources : Encyclopédie des farces et attrapes, sous la direction de Noël Arnaud et François Caradec (Pauvert, 1964). La Farce et le Sacré, de François Caradec (Casterman, 1977).
Ajoutons que Lemice-Terrieux collabora aussi à L’Intermédiaire des chercheurs et curieux durant près de vingt ans : combien d’érudits candides a-t-il aiguillé sur des fausses pistes ? On le soupçonne encore d’avoir semé quelques notices de son cru dans le Grand Larousse encyclopédique.
En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.
 New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque. WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.
WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.
 Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.
Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.






 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou  Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose. On peut écouter deux morceaux sur le
On peut écouter deux morceaux sur le  Recommandé
Recommandé 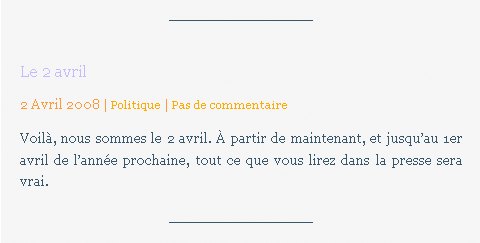
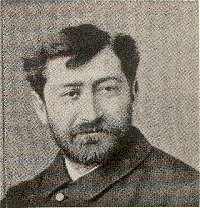 Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.
Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.