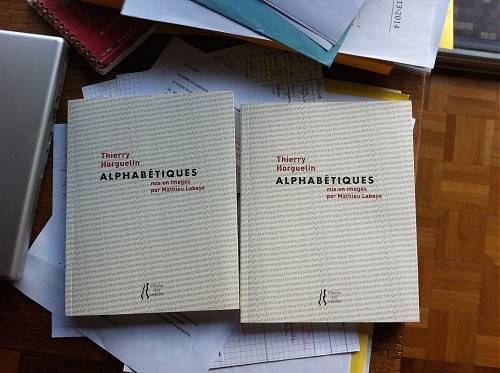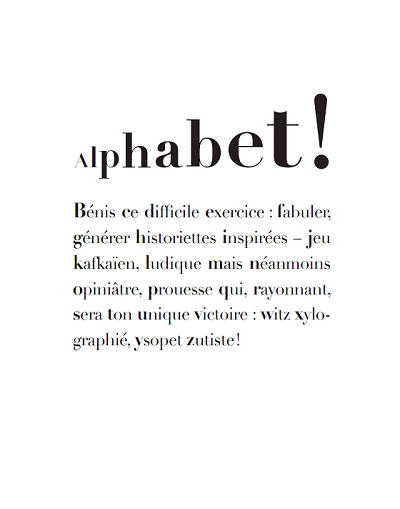Triple lancement
26 mai | Le Port de tête | de 17 à 20 heures

Lancement de
Alphabétiques, de Thierry Horguelin
mis en images par Mathieu Labaye
Abécédaire oulipien pour adultes
(L’Herbe qui tremble)
Sur les traces de l’avenir, d’Eric Simon
avec des images de l’auteur
Le passage du temps et ses secrets
Il était une dame — Œuvres complètes, de Nicole Espagnol
Poèmes, chroniques et photos d’une grande dame oubliée du surréalisme
(L’Oie de Cravan)
BOISSONS ÉTOURDISSANTES ! — PAIX DU CŒUR ET DU PORTEFEUILLE !
LIBRAIRES EN TENUE ESTIVALE !
SOLEIL QUI TARDE À SE COUCHER ! — CONVERSATIONS DÉROUTANTES !
FOULE AVIDE DE RÊVE !
Librairie Le Port de tête
262, av. du Mont-Royal Est
Montréal
Chambres

Paris, Grand Hôtel Magenta
Sortie de presse
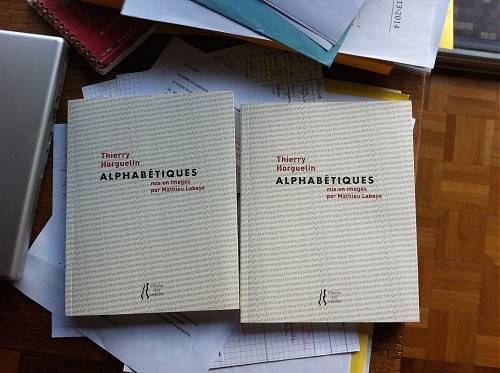
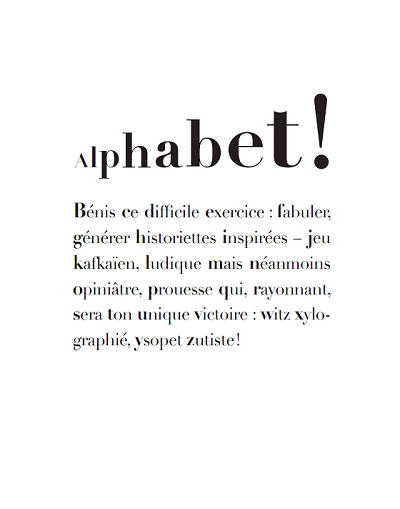

Avec vingt-six images de Mathieu Labaye
Mise en page : Thierry Chauveau
16,3 x 21 cm, 120 p., 15 €
Paris, L’Herbe qui tremble, 2015.
ISBN 978-2-918220-32-9
Commande chez l’éditeur
Gunn, l’autre et son double






Figures du dédoublement
Un jour peut-être, et c’est tout le bien qu’on se souhaite, on aura vu tous les films de Blake Edwards. Peut-être. Car ses premiers travaux de studio, deux véhicules pour le chanteur Frankie Laine, ont peu de chances de ressortir des oubliettes.
Et donc, voici Gunn (1967). Œuvrette incontestablement mineure. Il s’agit d’une séquelle de Peter Gunn, série télé produite par Edwards et qui fut diffusée de 1958 à 1963. Le scénario, coécrit par Edwards et William Peter Blatty, fut d’abord proposé à William Friedkin. Ce dernier le refusa en arguant qu’il n’apportait rien de neuf et ressemblait plutôt à une médiocre resucée de la série télé. Il n’avait pas tort. L’intrigue en est des plus conventionnelles, ce qui n’est pas bien grave, et mollement conduite, ce qui est plus embêtant.
Néanmoins, le film n’est pas dénué d’intérêt. En premier lieu, il y a le personnage. Quoiqu’il ressortisse au stéréotype fatigué du détective privé tombeur de ces dames, Peter Gunn s’en distingue par une étrange passivité. Ce n’est pas qu’il soit amorphe, non, mais il paraît souvent subir les événements (et notamment les assauts féminins) au lieu de les impulser, ce qui lui confère une certaine singularité et induit un léger décalage vis-à-vis des conventions du genre. Indissociable du personnage, son interprète Craig Stevens, dont la raideur sert paradoxalement le jeu (on songe à le voir qu’il aurait été parfait dans des parodies du genre The Naked Gun). Stevens tire un parti parfois étonnant de moyens limités, que compensent sa stature et surtout sa voix, remarquablement timbrée. Il sait donner l’intonation qui convient à un dialogue souvent incisif (on ne le dit pas assez, mais Edwards est aussi un excellent dialoguiste).
Ensuite, la mise en scène. Edwards, comme il l’a prouvé ailleurs, transporte imperturbablement sa méthode du cinéma comique au cinéma policier, et sa patte est reconnaissable à l’attaque du plan, à certains tropes de mise en place, de découpage et de raccords (voir par exemple la scène du cimetière), sans oublier un gag explosif (littéralement). En outre, Gunn est parsemé de détails visuels sui generis, de sorte que si le scénario dévide une histoire sans grand intérêt à laquelle personne ne semble croire, le film en raconte une autre plus intrigante, placée sous le signe de l’identité incertaine, du travestissement et du dédoublement — ce qui est, ma foi, diablement edwardsien. Cela va du bateau-boîte de nuit, dont les hôtesses sont toutes d’accortes paires de jumelles, à l’identité clivée du criminel, en passant par la fusillade dans le dressing aux cent miroirs (hommage au palais des glaces de la Dame de Shangaï). Et ça culmine dans la scène de la cabine de photomaton, scène tout à fait gratuite et d’autant plus révélatrice. Dans une arcade de jeux, Gunn a retrouvé un témoin crucial. Celui-ci l’invite à poursuivre discrètement la conversation au photomaton. Gunn prend place dans la cabine. Et tandis que, de l’autre côté du rideau, le témoin lui balance ses tuyaux, il se compose ce genre de physionomie empruntée qu’on adopte toujours quand on se fait tirer le portrait. Quatre coups de flash. La machine crache sa bandelette de photographies. Elles sont toutes plus affreuses et peu ressemblantes les unes que les autres. Le gag, tout à coup, débouche sur une sorte de vertige kafkaïen où le personnage est confronté à l’étrangeté absolue de son identité.
Cela étant, Edwards réalisera en 1989 un téléfilm intitulé lui aussi Peter Gunn, qui n’est pas un remake mais une nouvelle aventure du détective (incarné cette fois par Peter Strauss), et qui est bien meilleur.










La poésie ce matin (22)
CE MONDE 1
Ce monde en nasse est-il encore le nôtre ?
Et cette mer de côte en côte dominée,
Comme un habit jeté sur le vide ?
Pour te projeter dans ce monde que d’autres habitent,
Retranche-toi la main,
Que tes doigts ne te mangent plus.
Un monde tient dans une pelure d’orange.
Et toi, où est-ce que tu te caches ?
Pourquoi tu te caches ?
La ruine manque, et le vide.
Les briques, les pavés, les dalles, les stèles,
Les jeter n’a pas de sens,
La pierre lancée retombe au même endroit
Après chaque nouvel incendie.
Partir en résidence, et au lieu de rentrer ici repartir de là.
La couture déchirée d’un ordre ancien nous appareille.
Oublieras-tu la mer pour l’habiller en monde
Ou seras-tu navire ?
On voit passer des souvenirs qui sont vieux déjà de plus d’un demi-siècle,
Durs, intimes, murs
Mitoyens entre nous et ce monde sans nous.
[…]
Jan Baetens, Ce monde. Les Impressions nouvelles, 2015.

La débutante récalcitrante

Il y a des films qu’on peut revoir inlassablement, sans que d’innombrables visions en altèrent le pouvoir euphorisant : Singin’ in the Rain, Rio Bravo, The Pink Panther, My Sister Eileen, The Shop Around the Corner, The Apartment, Groundhog Day, Faisons un rêve… et The Reluctant Debutante de Vincente Minnelli, qui enchanta mon enfance, dont je ne manquai jamais les rares rediffusions même en version française (très supportable), et que voici enfin disponible en DVD. Argument : Jim et Sheila Broadbent accueillent à Londres la fille américaine de Jim, Jane, née d’un premier mariage. Engagée dans un concours de snobisme avec sa meilleure amie-rivale, Sheila pousse sa belle-fille à participer à la season, cette succession de bals ininterrompue où les débutantes en quête du prétendant idéal font leur entrée dans le monde.
Ce film est une bulle de champagne. La minceur même de la trame permet d’y apprécier à l’état chimiquement pur le génie de la mise en scène de Minnelli : timing et finesse dans la comédie de mœurs, la satire d’un rite social déjà désuet à sa date (1958) et la peinture du conflit des générations (compliqué par l’éternel malentendu anglo-américain) ; maîtrise éblouissante de la scénographie se déployant presque exclusivement dans des lieux clos aux espaces emboîtés : appartements, salles de bal, restaurants ; ballet d’équilibriste entre les brefs éclats de pur comique (la merveilleuse Kay Kendall, un an après les Girls de Cukor, se montre une fois de plus irrésistible de drôlerie bouffonne) et la délicatesse dans l’exposé des sentiments. Même dans un film aussi heureux et léger, le rêve tournoyant, chez Minnelli, reste inséparable de sa part latente de cauchemar. On connaît peu de cinéastes capables comme lui de montrer simultanément l’euphorie alcoolisée et l’envers panique des parties mondaines (Rex Harrison, chaque soir un peu plus livide et décomposé par le manque de sommeil, se soutenant en grappillant tous les verres qui passent à sa portée…) Ni de ménager, au milieu de l’agitation ambiante, la parenthèse émouvante d’une scène d’intimité complice entre un père et sa fille, dans la cuisine, aux petites heures de la nuit.
Champagne !


The Pink Panther
Ce qui réjouit chez Blake Edwards, c’est que le comble du raffinement (élégance plastique, organisation de l’espace, sens infaillible du tempo tour à tour dilaté et comprimé) soit mis au service des gags les plus parfaitement scabreux. Edwards est notamment le champion de la bouteille de champagne évidemment phallique explosant au moment le moins opportun, en une métaphore flagrante de l’éjaculation prématurée 1.
La plus spectaculaire de ces explosions se trouve dans The Pink Panther. On vient d’en rencontrer une autre dans The Perfect Furlough, comédie charmante où l’on a plaisir à retrouver, aux côtés du couple Tony Curtis-Janet Leigh, notre chère Elaine Stritch.


The Perfect Furlough
1 Indice, peut-être, d’une inquiétude sexuelle qui court dans toute son œuvre. Dans la dernière partie de sa carrière, l’angoisse du mâle californien polygame deviendra le grand sujet d’Edwards : Ten, Micki and Maud, The Man Who Loved Woman, That’s Life !, Skin Deep.