Deux solitudes

À la brocante, ce couple tellement, tellement étrange que je n’ai pas résisté. Leur maintien contraint de jeunes mariés bien comme il faut n’est pas exempt d’un certain malaise qui se communique insidieusement à nous. Elle regarde l’objectif, lui regarde à côté. Elle esquisse un sourire et ne manque pas de charme, lui m’évoque certains visages impénétrables de Magritte. Ils ont tous les deux quelque chose de médusé. Plus je les considère et plus ils me foutent les jetons (lui, surtout). Quels secrets inavouables dissimulent ces fantômes ?

René Magritte, l’Assassin menacé (détail)
Une étrange disproportion
Mlle de Quintin ne tarda pas longtemps à avoir son tour. M. de Lauzun la vit sur le lit de sa sœur, avec plusieurs autres filles à marier. Elle avait quinze ans et lui plus de soixante-trois ans : c’était une étrange disproportion d’âge ; mais sa vie jusqu’alors avait été un roman, il ne le croyait pas achevé, et il avait encore l’ambition et les espérances d’un jeune homme. Depuis son retour à la cour et son rétablissement dans les distinctions qu’il y avait eues, depuis même que le roi et la reine d’Angleterre, qui le lui avaient valu, lui avaient encore procuré la dignité de duc vérifié, il n’était rien qu’il n’eût tenté par leurs affaires pour se remettre en quelque confiance avec le Roi, sans avoir pu y réussir. Il se flatta qu’en épousant une fille d’un général d’armée, il pourrait faire en sorte de se mettre entre le Roi et lui, et, par les affaires du Rhin, s’initier de nouveau et se rouvrir un chemin à succéder à son beau-père dans la charge de capitaine des gardes, qu’il ne se consolait point d’avoir perdue.
Plein de ces pensées, il fit parler à Mme la maréchale de Lorge, qui le connaissait trop de réputation et qui aimait trop sa fille pour entendre à un mariage qui ne pouvait la rendre heureuse. M. de Lauzun redoubla ses empressements, proposa d’épouser sans dot, fit parler sur ce pied-là à Mme de Frémont et à Messieurs de Lorge et de Duras, chez lequel l’affaire fut écoutée, concertée, résolue, par cette grande raison de sans dot, au grand déplaisir de la mère, qui, à la fin, se rendit, par la difficulté de faire sa fille duchesse comme l’aînée, à qui elle voulait l’égaler. Phélypeaux, qui se croyait à portée de tout, la voulait aussi pour rien, à cause des alliances et des entours, et la peur qu’en eut Mlle de Quintin la fit consentir avec joie à épouser le duc de Lauzun, qui avait un nom, un rang et des trésors. La distance des âges et l’inexpérience du sien lui firent regarder ce mariage comme la contrainte de deux ou trois ans, tout au plus, pour être après libre, riche et grande dame : sans quoi, elle n’y eût jamais consenti, à ce qu’elle a bien souvent avoué depuis.
Saint-Simon, Mémoires (chap. XV)
Un monde complet
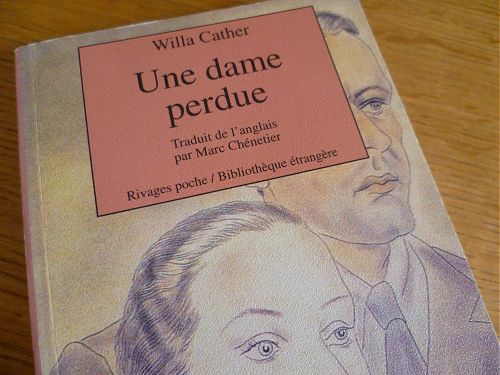
Apogée et déclin de Marian Forrester, mariée à un homme nettement plus âgé qu’elle, qui fut un pionnier de la construction des chemins de fer de l’Ouest américain. À Sweet Water, le ménage Forrester jouit d’un prestige enviable. La demeure du couple, perchée sur une colline dominant le village, est le point de ralliement de la bonne société locale, objet d’admiration, plus tard de convoitise. Belle et troublante, alliant à une grâce rayonnante un sens inné de l’hospitalité, Marian règne calmement sur ce petit monde, adorée de tous, secrètement aimée de certains. Au rang de ses admirateurs discrets figure Niel Herbert, dont on fait la connaissance petit garçon, qu’on retrouve plus tard jeune homme intègre et sérieux, après son retour de la grande ville où il a fait ses études. Bien que le récit soit écrit à la troisième personne, presque tout y est vu par les yeux de Niel, et ce point de vue décentré ajoute une touche jamesienne à la narration : importance des non-dits, des regards échangés, des secrets surpris par inadvertance, qui bouleverseront l’image que se faisait Niel de Marian Forrester, cette image première liée pour lui au paradis perdu de l’enfance. Le jugement de Niel procède par nuances et corrections successives ; mais au bout du compte, et c’est ce qui fait la beauté de ce portrait de femme, Marian conservera jusqu’à la fin quelque chose d’insaisissable.
Willa Cather est de ces romancières qui savent, en deux cents pages, vous donner l’impression d’entrer dans un monde complet, saisi dans ses vibrations les plus intimes comme dans ses dehors les plus larges. Les personnages d’Une dame perdue appartiennent à un microcosme social, qui a ses rites et ses usages, sa hiérarchie de classes. Ils sont aussi inscrits dans un espace et une durée. Autour du village, il y a des paysages, une faune et une flore ; au-delà, des villes et la vaste étendue d’un pays. Plus large que la vie quotidienne, il y a le cycle des saisons, le passage du temps, le renouvellement des générations. La destinée malheureuse de Marian Forrester coïncide avec un changement d’époque : l’ère héroïque (et quelque peu idéalisée) des pionniers de l’Ouest cède inexorablement le pas à l’âge ingrat de l’exploitation capitaliste. Cather nous fait profondément sentir tout cela à la fois.
 Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Typo des villes (37)

Onzain (Loir-et-Cher). Photo : J. K.
Envoi de J. K. que je remercie de cette mirifique trouvaille. Je ne peux m’empêcher de voir dans ce panneau une allégorie de la déconvenue éprouvée par certains de mes amis éditeurs lorsque, souhaitant remettre en circulation des textes oubliés, il butent sur des ayants droit possessifs et mesquins.
Le dernier des indépendants
Diffusion lundi soir sur Arte de Charley Varrick, petite perle des années 1970 à ne pas manquer 1. Une des compositions les plus épatantes de Walter Matthau, un des meilleurs films de Don Siegel. Donald Westlake n’eut rien à voir de près de loin avec cette entreprise (le scénario est tiré d’un polar de John Reese) ; et pourtant, il m’a toujours paru que ce film était d’esprit plus westlakien que bien des adaptations de ses livres ; esprit sensible dans l’astuce des péripéties, l’humour sardonique et le pittoresque des personnages. Jean-Patrick Manchette avait noté que l’inscription Last of the independents, qu’arbore Charley Varrick au dos de sa combinaison de travail, pourrait désigner aussi bien le Parker de Westlake 2. C’était bien vu. Varrick n’est pas un braqueur professionnel à l’instar de Parker, mais il fait preuve des mêmes qualités : sang froid, intelligence, réactivité stratégique et capacité d’adaptation au cœur des pires pétrins. Et il se retrouve, comme Parker, seul contre tous, poursuivi à la fois par la police et la mafia. La manière dont il s’en tire rappelle d’ailleurs les premiers romans de la saga Parker, Comme une fleur et la Clique.
Il est des films criminels où nous en savons autant, ni plus ni moins, que le héros: nous progressons en même temps que lui dans les ténèbres de l’intrigue. D’autres où nous avons un temps d’avance sur lui : je sais qu’un tueur t’attend derrière cette porte, mais toi, personnage, tu l’ignores encore ; nooon ! n’entre paaas ! D’autres enfin où nous avons un temps de retard sur le protagoniste, parce qu’il est plus rapide et plus malin que nous. Charley Varrick appartient à cette dernière catégorie et c’est de ce ressort qu’il tire son pouvoir euphorisant. Constamment, nous assistons sans y rien comprendre aux manœuvres de Walter Matthau, dont la raison tactique ne se dévoilera qu’après coup.
L’autre intérêt du film est d’être un polar de province où le décor est doté d’une grande présence. L’intrigue se déroule au Nouveau-Mexique, bien que le tournage ait eu lieu dans le Nevada. Quoi qu’il en soit, Don Siegel tire le meilleur parti d’extérieurs soigneusement repérés, des bleds paumés aux étendues sauvages, en montrant une prédilection pour les « non-lieux » : parkings, terrains d’aviation désolés, casses automobiles, campings de caravanes sédentarisées, motels miteux et bordels improbables dressés au milieu de nulle part. Il court ainsi en filigrane de Charley Varrick une critique du décor nord-américain, marqué par la laideur anonyme et la dégradation des paysages. À l’appui de ce constat, Siegel pose çà et là des touches ironiques : un générique alignant des vues pastorales idylliques, en total contraste avec le climat de corruption généralisée qui suivra ; un plan sur une poubelle de rue portant une inscription invitant les bons citoyens à garder leur ville propre. Au milieu du film, une scène étonnante voit deux banquiers corrompus et aux abois discuter devant un enclos où paissent quelques aimables bovidés, dont ils en viennent à envier le sort paisible. Plus d’ironie, tout à coup, ou plus seulement de l’ironie, mais des sentiments mêlés. Après tout, même les gangsters les plus minables peuvent éprouver fugitivement du vague à l’âme élégiaque.
1 Le film est disponible en DVD, éditions Bac Vidéo.
2 Ainsi d’ailleurs que Don Siegel, pendant qu’on y est. En Charley Varrick, artisan futé de la cambriole luttant contre les professionnels du crime organisé, il est loisible de voir une projection du maverick Siegel, artisan de cinéma en butte au système hollywoodien.








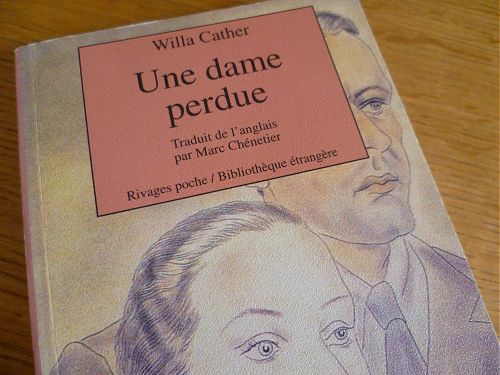
 Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.