
Bruxelles, Hôtel Espérance
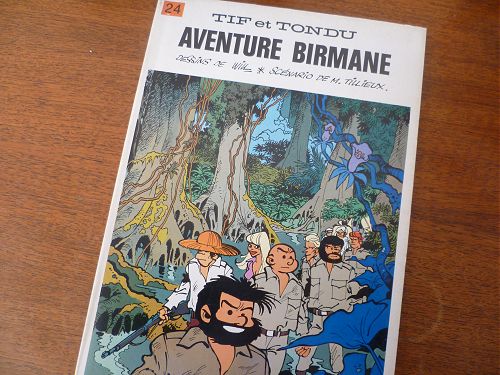
Vous le savez, dans les aventures de Tintin, les langues imaginaires (le syldave, l’arumbaya des Indiens de l’Oreille cassée) ne sont pas des créations arbitraires. Elles sont dérivées du marollien, le parler franco-flamand populaire naguère en usage à Bruxelles. Cette pratique, Hergé l’étendait à l’onomastique. L’exemple le plus connu est celui du cheik Bab-El-Ehr, que son nom désigne comme un bavard, du marollien babbeleir. On peut citer aussi, au verso de l’hebdomadaire Paris Flash qui suscite l’ire du capitaine Haddock dans les Bijoux de la Castafiore, la publicité pour la marque Brol (brol : désordre, objets sans valeur). Ce sont là des traces clandestines, pourrait-on dire, de « belgitude », tandis que partout ailleurs Hergé s’attachait à gommer les particularismes belges pour donner un caractère universel à ses histoires (exception faite des aventures de Quick et Flupke, très ancrées dans la réalité bruxelloise 1). Ces private jokes ne manquaient pas d’enchanter les jeunes lecteurs belges à l’époque de la parution des feuilletons et des albums (ce ne doit plus être le cas aujourd’hui que la pratique du marollien s’est perdue chez les jeunes générations, hormis quelques expressions toujours en usage). Mais elles échappaient naturellement aux lecteurs français, suisses et québécois, pour qui les Syldaves et les Arumbayas s’exprimaient dans un drôle de charabia, rien de plus.
On n’était pas en reste chez Dupuis. Relisant un Tif et Tondu de mon enfance trouvé à la brocante, Aventure birmane, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les porteurs birmans y parlent wallon. Clin d’œil aux lecteurs du cru, et peut-être aussi discret hommage de Tillieux à l’invention langagière d’Hergé.
1 Pour creuser le sujet, voir Jan Baetens, Hergé écrivain (Flammarion, coll. Champs, 2006) et Daniel Justin et Alain Préaux, Tintin, ketje de Bruxelles (Casterman, 2004).

— Je ne vais pas plus loin, sais-tu. C’est plein de sorcières.
— Moi non plus.
— Arrête un peu.

— Elle dit qu’elle double la paye.

— On veut bien, mais s’il arrive encore des affaires comme ça, on se barre.
La Normandie se compose, en gros, de pommiers en fleur et d’auberges normandes, où l’on mange d’abord des fruits de mer : des moules, des oursins, des langoustes, des homards préparés de diverses façons. Les langoustes ont de grandes cornes molles et les homards des pinces terribles, qui repoussent quand elles sont cassées. On distingue les homards à ce qu’ils n’ont pas de cornes, et les langoustes à ce qu’elles n’ont pas de pinces. De plus, les homards sont gauchers tandis que les clients sont droitiers, ou même quelquefois ambidextres ; ils n’ont ni pinces ni cornes molles et leurs jambes ne repoussent jamais.
Ensuite, on mange quelques soles à la Dugléré, noyées d’alcool et de petits champignons. Après quoi on commence le repas. Quand il est près de finir, on attaque l’escalope. Elle nage dans la crème fraîche. Ensuite viennent les sorbets, les glaces, les fromages et les fruits. Les liqueurs. Vers le milieu du repas, entre la tête de veau et la tripe à la mode, il est d’usage de boire un grand verre de calvados : c’est le « trou normand ». Il permet d’attaquer d’un plus ferme appétit le lièvre à la royale et le gigot de pré-salé.
Après quoi l’homme se sent moins seul.
Alexandre Vialatte, « Au pays des pommiers en fleur »,
Dernières Nouvelles de l’homme, Julliard, 1978.
Balaoo. Toujours, chez Gaston Leroux, cette vivacité de l’écriture, cette fièvre narratrice qui vous emportent. Balaoo constitue à certains égards une version simiesque du Fantôme de l’opéra et de la Poupée sanglante. Ces romans mettent en scène trois figures de parias aux marges de l’humanité : le défiguré, l’anthropopithèque, l’automate, amoureux sans espoir d’une blanche et pure créature qu’ils veulent ravir à la société des hommes, et dont l’amour déchaîne la pulsion meurtrière : tantôt par jalousie, tantôt pour protéger l’objet de leur passion. Balaoo et la poupée sanglante sont deux presque humains, traqués comme des bêtes. D’où le thème récurrent (sans blabla pontifiant, ce n’est pas le genre de la maison) de l’humanité de l’animal (ou de l’automate) opposée à la monstruosité de l’espèce humaine. Figure concomitante, celle du savant fou et démiurge raté.
 Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.
Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.
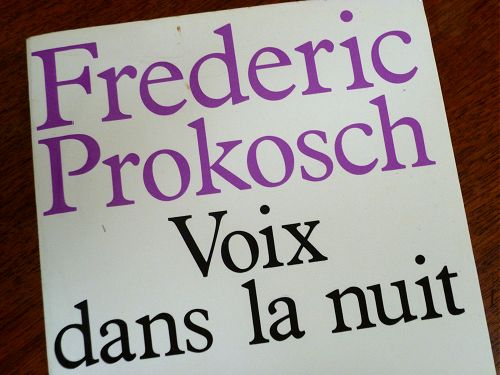
Frederic Prokosch (1908-1989) fut l’écrivain cosmopolite par excellence. Né dans le Wisconsin de parents autrichiens, il vécut entre les États-Unis et plusieurs pays d’Europe, s’adonna passionnément à la chasse aux papillons à l’instar de Nabokov, tâta de l’édition à petit tirage, remporta un championnat de squash à Paris, passa à tort pour un agent secret en Suède avant d’exercer brièvement, pour de vrai, cette activité en Espagne. En 1935, la parution de son premier roman, les Asiatiques, lui valut un succès d’estime qui lui ouvrit les portes du monde artistique et littéraire. C’est bien simple, il a rencontré tout le monde et ses mémoires, publiés à la fin de sa vie, composent une incroyable galerie de portraits : Alice Toklas et Gertrud Stein, Joyce et Pound, T. S. Eliot et William Auden, Gide et Colette, Karen Blixen, Norman Douglas, Peggy Guggenheim, Virginia Woolf, Giorgio De Chirico, Hemingway, Cyril Connolly, Sinclair Lewis, Malaparte, Malraux, les trois Sitwell, Nabokov, Somerset Maugham, Thomas Beechan, Hannah Arendt, Dylan Thomas, Edmund Wilson et l’on en passe.
Les premiers chapitres de Voix dans la nuit raniment les premières impressions de l’enfance : escapades solitaires le long des rivières et sur les collines du Wisconsin, visites chez ses parents de « célébrités » en la personne de Thomas Mann et de la danseuse Anna Pavlova. On est d’emblée conquis par le talent de prosateur de Prokosch, écrivain aux antennes ultra-sensibles qui sait admirablement restituer le frémissement d’un paysage, la vibration impalpable d’une ambiance. Qualités qui se retrouvent dans la suite du livre, où la plupart des chapitres s’articulent autour d’une rencontre avec chacun des personnages cités plus haut. Prokosch n’a pas son pareil pour épingler une silhouette comme il épinglait ses papillons, faire entendre la voix, le phrasé, le ton de la conversation de ses interlocuteurs, saisir pour ainsi dire l’aura, le rayonnement de leur personnalité.
Il s’est murmuré que le mémorialiste avait pris quelques libertés avec ses souvenirs et qu’il y entrait une bonne part de reconstruction a posteriori, sinon de pure imagination. À vrai dire, on s’en doute un peu à la lecture. Il est manifeste que tel récit de rencontre en condense plusieurs afin de lui conférer un surcroît d’intensité, que la chronologie a été aménagée pour donner au livre la courbe parfaite d’un itinéraire ; et l’on sourit de ce que Prokosch semble incapable de tourner un coin de rue sans tomber par hasard sur un grand écrivain. Néanmoins, ces portraits sont criants de justesse et le livre rend un accent de vérité essentielle, celui d’une vie réinventée par la littérature.
 Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.
Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.