
L’un des seize « intermèdes » de L’Amour à mort.
Alain Resnais, tout le monde l’a rappelé à juste titre ces derniers jours, fut une figure essentielle de la modernité cinématographique, née du désastre de la Deuxième Guerre mondiale. L’espèce humaine venait d’être radicalement niée par les camps d’extermination et la bombe atomique ; et dès lors, la dramaturgie traditionnelle du cinéma se voyait frappée d’impossibilité, inapte qu’elle était à traduire ce désarroi sans recours d’après la fin du monde. Il fallait inventer des formes nouvelles et Resnais s’y employa mieux qu’aucun autre. Ce sera le temps des scénarios fragmentaires, défaits, en morceaux, des personnages caractérisés par une impuissance, une paralysie fondamentale face à ce qui leur arrive. Muriel est peut-être le film qui poussera le plus loin cette pulvérisation du réel. Non seulement le montage y est fragmenté à l’extrême, mais le langage même y est frappé de stupeur, les dialogues réduits à des bribes constamment interrompues, des éclats de babil, les personnages se révélant incapables de nommer leur désarroi ou leur vide intérieur (Bernard, le beau-fils de Muriel, revient, rappelons-le, de la guerre d’Algérie).
Par la suite, et notamment à partir des années 1980, le cinéma de Resnais s’est fait plus manifestement léger et joueur. Cependant, la fantaisie, chez lui, s’enlève toujours sur un fond de néant (combien de morts, de fantômes, de grands dépressifs peuplent son univers ?). En témoigne l’usage tout à fait singulier du noir dans ses films.



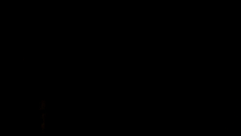
On connaît la chanson. Prologue du film. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre, dans les bureaux du général von Choltitz, au moment où ce dernier reçoit de Hitler l’ordre de faire sauter Paris. Soudain, une série de mouvements d’appareil très rapides et très courts glissent le long de chacun des personnages présents dans la pièce jusqu’au noir absolu, comme s’ils étaient aspirés d’un coup l’un après l’autre dans la grande trappe de l’Histoire et du Temps. L’effet est tout bonnement stupéfiant. C’est alors que la voix off de la guide (Agnès Jaoui) prend le relais, et que nous comprenons que cet épisode historique appartenait au récit qu’elle destine à son petit groupe de touristes, dans le Paris d’aujourd’hui.






Mélo. Après avoir écrit dans un bistro une dernière lettre à son mari Pierre, Romaine descend se noyer dans la Seine. Peu à peu le trajet de la jeune femme et le mouvement de caméra qui l’accompagnait se désolidarisent. Romaine quitte le champ par le bord inférieur du cadre en descendant l’escalier, tandis que la caméra panote et s’avance vers le fleuve noir et froid qui va bientôt l’engloutir. Resnais fait durer le plan, le noir envahit tout, et c’est comme si le film lui-même se noyait. Fin du deuxième acte.






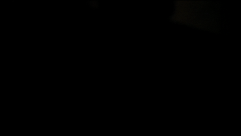
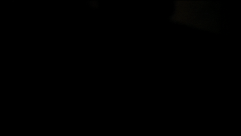






Mélo. Trois ans ont passé. Pierre, le mari, rend visite à Marcel, l’amant. Leur échange est tendu, lourd de reproches longtemps tus, de douleur rentrée. Pierre soupçonne-t-il ou non que sa femme le trompait avec son meilleur ami ? S’aveugle-t-il volontairement parce qu’il ne veut pas savoir ? C’est impossible à dire. À Marcel, il se met à réciter, de mémoire, la lettre que Romaine lui avait envoyée avant son suicide et qu’il connaît par cœur à force de l’avoir relue. C’est alors que la caméra fait une chose invraisemblable. Elle quitte Pierre et descend lentement, lentement vers le sol, caresse les meubles et les objets de plus en plus flous avant de s’abîmer dans le noir absolu, pour remonter le long du corps de Marcel, jusqu’à son visage tétanisé. Le « moment du noir » n’a duré que quelques secondes mais il paraît subjectivement beaucoup plus long (au cinéma plus encore que sur un petit écran). Et ce noir est empli de toute la tristesse abyssale ouverte dans le cœur des deux hommes par le suicide de celle qu’ils aimaient, mais aussi de tous les secrets cachés, de tout le non-dit de la scène. C’est un plan qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du film voici près de trente ans, il ne m’a plus quitté.
P.-S. : à près de dix ans d’écart, ce panoramique de Mélo paraît faire écho à l’admirable panoramique de 360° dans l’épilogue de Providence, celui-là solaire et apaisé, et néanmoins chargé de mélancolie.
Pas de commentaire
Laisser un commentaire





