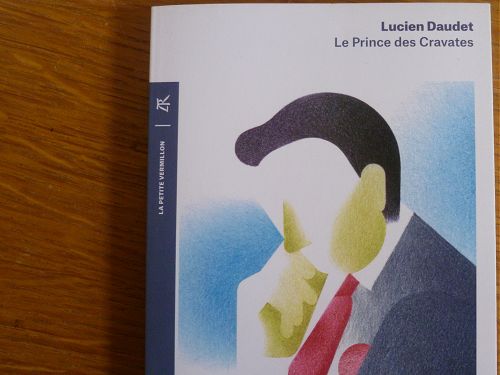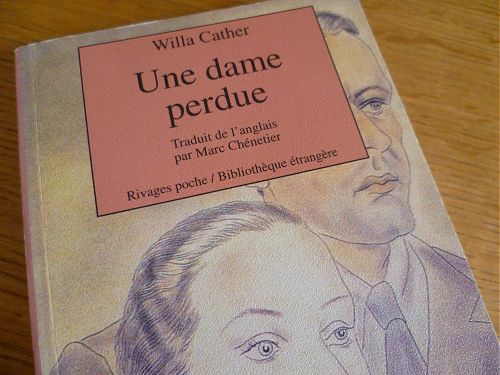Rien
Il y a des gens qui se plaignent d’un homme parce qu’il ne fait rien ; et d’autres, encore plus mystérieux, plus stupéfiants, qui se lamentent de n’avoir rien à faire. On leur fait le présent de quelques belles heures vides, de quelques jours de beau loisir, ils se plaignent de ce qu’ils soient vides, de ce qu’ils soient de beau loisir.
Et si on leur fait don de la solitude, qui est le don de liberté, ils rejettent ce don loin d’eux ; ils le détruisent de propos délibéré en jouant à quelque horrible jeu de cartes, ou en promenant une petite balle sur un terrain de golf.
Je ne parle que pour moi ; je sais qu’il faut des gens de toutes sortes pour faire un monde ; mais je ne puis réprimer un sentiment de malaise quand je vois des gens gaspiller des vacances chèrement gagnées en les employant à faire quelque chose. Pour ma part, je n’ai jamais assez de cette chose qui s’appelle : ne rien faire du tout.
G. K. Chesterton, l’Homme à la clef d’or (Autobiography, 1936).
Traduction de Maurice Beerblock. Desclée de Brouwer, 1948.
Prénom Lucien
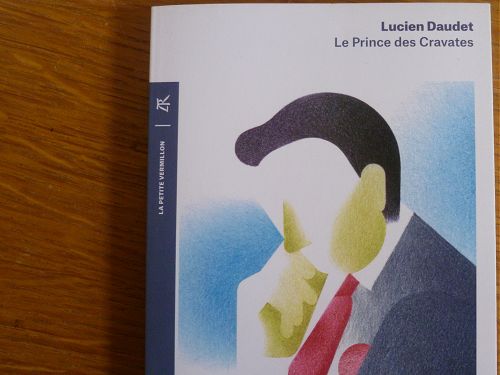
On doit à Jean-Christophe Napias l’exhumation d’Eugène Marsan, la publication des chroniques de Pierre de Régnier, la remise en circulation du premier livre de Patrick Mauriès devenu introuvable, une anthologie des droodles de Roger Price. C’est dire si cet homme est précieux, et si l’on a acquis de confiance la réédition du Prince des cravates procurée par ses soins. On n’a pas été déçu.
Lucien Daudet est un malchanceux de la littérature. Écrasé par un patronyme illustre, il est de ces figures toujours citées par référence à autrui : fils d’Alphonse et frère du redoutable Léon, ami de Proust et de Cocteau. Le seul de ses livres couramment disponible, comme par un fait exprès, est un choix de lettres de Proust. Au demeurant, ce modeste touche-à-tout (il s’essaya à la peinture avant d’opter pour la littérature) désira rester un amateur à l’écart des intrigues qui assurent le succès littéraire. Son œuvre compte une quinzaine de livres : des romans et des nouvelles, des souvenirs et des biographies (il était toqué de l’impératrice Eugénie) ; mais aussi, plus singulièrement, un recueil de lettres imaginaires, ainsi que des poèmes en prose d’inspiration moderniste parus après la Première Guerre, qui témoignent d’un complet renouvellement de sa manière.
Parue en 1908 dans le Mercure de France, le Prince des cravates est une nouvelle délectable. Son argument ténu aurait pu inspirer Jean de Tinan. Invité à séjourner chez un lord ami de son père, dans les environs de Londres, un jeune gandin fort satisfait de sa personne entreprend, par pure vanité, de séduire l’épouse de son hôte. Il faut dire qu’elle est beaucoup plus jeune que ce dernier, se prénomme Guanhamara et répand un entêtant parfum de rose. En un peu moins de cinquante pages, Daudet se révèle aussi discret satiriste des mondanités que fin psychologue de l’émoi amoureux. Doté d’un trait rapide et sûr, il sait choisir l’adjectif inattendu qui épingle un personnage ou suggère un caractère : voici « une baronne coûteuse et divorcée », un jeune homme « très bien relié dans un vêtement délicieusement gris ». Parce que le récit se déroule en Angleterre et que Daudet a le sens de l’understatement ironique, on songe, pour l’ambiance, à certaines nouvelles de Max Beerbohm, voire même de Cyril Connolly.
Cette édition est chapeautée d’une préface impeccable qui nous rend le personnage Lucien Daudet diablement attachant. Elle s’accompagne d’un dossier comprenant une fort utile bibliographie commentée, deux articles de Proust sur Daudet et un autre de Daudet sur Proust.

Lucien Daudet, le Prince des cravates. La Table ronde, « La Petite Vermillon », 2016, 109 pages.

Lucien Daudet vers 1910
Deux solitudes

À la brocante, ce couple tellement, tellement étrange que je n’ai pas résisté. Leur maintien contraint de jeunes mariés bien comme il faut n’est pas exempt d’un certain malaise qui se communique insidieusement à nous. Elle regarde l’objectif, lui regarde à côté. Elle esquisse un sourire et ne manque pas de charme, lui m’évoque certains visages impénétrables de Magritte. Ils ont tous les deux quelque chose de médusé. Plus je les considère et plus ils me foutent les jetons (lui, surtout). Quels secrets inavouables dissimulent ces fantômes ?

René Magritte, l’Assassin menacé (détail)
Une étrange disproportion
Mlle de Quintin ne tarda pas longtemps à avoir son tour. M. de Lauzun la vit sur le lit de sa sœur, avec plusieurs autres filles à marier. Elle avait quinze ans et lui plus de soixante-trois ans : c’était une étrange disproportion d’âge ; mais sa vie jusqu’alors avait été un roman, il ne le croyait pas achevé, et il avait encore l’ambition et les espérances d’un jeune homme. Depuis son retour à la cour et son rétablissement dans les distinctions qu’il y avait eues, depuis même que le roi et la reine d’Angleterre, qui le lui avaient valu, lui avaient encore procuré la dignité de duc vérifié, il n’était rien qu’il n’eût tenté par leurs affaires pour se remettre en quelque confiance avec le Roi, sans avoir pu y réussir. Il se flatta qu’en épousant une fille d’un général d’armée, il pourrait faire en sorte de se mettre entre le Roi et lui, et, par les affaires du Rhin, s’initier de nouveau et se rouvrir un chemin à succéder à son beau-père dans la charge de capitaine des gardes, qu’il ne se consolait point d’avoir perdue.
Plein de ces pensées, il fit parler à Mme la maréchale de Lorge, qui le connaissait trop de réputation et qui aimait trop sa fille pour entendre à un mariage qui ne pouvait la rendre heureuse. M. de Lauzun redoubla ses empressements, proposa d’épouser sans dot, fit parler sur ce pied-là à Mme de Frémont et à Messieurs de Lorge et de Duras, chez lequel l’affaire fut écoutée, concertée, résolue, par cette grande raison de sans dot, au grand déplaisir de la mère, qui, à la fin, se rendit, par la difficulté de faire sa fille duchesse comme l’aînée, à qui elle voulait l’égaler. Phélypeaux, qui se croyait à portée de tout, la voulait aussi pour rien, à cause des alliances et des entours, et la peur qu’en eut Mlle de Quintin la fit consentir avec joie à épouser le duc de Lauzun, qui avait un nom, un rang et des trésors. La distance des âges et l’inexpérience du sien lui firent regarder ce mariage comme la contrainte de deux ou trois ans, tout au plus, pour être après libre, riche et grande dame : sans quoi, elle n’y eût jamais consenti, à ce qu’elle a bien souvent avoué depuis.
Saint-Simon, Mémoires (chap. XV)
Un monde complet
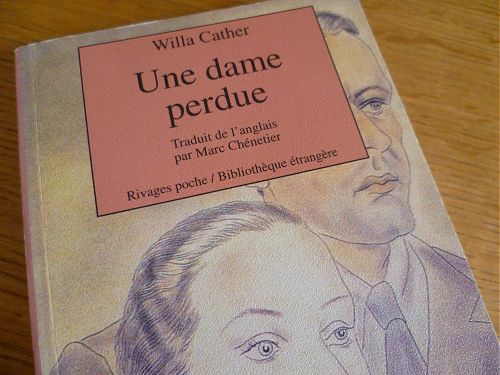
Apogée et déclin de Marian Forrester, mariée à un homme nettement plus âgé qu’elle, qui fut un pionnier de la construction des chemins de fer de l’Ouest américain. À Sweet Water, le ménage Forrester jouit d’un prestige enviable. La demeure du couple, perchée sur une colline dominant le village, est le point de ralliement de la bonne société locale, objet d’admiration, plus tard de convoitise. Belle et troublante, alliant à une grâce rayonnante un sens inné de l’hospitalité, Marian règne calmement sur ce petit monde, adorée de tous, secrètement aimée de certains. Au rang de ses admirateurs discrets figure Niel Herbert, dont on fait la connaissance petit garçon, qu’on retrouve plus tard jeune homme intègre et sérieux, après son retour de la grande ville où il a fait ses études. Bien que le récit soit écrit à la troisième personne, presque tout y est vu par les yeux de Niel, et ce point de vue décentré ajoute une touche jamesienne à la narration : importance des non-dits, des regards échangés, des secrets surpris par inadvertance, qui bouleverseront l’image que se faisait Niel de Marian Forrester, cette image première liée pour lui au paradis perdu de l’enfance. Le jugement de Niel procède par nuances et corrections successives ; mais au bout du compte, et c’est ce qui fait la beauté de ce portrait de femme, Marian conservera jusqu’à la fin quelque chose d’insaisissable.
Willa Cather est de ces romancières qui savent, en deux cents pages, vous donner l’impression d’entrer dans un monde complet, saisi dans ses vibrations les plus intimes comme dans ses dehors les plus larges. Les personnages d’Une dame perdue appartiennent à un microcosme social, qui a ses rites et ses usages, sa hiérarchie de classes. Ils sont aussi inscrits dans un espace et une durée. Autour du village, il y a des paysages, une faune et une flore ; au-delà, des villes et la vaste étendue d’un pays. Plus large que la vie quotidienne, il y a le cycle des saisons, le passage du temps, le renouvellement des générations. La destinée malheureuse de Marian Forrester coïncide avec un changement d’époque : l’ère héroïque (et quelque peu idéalisée) des pionniers de l’Ouest cède inexorablement le pas à l’âge ingrat de l’exploitation capitaliste. Cather nous fait profondément sentir tout cela à la fois.
 Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.
Typo des villes (37)

Onzain (Loir-et-Cher). Photo : J. K.
Envoi de J. K. que je remercie de cette mirifique trouvaille. Je ne peux m’empêcher de voir dans ce panneau une allégorie de la déconvenue éprouvée par certains de mes amis éditeurs lorsque, souhaitant remettre en circulation des textes oubliés, il butent sur des ayants droit possessifs et mesquins.