Éloge de l’homme invisible (ou l’art du rebond)
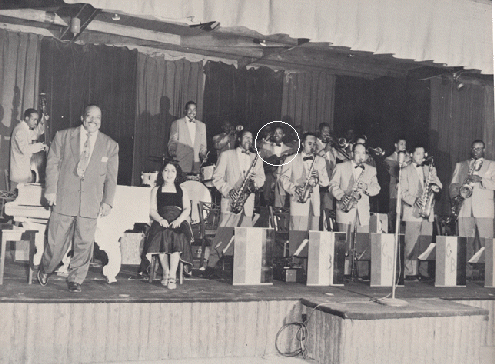
(photo de Popsie Randolph)
L’homme invisible en question, c’est le guitariste au fond de l’orchestre : c’est Freddie Green, qui fut quarante ans durant le pilier indéfectible du big band de Count Basie. Il faut se dévisser le cou pour l’apercevoir, assis derrière la section des saxos, son instrument posé presque à plat sur les genoux. Non seulement on ne le voit pas, mais au commencement on ne l’entend guère non plus. Sur les glorieuses faces Victor des années 1937-1939, enregistrements d’époque obligent, ses accords se fondent indistinctement dans la pulsation de ce qui fut la section rythmique de l’ère du swing — Walter Page à la contrebasse, Jo Jones aux baguettes —, unie comme un seul homme autour du piano de Basie, dont les relances et ponctuations sont aussi économes que judicieusement placées.

Freddie Green, Jo Jones, Walter Page et Count Basie (photo de Frank Driggs)
 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Alors, on débouche une bouteille pour fêter ça, d’autant plus que ces faces sont un pur bonheur. Comme beaucoup d’autres patrons de bigs bands, Basie avait dû dissoudre son orchestre dans les années 1940, pour raisons économiques. Le voici à la tête d’une nouvelle formation, et c’est comme une seconde jouvence, placée sous le signe du renouveau dans la continuité. On reconnaît d’emblée les riffs enchanteurs, la prédilection pour le blues, la science de l’équilibre et des contrastes (ying et yang, ténor robuste contre ténor volatil, le tandem Eddie Lockjaw Davis/Paul Quinichette prenant le relais du tandem Hershel Evans/Lester Young) ; mais ils se déploient au sein d’une masse orchestrale plus dense et plus éclatante, tonifiée par les orchestrations d’une nouvelle génération d’arrangeurs (Neal Hefti, Nat Pierce, Johnny Mandel, Thad Jones). Côté chanteurs, ni Al Hibbler ni même Joe Williams ne font oublier le merveilleux Jimmy Rushing, mais Ella Fitzgerald est l’invitée-surprise de quatre morceaux, et ces deux-là, la chanteuse et l’orchestre, étaient nés pour jammer ensemble (ils remettront ça quelques années plus tard, sur l’excellent Ella and Basie!).
Le swing n’est pas affaire de vitesse mais de jeu sur le temps et le contretemps, un art de l’élan et du rebond. Comme pour en faire la démonstration, c’est sur tempo médium plutôt que sur tempo vif que l’orchestre ici nous ravit le plus. On dirait alors une magnifique cylindrée capable de tourner sans effort à plein régime, mais dont le moteur serait tenu en réserve de puissance ; un félin prêt à bondir à tout moment, et qui bondit parfois, mais préfère autrement avancer d’un pas souple et décontracté, en libérant au passage un swing idéalement élastique et euphorisant — l’antidote de rêve aux jours de cafard.
 The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
So long, Jimmy

Conversation en chambre : Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer et Jim Hall
Jimmy Giuffre, c’était d’abord un art de la conversation mezzo voce. Conversations avec soi-même, en des soliloques méditatifs qu’il accompagnait en tapant du pied. Duos sinueux avec l’excellent André Jaume, qui fut l’artisan de sa redécouverte à la fin des années 1980 ; on l’entendit aussi - sur des enregistrements rarissimes radiodiffusés naguère par Alain Gerber - dialoguer à la clarinette avec la rumeur urbaine, et même avec une goutte d’eau tombant du robinet dans l’évier, et c’était magnifique. Conversations à trois, enfin ou d’abord, puisque le trio – sans batterie de préférence – fut son format d’élection. Avec Jim Hall et Ralph Peña (auquel succéda Bob Brookmeyer), mais surtout avec Paul Bley et Steve Swallow, ce pionnier discret a renouvelé en profondeur l’art de l’improvisation libre. Sans grand succès public à l’époque (le trio avec Bley et Swallow s’est dissous à l’issue d’un concert dans un café new-yorkais où chaque musicien avait gagné la somme mirifique de 35 cents), mais avec un retentissement considérable auprès des musiciens, il a frayé la voie aux musiques improvisées des décennies suivantes.
Musicien phare du jazz West Coast, Giuffre fait la jonction entre les deux avenues principales de ce courant multiforme : la science de l’arrangement pour moyenne et grande formation ; l’expérimentation sur son versant cool, avec ses combinaisons instrumentales inédites (saxo/trompette/batterie ; clarinette/trombone/guitare ; clarinette/hautbois/basson/cor anglais/contrebasse, etc.). Arrangeur hors-pair rompu à l’art du contrepoint, du mariage des timbres et de la forme concertante, il compose à ses débuts, pour le big band de Woody Herman, le célèbre et toujours enchanteur Four Brothers, qui deviendra le thème emblématique du jazz californien. À Lee Konitz, Anita O’Day et quelques autres, il offre des orchestrations ensorcelantes, tapis volants déployés sous leurs pieds avec un art consommé de la dramaturgie sonore. Parallèlement, avec Shorty Rogers et Shelly Manne, puis au sein de ses trios successifs, il explore une autre manière de jouer free, loin des fureurs de la New Thing, en inventant un jazz de chambre tenté par l’abstraction évanescente et les climats debussyens, sans cesser d’être profondément enraciné dans le blues et les folk-songs du sud-ouest américain. Cet alliage de blues-based folk jazz (comme il aimait à dire) et de chambrisme à l’européenne donne à sa musique rêveuse une couleur unique, sans équivalent dans le jazz moderne - dont s’est peut-être souvenu le clarinettiste Michael Moore en enregistrant un superbe disque en trio sur des thèmes de Bob Dylan.
Jimmy Giuffre, c’était encore le compositeur merveilleux de The Train and the River, mais aussi de Gotta Dance, Jesus Maria, Emphasis, Cry Want, Me Too,… qui reviennent me hanter au moment où j’apprends avec retard et tristesse la nouvelle de sa mort, survenue le 24 avril dernier, à l’avant-veille de son quatre-vingt-septième anniversaire.
Wu Ming à Liège
 En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.
En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.
Voici donc New York à la fin des années 1960. Un mystérieux tueur en série, surnommé le Fils de Whiteman, assassine de jeunes musiciens de free jazz. Une journaliste, Sonia Langmut, couvre l’affaire pour un quotidien de Brooklyn, flanquée de son inséparable magnétophone avec lequel elle enregistre tout (concerts, conversations : des kilomètres de bandes). En toile de fond, le racisme ordinaire et la lutte pour les droits civiques, la montée du Black Power, les soulèvements qui suivent les assassinats de Malcolm X et Martin Luther King - tandis que dans l’ombre les officines des services secrets préparent à coups d’intox et d’infiltration la répression qui s’abattra sur les mouvements radicaux. Et, sur la bande-son, Ornette Coleman, Archie Shepp, Cecil Taylor, Albert Ayler, Sun Ra et un John Coltrane passé de l’autre côté de la musique – auquel l’auteur prête sans ridicule une sorte de monologue intérieur surgi d’outre-tombe.
 New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
L’auteur, comme son nom de plume ne l’indique pas, est italien. Wu Ming est un groupe de cinq écrivains qui ont adopté ce pseudonyme collectif autant par défiance envers le vedettariat littéraire que pour mettre l’accent sur leur rapport au politique (wu ming, qui signifie « sans nom » ou « cinq noms » selon la prononciation, est la signature employée par les dissidents chinois). Les Wu Ming militent pour le copyleft, la désobéissance civile, l’affirmation d’un autre monde possible, dans leurs livres et par le biais de canulars médiatiques.
Les membres du collectif ont publié plusieurs romans écrits tantôt à plusieurs mains, tantôt en solitaire (auquel cas ils sont signés Wu Ming 1, 2, 3, etc.). Deux d’entre eux ont paru en français chez Métailié : outre New Thing, Guerre aux humains de Wu Ming 2, qui narre une tentative utopique de fonder une nouvelle civilisation dans l’Italie du XXIe siècle.
Le 23 avril à partir de 19 heures, la librairie Livre aux Trésors propose une rencontre avec les deux auteurs, ainsi qu’avec leur traducteur français Serge Quadruppani. La soirée débutera par la projection d’un documentaire d’archives de jazz, et se conclura par deux concerts : le duo Adem (Alain Delbrassine et Éric Mingelbier) et le trio Riccardo Luppi, Manolo Cabras et Antoine Cirri.
 WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.
WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.

 Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.
Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.
Le chaos fertile
Qu’est devenu le Mount Everest Trio ? demandions-nous voici quelque temps. Eh bien des nouvelles nous sont parvenues de Suède de manière inattendue, d’où il ressort que ses membres n’avaient en réalité jamais cessé d’être actifs sur la scène suédoise. Récemment, Conny Sjökvist a dû malheureusement poser ses baguettes pour raisons de santé ; mais Gilbert Holmström et Kjell Jansson continuent de se produire et d’enregistrer, ensemble ou séparément.
 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou Press All Buttons), servent donc de tremplin aux impros post-bop des solistes, qui s’élancent parfois jusque dans les parages du free. Au passage, le quartet rend un court et bel hommage à Mingus avec Charles Not Charlie, où le solo inaugural de Jansson, les motifs et l’alliage des timbres installent un climat tout à fait mingusien, période Ah Um, sans verser dans le pastiche. Trente ans après Waves From Albert Ayler, Holmström reste un ténor énergique et mordant (on l’entend aussi à la trompette), aux solos remarquablement charpentés, tandis qu’Åvall se révèle un tromboniste plein d’intérêt maîtrisant toutes les ressources de son instrument, depuis le classique effet de coulisse jusqu’aux grondements modulés. Çà et là néanmoins, le groupe semble se retenir de donner « toute la gomme », de sorte que ce disque en studio mériterait d’être prolongé par un enregistrement en concert, plus brut de décoffrage.
 Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
 Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
Gilbert HOLMSTRÖM Quartet. The Mandelbrot Set. ELD Records (2006-2007).
 On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
On peut écouter deux morceaux sur le site du groupe. Et deux extraits de concert sur Youtube.
 Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Mats GUSTAFSSON, The Thing. Crazy Wisdom (2000).
Gustafsson et Nilssen-Love ont aussi cosigné un réjouissant disque bruitiste dont le titre annonce la couleur : I Love It When You Snore (Smalltown Supersound). Courts extraits ici.
Shamokin!!!
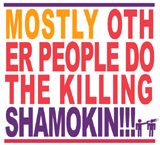 Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée - à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating - synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité - semble avoir été inventé.
Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée - à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating - synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité - semble avoir été inventé.
 Mostly Other People Do the Killing, Shamokin!!! Hot Cup Records (2007).
Mostly Other People Do the Killing, Shamokin!!! Hot Cup Records (2007).
La page MySpace du groupe, avec cinq morceaux in extenso.
Voir aussi sur Youtube.
Mingus at Cornell
 Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
 Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
Charles MINGUS Sextet, Cornell 1964. Blue Note.
(Merci à l’indispensable uburoi de m’avoir signalé cette parution.)
Made in Sweden
 Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
 Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Enregistrement en concert, avec une prise de son d’une grande présence dont le label Dragon semble avoir le secret (voir aussi Jazz du trio Abash, l’un des tout meilleurs live des années 1990, DRCD295).
 Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature - car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature - car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
 POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).
POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).
 MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).
MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).
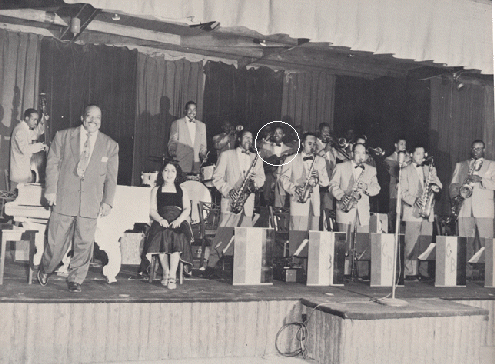

 Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.
Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur. The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.
The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.






 New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.
 Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou
Fraîchement sorti des presses, The Mandelbrot Set les réunit tous deux dans le quartet du saxophoniste, qui compte également dans ses rangs le tromboniste Pider Åvall et le batteur Anders Söderling. Le titre de l’album fait référence à une fractale découverte par le mathématicien Benoît Mandelbrot (la pièce la plus abstraite du disque, Som vindar, semble en effet évoquer quelque mystérieux objet mathématique en forme de méduse flottant dans un espace éthéré), dans laquelle les quatre musiciens voient une métaphore de leur pratique, placée sous le signe conjoint de l’ordre et du chaos : « L’ordre engendre des formes, le chaos la variété. L’ordre seul est monotone, le chaos seul est confusion ». À la jonction de l’un et l’autre, les séduisantes compositions de Holmström, très élaborées dans leur complexité rythmique et leurs harmoniques intrigantes (Blues for NYCF ou  Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose.
Le dernier morceau de The Mandelbrot Set est dédié à Don Cherry, qui vécut en Suède dans les années 1970-1980 et fut une figure tutélaire pour deux générations de modernistes. En témoigne The Thing, construit pour l’essentiel autour de quatre pièces de Cherry, où le poly-instrumentiste Mats Gustafsson (de trente ans le cadet de Holmström) se trouve à la tête d’un trio free surpuissant, branché sur le 220 volts. Capable de construire un solo fascinant rien qu’en faisant circuler et palpiter son souffle dans le corps de son instrument, Gustafsson déchaîne le plus souvent un formidable ouragan sonore, propulsé par la basse d’Ingebrigt Haker Flaten et surtout la batterie aussi torrentueuse que précise de Paal Nilssen-Love, qui est, à 34 ans, l’un des prodiges de sa génération. Grandiose. On peut écouter deux morceaux sur le
On peut écouter deux morceaux sur le 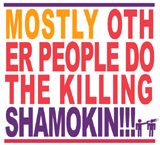 Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée - à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating - synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité - semble avoir été inventé.
Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée - à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating - synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité - semble avoir été inventé. Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance.
Le coup des bandes retrouvées au fond d’un placard a si souvent servi à justifier l’édition d’enregistrements anecdotiques au son cra-cra qui auraient mieux fait d’y rester (dans le placard), qu’on est heureux de le trompeter : le concert donné par le sextet de Charles Mingus à l’université Cornell (Ithaca, NY) le 18 mars 1964, et que vient d’exhumer la veuve du contrebassiste, est un morceau de roi. À quinze jours du fameux concert de Town Hall et du départ pour une mémorable tournée européenne, l’un des meilleurs groupes du moment s’offre devant une assistance complice une sorte de grande répétition générale, dans une ambiance de bonne humeur contagieuse éperonnée par les apostrophes gouailleuses du leader, et avec un plaisir de jouer allant jusqu’à la franche déconnade, comme peu de récitals de Mingus en ont donné l’exemple. À l’image du grand solo d’ouverture où Jaki Byard rend un hommage fantasque aux mânes de Fats Waller et d’Art Tatum en faisant défiler en accéléré quarante ans de styles pianistiques, le programme tisse des liens constants entre la tradition revisitée (Fats Waller encore, Duke Ellington avec notamment un Take the A Train à danser au plafond) et les pièces maîtresses du répertoire mingusien de l’époque (Fables of Faubus, So Long Eric, Meditations, Orange Was the Color of Her Dress then Silk Blue), qui se voient réserver un traitement festif et monumental excédant parfois la demi-heure. Changements de rythme et d’ambiance à vue, folles embardées d’un Dolphy dans une forme éblouissante, échanges télépathiques entre Mingus, son fidèle batteur Dannie Richmond et ses solistes, duel de citations avec Byard (de Yankee Doodle Dandy à la marche funèbre de Chopin), montées en puissance où le sextet se met à sonner comme un mini big band (où l’on mesure une nouvelle fois tout ce que Mingus doit à Ellington dans la science du mariage des timbres)… En tout plus de deux heures de musique tonique, du tout bon pour les mingusophiles, et pour les autres un excellent moyen de faire connaissance. Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.
Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation. Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.
Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif. Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature - car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.
Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature - car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.