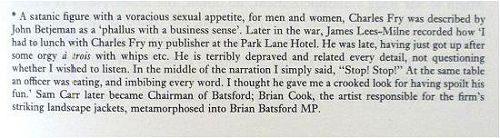Un pays comme les autres
Avant la guerre civile, la Pottibakie était un membre comme les autres du Comité des Nations. Elle érigeait des barrières douanières, violait des traités, persécutait des minorités, pratiquait l’obstruction lors des conférences, sauf lorsqu’elle était convaincue qu’aucune solution satisfaisante ne pouvait être atteinte. Elle mit ensuite toutes ses forces au service de la paix. Elle avait un soldat inconnu, une salve nationale, des timbres-poste commémoratifs, une paysannerie spécifique, des routes à grande circulation ; son emblème était un chien dans un jeu de quilles, son uniforme était gris-prune. En tous ces points, elle ressemblait beaucoup à ses voisins, et sa capitale pouvait facilement être confondue avec Bucarest ou Varsovie, erreur fréquente au demeurant. Son président (car c’était une république) était le Dr Boniface Schpiltz, le comte Waghaghren (car elle avait conservé son aristocratie) était chef de la police, quant à Mme Sonia Rodoconduco, elle était la maîtresse du Dr Schpiltz (car il n’était qu’un homme).
E. M. Forster, Quelle importance ? (Une moralité).
[Nouvelle écrite dans les années 1930.]
Traduction d’Anouk Neuhoff.
Bourgois, 1995.
Come in
En 1955, Beckett se trouve à Londres pour la création anglaise d’En attendant Godot. La pièce, jouée au Arts Theatre, a reçu un accueil houleux, jusqu’aux articles enthousiastes de Kenneth Tynan (dans The Observer) et Harold Hobson (dans The Sunday Times), qui en ont fait du jour au lendemain the talk of the town. Le spectacle s’est alors transporté dans la salle plus prestigieuse du Criterion.
Fille d’un agent littéraire, Phoebe Winch se souvient que son père l’emmena déjeuner avec le grand homme dans un restaurant des environs de Picadilly. Beckett, indifférent à son environnement comme à toute idée de confort, logeait dans un hôtel miteux du quartier, choisi pour sa proximité avec le théâtre. Il paraissait évident qu’il n’était venu à Londres que pour voir la pièce et qu’il n’avait aucune intention de sortir du périmètre de Picadilly. Il mangea, et but, avec parcimonie.
La conversation s’orienta vers le Paris des années 1930, à l’époque où Beckett, en plus d’être un ami proche de Joyce, lui servait de secrétaire. Joyce avait l’habitude de dicter. « Nous travaillions à ce qui allait devenir Finnegans Wake. On frappa à la porte et Joyce dit : “Entrez” [Come in]. Je n’avais pas entendu toquer, si bien que j’écrivis Come in. Je l’ai laissé dans le texte. Ça n’avait ni plus ni moins de sens que le reste. Il me plaît d’imaginer que des étudiants en lettres consciencieux ont consacré des thèses à la signification de ce Come in dans Finnegans Wake. »
Source : The Oldie, avril 2010.
Pour les délicats
L’hôtel Vendôme, rue de la Paix à Paris, dans le premier arrondissement, est destiné aux êtres délicats, peu nombreux, qui trouvent le Ritz un peu vulgaire.
Donald Westlake, Châteaux en esbroufe.
Traduction de Janine Hérisson. Gallimard, « Série noire », 1980.
Rien
Il y a des gens qui se plaignent d’un homme parce qu’il ne fait rien ; et d’autres, encore plus mystérieux, plus stupéfiants, qui se lamentent de n’avoir rien à faire. On leur fait le présent de quelques belles heures vides, de quelques jours de beau loisir, ils se plaignent de ce qu’ils soient vides, de ce qu’ils soient de beau loisir.
Et si on leur fait don de la solitude, qui est le don de liberté, ils rejettent ce don loin d’eux ; ils le détruisent de propos délibéré en jouant à quelque horrible jeu de cartes, ou en promenant une petite balle sur un terrain de golf.
Je ne parle que pour moi ; je sais qu’il faut des gens de toutes sortes pour faire un monde ; mais je ne puis réprimer un sentiment de malaise quand je vois des gens gaspiller des vacances chèrement gagnées en les employant à faire quelque chose. Pour ma part, je n’ai jamais assez de cette chose qui s’appelle : ne rien faire du tout.
G. K. Chesterton, l’Homme à la clef d’or (Autobiography, 1936).
Traduction de Maurice Beerblock. Desclée de Brouwer, 1948.
Une étrange disproportion
Mlle de Quintin ne tarda pas longtemps à avoir son tour. M. de Lauzun la vit sur le lit de sa sœur, avec plusieurs autres filles à marier. Elle avait quinze ans et lui plus de soixante-trois ans : c’était une étrange disproportion d’âge ; mais sa vie jusqu’alors avait été un roman, il ne le croyait pas achevé, et il avait encore l’ambition et les espérances d’un jeune homme. Depuis son retour à la cour et son rétablissement dans les distinctions qu’il y avait eues, depuis même que le roi et la reine d’Angleterre, qui le lui avaient valu, lui avaient encore procuré la dignité de duc vérifié, il n’était rien qu’il n’eût tenté par leurs affaires pour se remettre en quelque confiance avec le Roi, sans avoir pu y réussir. Il se flatta qu’en épousant une fille d’un général d’armée, il pourrait faire en sorte de se mettre entre le Roi et lui, et, par les affaires du Rhin, s’initier de nouveau et se rouvrir un chemin à succéder à son beau-père dans la charge de capitaine des gardes, qu’il ne se consolait point d’avoir perdue.
Plein de ces pensées, il fit parler à Mme la maréchale de Lorge, qui le connaissait trop de réputation et qui aimait trop sa fille pour entendre à un mariage qui ne pouvait la rendre heureuse. M. de Lauzun redoubla ses empressements, proposa d’épouser sans dot, fit parler sur ce pied-là à Mme de Frémont et à Messieurs de Lorge et de Duras, chez lequel l’affaire fut écoutée, concertée, résolue, par cette grande raison de sans dot, au grand déplaisir de la mère, qui, à la fin, se rendit, par la difficulté de faire sa fille duchesse comme l’aînée, à qui elle voulait l’égaler. Phélypeaux, qui se croyait à portée de tout, la voulait aussi pour rien, à cause des alliances et des entours, et la peur qu’en eut Mlle de Quintin la fit consentir avec joie à épouser le duc de Lauzun, qui avait un nom, un rang et des trésors. La distance des âges et l’inexpérience du sien lui firent regarder ce mariage comme la contrainte de deux ou trois ans, tout au plus, pour être après libre, riche et grande dame : sans quoi, elle n’y eût jamais consenti, à ce qu’elle a bien souvent avoué depuis.
Saint-Simon, Mémoires (chap. XV)
Notes de bas de page
De certains événements, de certaines figures, on dit parfois, métaphoriquement, qu’ils furent des notes de bas de page de l’Histoire. Il arrive que la chose soit vraie littéralement. Ainsi de ces personnages que l’on croise dans les notes de mémoires ou de biographies. Ce ne sont même pas des seconds rôles ; des figurants tout au plus, faisant une apparition furtive au fond du tableau. L’instant d’après, ils auront disparu, réengloutis dans le fleuve de l’oubli. Ils n’auront jamais droit à leur propre livre. Ils n’auront mérité au mieux que quelques lignes en petits caractères, par la grâce d’une anecdote ou d’un trait d’excentricité. Leur destin fait écho à ce mot de Marcel Schwob qui résonne comme une épitaphe : « Chacun d’eux ne posséda réellement que ses bizarreries. » (Vies imaginaires.)
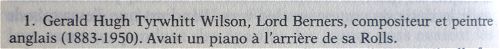
Harold Acton, Mémoires d’un esthète. Traduit de l’anglais par Jacques Georgel.
Julliard, 1991. La note est du traducteur.
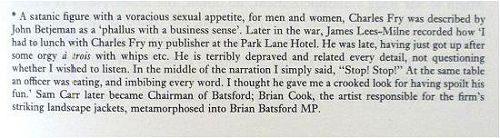
Jeremy Lewis, Cyril Connolly. A Life. Jonathan Cape, 1997.
Sur le Brexit
Peu d’exemples mettent mieux en évidence la manière dont les protagonistes de la politique arrivent à précipiter les maux ou les événements qu’ils redoutent le plus, et leur capacité de travestir ou d’annuler les effets désastreux de leur conduite, quand ils sont sortis de difficulté.
André Chastel, le Sac de Rome, 1527.
Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1984.