Les invisibles
 Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Dans une villa luxueuse, Claude Rains se réveille. Il fait beau, les petits oiseaux chantent. Le héros caresse un chat voluptueux et magnifique, s’approche de la fenêtre, prend des graines dans une boîte toute prête et les sème sur l’appui. Les petits oiseaux s’approchent, mangent et gazouillent. Lors Rains saisit une raquette, écrase les volatiles, en prend un et, le tendant à son chat : « Breakfast ? »
L’Épreuve de force
 Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.
Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.
Pour les jazzophiles, c’est Art Pepper et Jon Fadis qu’on entend sur la bande-son.
Summer Holiday
Musical en costumes vraisemblablement produit pour réitérer le succès commercial de l’admirable Chant du Missouri (Meet Me in St. Louis). De cette tranche de vie de province américaine, mettant en vedette l’insupportable Mickey Rooney qu’on a envie de noyer dans son milk-shake, il n’y a guère à sauver que l’excellent numéro d’ouverture, Our Home Town - présentation chorale de la famille Miller en parlé-chanté, conduite sur un tempo impeccable - et, à l’extrême rigueur, la pétarade du 4 juillet. Et puis, on est toujours content de revoir le merveilleux Frank Morgan (Mr Matuschek dans The Shop Around The Corner), qui campe ici un poivrot sympathique. Quant au reste, il faut s’infliger cette pâtisserie MGM pour mesurer par contraste le génie de Minnelli. Tout ce qui était tact et délicatesse infinie chez ce dernier se mue chez Mamoulian en plat conformisme et en vulgarité.

Walsh et la femme
Nancy Olson et Dorothy Malone dans Battle Cry, archétypes de la femme walshienne. Tout aussi libres d’allure que la femme hawksienne, mais avec une sensualité plus «nature», sans la part de jeu et de compétition dans l’insolence qui caractérise la guerre des sexes chez Hawks.

Aldo Ray et Nancy Olson dans Battle Cry
Call Northside 777
 De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.
De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.
Le film privilégie une approche semi-documentaire novatrice à sa date, proche par moments du reportage, avec recours ponctuel à la voix off, tournage dans une grande variété de décors réels - commissariat, pénitencier, bars et speakeasies, salle de rédaction d’un grand journal, - aperçus sociologiques sur la communauté polonaise de Chicago. Or, ce réalisme très convaincant s’appuie en fait sur une dramatisation serrée dans sa lenteur calculée, une mise en scène et une photo très élaborées, aussi précises qu’un tournage en studio. Par exemple, la scène du bélinographe, volontairement dilatée, est quasiment un mini-documentaire sur le fonctionnement de cet appareil ancêtre du télécopieur (dont on sent qu’il fascine le passionné de technique qu’était Hathaway), mais elle participe en même temps à la construction du suspense, et c’est magistral. (Plus tôt, une autre scène nous a initiés au fonctionnement du détecteur de mensonge ; son inventeur, Leonarde Keeler, y joue son propre rôle.)
La sécheresse factuelle du film, dénuée de pittoresque facile et de sentimentalisme, explique qu’il n’ait pas pris une ride, contrairement à bien des oeuvres plus ouvertement engagées de la même époque. À noter également, l’absence d’angélisme dans la description du travail quotidien de la presse (et a fortiori de la police et de la justice). McNeal n’a d’abord rien du redresseur de torts ; au contraire, il reste longtemps convaincu de la culpabilité de Wiecek. Comme son rédacteur en chef (sobrement interprété par Lee J. Cobb), c’est un professionnel de l’information qui a flairé une bonne histoire dont il pressent qu’elle fera vendre de la copie. Loin d’être éludée, l’ambiguïté du rôle de la presse (même lorsqu’il se révèle positif) est constamment discutée par les protagonistes, et cet élément concourt à la richesse du film, très juste aussi dans la peinture des rapports de force et de pouvoir, qu’ils soient personnels, institutionnels ou communautaires.
Au second plan, les scènes domestiques entre James Stewart et Helen Walker, écrites sur un mode plus léger de comédie conjugale, sont également très réussies. Elles voient notamment le couple s’adonner à l’art du puzzle, passe-temps favori de madame McNeal, et qui sert de métaphore à l’enquête du film : « Si tu ne trouves pas la place d’une pièce, il faut la regarder dans un autre sens », suggère-t-elle à Stewart, et c’est exactement ce qu’il va faire. Autre image-métaphore, ce plan très long où la vérité surgit littéralement d’un bain de révélateur photographique. Pouvoir de révélation de l’image ? La scène, quoi qu’il en soit, est magnifique.
Seules les dernières minutes du film appellent un léger bémol : la sortie de prison de Richard Conte (on s’attendrait à ce qu’il soit attendu par une armée de journalistes et de photographes, mais non), l’optimisme improbable du commentaire (un gage donné à la censure ?), Hathaway soudain n’y croit plus, d’ailleurs tout ça est expédié comme une concession. Et puis, qu’adviendra-t-il du complice supposé de Wiecek, vraisemblablement tout aussi innocent, mais au sort duquel personne ne semble s’intéresser, et qui paraît donc condamné à moisir en prison ? Mystère. À cela près, c’est un sans faute.

Holmes tel qu’en lui-même enfin…
 L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :
L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :
1. Adapter toutes les nouvelles et les romans de Conan Doyle (la mort de Jeremy Brett ne l’a malheureusement pas permis).
2. Faire table rase des adaptations passées pour revenir à la source des récits originaux.
Ce souci de fidélité à l’univers de Doyle se révèle extrêmement payant. Holmes est rendu à sa complexité, Watson n’est plus le gros balourd caricaturé dans tant de films, et l’œuvre retrouve la richesse de son arrière-plan - traversée de toutes les couches de l’Angleterre victorienne et coloniale -, son humour et sa noirceur (que de crimes passionnels commis sous l’emprise furieuse de la jalousie, ou révélant de sombres turpitudes !).
Si la réalisation est conforme aux standards de qualité du téléfilm britannique (c’est-à-dire soigneuse et appliquée jusqu’au moindre bouton de manchette, mais sans grande personnalité [1]), Jeremy Brett est pro-di-gieux dans le rôle-titre. Sa première apparition dans Un scandale en Bohème, sa voix, son regard, mille sabords, j’en frissonne encore. C’est que là où la plupart de ses prédécesseurs se sont contentés d’endosser le personnage comme on enfile un costume (la casquette à double visière, la loupe et le MacFarlane, lequel sauf erreur n’apparaît nulle part chez Doyle), Brett l’a véritablement intériorisé. Son interprétation magistrale nous donne à voir un Holmes obsessionnel, maniaco-dépressif et confiant à la cocaïne le soin de guérir sa mélancolie chronique, péremptoire, caustique et volontiers théâtral, quelque peu mystificateur aussi, pas nécessairement sympathique en somme, mais brûlant d’une flamme secrète et presque inquiétante, que raniment périodiquement l’arrivée d’un nouveau client et la perspective d’un « mystère insoluble » à éclaircir.
1. Au crédit de sa méticulosité, notons néanmoins que si l’Arsène Lupin médiocrement campé par Georges Descrières était toujours reconnaissable sous ses postiches à deux sous, le Holmes de Brett, qui ne le cède en rien dans l’art du déguisement, parvient à se rendre réellement méconnaissable, y compris pour le spectateur. Le talent des maquilleurs y a autant sa part que le génie du comédien.
***
Addendum (février 2007)
 La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke - et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.
La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke - et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.
Ars nova
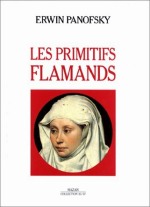 Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
L’introduction se penche sur le va-et-vient d’influences et d’emprunts réciproques entre l’Italie et la Flandre au XVe siècle, avec au passage un développement magistral sur l’avènement de la conception moderne de l’espace et l’invention de la perspective.
Les premiers chapitres analysent patiemment la lente transition qui conduit du gothique finissant à la Renaissance flamande proprement dite, traquée à la loupe à travers les livres d’heures et les miniatures franco-flamandes, l’art de la cour de Bourgogne et les écoles locales du Nord.
Tout aussi passionnant est le chapitre sur la réalité et le symbole dans la peinture flamande, où Panofsky montre par exemple, à propos de van Eyck, comment le symbolisme en vient à s’incorporer la totalité de la réalité représentée.
Suivent quatre grands chapitres consacrés aux grands maîtres de l’art flamand, le Maître de Flémalle, les van Eyck et Rogier van der Weyden. L’ouvrage se termine par une étude sur leurs continuateurs immédiats, Petrus Christus, Dirik Bouts, Geertgen tot Sint Jans, Hugo van der Goes, Gérard David, etc. Les peintres de cette génération ont conjuré l’héritage écrasant de van der Weyden en effectuant, chacun à leur manière, comme les Carrache un siècle plus tard, un retour aux sources pour mieux repartir de l’avant.
Panofsky unit la clarté de vues, l’érudition parfaitement dominée à un sens du détail au coup d’œil pénétrant, qui lui permet de retracer d’un peintre à l’autre la reprise et l’appropriation d’un motif. Chemin faisant, on apprend pourquoi van Eyck a commis une « faute » délibérée de proportion et de lumière dans sa Vierge de Berlin-Dahlem, quelle est la signification des fruits et de l’aiguière disposés dans les recoins d’une Annonciation, pourquoi l’âne baisse la tête tandis que le bœuf la lève dans une Nativité, quand s’est formulé le sentiment de la mélancolie au sens où nous l’entendons encore aujourd’hui, et bien d’autres choses encore. Bref, c’est le genre de lecture dont on sort en ayant appris à mieux voir, et c’est très stimulant.
 Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.
Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.
 Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :
Les films qu’on n’a pas vus occupent autant de place dans nos cinémathèques imaginaires que ceux qu’on a effectivement rencontrés. Qu’on n’a pas vus et qu’on ne verra peut-être jamais : tout ne sortira pas en dvd ; ce sont souvent des thrillers de série qui valaient pour un éclair, une trouvaille, un profil d’actrice, et leurs metteurs en scène, modestes faiseurs ou artisans capables, sont dépourvus de l’aura de l’« auteur » ou de l’artiste vaincu par le système qui assure redécouvertes, hommages et rétrospectives. Qui se soucie de Cornel Wilde, Hubert Cornfield, Jack Webb ou Robert Gist ? Adonc, rêvons du jour où un studio exhumera de ses fonds de tiroir The Naked Pray, See You in Hell, Darling, Pete Kelly’s Blues et tant d’autres croisés au détour d’un article ou d’une photographie jaunie. Liste à laquelle j’ajoute aujourd’hui Lisbon de Ray Milland, dont une notule anonyme d’un vieux Positif (n° 22, mars 1957) décrit ainsi la séquence d’ouverture :





 Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.
Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.

 De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.
De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.
 L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :
L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double : La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke - et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.
La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke - et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.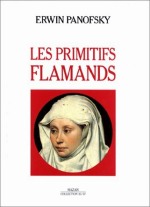 Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux.
Érudit, méthodique, dense mais d’une grande clarté, voici un passionnant voyage dans l’Ars nova flamand avec l’Hercule Poirot de l’iconologie. Issue d’un cycle de conférences, cette somme conjoint souplement approche historique et analyse stylistique, vues générales et études approfondies de certains tableaux. Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.
Erwin PANOFSKY, les Primitifs flamands. Traduit de l’anglais par Dominique Le Bourg. Hazan, 1992, 806 p.