L’omnibus automobile
C’était pendant l’horreur du Quatorze Juillet,
Il faisait chaud, très chaud, sur la place Pigalle.
Un gros ballon, sans bruit, gravement ambulait
Par la route céleste unique et nationale.
Il faisait soif, très soif et le petit jet d’eau,
Esclave du destin, montait de bas en haut.
Il était environ neuf heures trente-cinq,
La douce nuit venait de tomber avec grâce.
Et le petit jet d’eau pleurait sur le bassin,
Lorsque je vis passer au milieu de la place
Un omnibus, automobile, entendez-vous,
Avec de grands yeux verts et rouges de hibou.
L’omnibus était vide et l’écriteau « Complet »
Détachait sur fond bleu ses sept lettres de flamme.
Je suivis au galop le monstre qui passait
En écrasant avec des airs d’hippopotame
Des femmes, des enfants, des chiens et des sergots,
Des députés et des tas d’autres animaux.
Enfin il s’arrêta place de l’Opéra
Et je vis qu’il était chargé de sacs de plâtre.
Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là
Pour remplacer le voyageur acariâtre;
Nous faisons des essais depuis plus de vingt mois
Et ces sacs sont pour nous autant de gens de poids.
Mais pourquoi, dis-je au bon conducteur de l’auto
Qui venait d’écraser ces piétons anonymes,
Pourquoi des sacs plutôt que ce cher populo ?
C’est, me répondit-il, sur un ton de maxime,
C’est, voyez-vous, pour éviter des accidents
De personnes qui pourraient bien être dedans.
C’était pendant l’horreur du Quatorze Juillet,
Il faisait chaud, très chaud, sur la place Pigalle.
Un gros ballon, sans bruit, gravement ambulait
Par la route céleste unique et nationale.
Il faisait soif, très soif et le petit jet d’eau,
Prisonnier du destin, montait de bas en haut.
Paroles de Vincent Hyspa, musique d’Erik Satie.
 Chanté par la soprano Measha Brueggergosman sur un disque épatant, Surprise (airs et cabaret songs de William Bolcom, Schoenberg et Satie ; Deutsche Grammophon, 2007). Recension ici.
Chanté par la soprano Measha Brueggergosman sur un disque épatant, Surprise (airs et cabaret songs de William Bolcom, Schoenberg et Satie ; Deutsche Grammophon, 2007). Recension ici.
Venu de Narbonne à Paris étudier le droit, Vincent Hyspa (1865-1938) fit carrière de chansonnier au Chat noir, puis aux Quat’z’Arts, aux Noctambules et à la Lune rousse. Petits rôles au cinéma dans À nous la liberté, Avec le sourire, la Belle Équipe, l’Étrange Monsieur Victor, etc.
Erré-je tout à fait en rapprochant ce texte délicieux de la Cynégétique de l’omnibus d’Alfred Jarry ? « Des diverses espèces de grands fauves et pachydermes non encore éteintes sur le territoire parisien, aucune, sans contredit, ne réserve plus d’émotions et de surprises au trappeur que celle de l’omnibus », etc.
All that jazz
 La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?
La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?
Même après douze ans de fréquentation régulière, c’est toujours un bonheur de se plonger dans le Penguin Guide ; d’occuper ses longues soirées d’hiver à mettre ses listes à jour, en pointant ses accords (c’est bien vrai que le dernier Paul Motian est d’un ennui soporifique) et ses désaccords (hein, comment ça, rien que trois étoiles et une courte ligne pour le magnifique duo Fred Anderson/ Harrison Bankhead au Vision Festival ?). Quitte à s’agacer ponctuellement de quelques erreurs vénielles non rectifiées d’une édition à l’autre, de certaines contradictions (I Love It When You Snore de Mats Gustafsson et Paal Nilsen-Love est ici référencé deux fois, sous le nom des deux musiciens, avec un commentaire tantôt tiède et tantôt enthousiaste) ou, plus sérieusement, à s’étonner de l’absence persistante de certains musiciens ou de disques couramment disponibles.
Ce qui épate chez Cook et Morton, c’est la capacité à embrasser le spectre entier du jazz avec une égale fraîcheur d’écoute, depuis les New Orleans Rhythm Kings jusqu’à Evan Parker ou Peter Brötzmann, le talent à parler avec autant de pertinence du classique et du moderne, du mainstream et de l’avant-garde. À cette largeur de vue s’ajoute la qualité de l’écriture. Dans un domaine où l’impressionnisme vague est trop souvent de rigueur, le tandem parvient à rendre compte d’un disque d’une manière à la fois directe, précise et empathique, dans une prose alerte et spirituelle où abondent les traits d’humour. Les treize pages serrées consacrées à Miles Davis — pour ne prendre que cet exemple — disent à elles seules plus et mieux que bien des monographies. On sent, à lire les auteurs, un rapport vivant, quotidien, à la musique, où tout un chacun reconnaîtra sa propre expérience d’auditeur, et qui les conduit notamment à réviser ou affiner leur jugement d’une édition à l’autre, au fil des réécoutes ou à la lumière de l’évolution d’un artiste. Leur indifférence aux sirènes de la mode et du marketing, leur énervement face à l’inflation des compils redondantes, aux tombereaux de chanteuses insipides lancées comme des savonnettes et aux repackagings luxueux qui n’emballent que du vent sont des plus rafraîchissants. Enfin, là où d’autres ouvrages du même genre restent américano-centrés, celui-ci se signale par la place accordée aux musiciens européens — mais aussi asiatiques, africains, australiens… (Signalons pour info que le jazz français est nettement moins bien représenté que le jazz scandinave par exemple, ce qui est peut-être imputable à des problèmes de distribution, un bon paquet de disques français peinant manifestement à franchir la Manche.)
Reste qu’avec ses 1 600 pages, le Penguin Guide a fini par atteindre une masse critique. Il lui est impossible de croître encore en volume. Malgré l’espace gagné en composant le texte sur deux colonnes, puis en diminuant le corps des caractères et en rognant sur les marges, enfin en décidant depuis deux éditions de commenter lapidairement certains disques dans une rubrique « en bref » à la fin de l’entrée de musiciens particulièrement prolifiques, l’exhaustivité est devenue un objectif inatteignable. Concrètement, cela signifie que si un nombre appréciable de nouveaux disques font leur entrée à chaque édition, un nombre d’albums tout aussi important passe au bleu (d’où la nécessité de conserver les éditions précédentes et de naviguer d’un volume à l’autre pour retrouver la trace de certains enregistrements : prévoyez une grande table). L’ouvrage prétend certes rendre compte des disques « couramment disponibles sur le marché ». Dans les faits, cette notion de « disponibilité » est des plus aléatoires — compte tenu de l’existence des boutiques d’occasion, du développement du commerce en ligne (où quantité de disques disparaissent et réapparaissent continuellement au petit bonheur même après qu’ils ont été déclarés officiellement épuisés) et de l’explosion des micro-labels indépendants pratiquant la vente directe sur la toile. Par ailleurs, le Guide m’a souvent paru, d’édition en édition, la manier avec quelque arbitraire. Pour cette fois, si l’on est content du retour d’André Jaume et de Daunik Lazro, et enchanté de l’inclusion méritée de Dorothy Dandridge et de la délicieuse Blossom Dearie (il était temps), on s’étonne entre autres de l’éviction de l’excellent Atomic, groupe free-bop suédois en plein essor, dont les disques sont convenablement distribués.
Il y aurait encore bien des remarques d’ordres divers à formuler, mais cet article est déjà trop long et ce sont là les pinaillages d’un vieil usager. Les mérites de l’ouvrage surclassent de loin ses lacunes, le Penguin Guide reste une somme sans concurrent sérieux dans sa catégorie, et avec ses 14 000 CD référencés, il y a là plus que la plupart des jazzophiles même enragés pourront ou souhaiteront écouter dans l’espace d’une vie. Au néophyte qui ne saurait trop par où commencer, il rendra des services inappréciables en l’aidant à s’orienter dans le maquis des nouveautés et des rééditions. Quant à l’amateur plus aguerri, il croisera au fil des pages des dizaines de musiciens dont il n’a jamais entendu parler, et qu’il aura envie de découvrir séance tenante.

Richard COOK & Brian MORTON, The Penguin Guide to Jazz Recordings, Ninth Edition. Penguin, 2008, 1 646 p.
On peut lire les chroniques de Richard Cook pour New Statesman ici.
Brian Morton tient une chronique dans l’excellente revue en ligne Point of Departure, à laquelle il donne également des recensions de disques. Il est aussi l’auteur d’un livre sur la musique contemporaine que j’ai commencé seulement d’éplucher, The Blackwell Guide to Recorded Contemporary Music.
Giant strides
Et pendant les travaux, la faucheuse continue, et nous parvient avec un léger retard la nouvelle de la mort de Dave McKenna, survenue le 18 octobre. Nous avions beaucoup d’attachement pour ce pianiste mainstream, le meilleur dans sa catégorie, pourvu d’une solide main gauche et d’une connaissance encyclopédique du répertoire, et qui swinguait avec une intelligence et un allant roboratifs. Homme affable, effacé et discret, lui-même se qualifiait modestement de « saloon piano player », mais à ce compte, nous aurions volontiers passé toutes nos soirées dans le saloon qui l’aurait eu pour pianiste. S’il a joué avec plusieurs autres mainstreamers de sa trempe (Zoot Sims, Ruby Braff, Scott Hamilton, Warren Vaché), c’est en solo qu’il était vraiment à son affaire, investissant la totalité du clavier, la main gauche jouant les walking bass ou ressuscitant le bon vieux stride tandis que la droite se promenait librement en se riant des changements de tonalité. Un soir de concert, alors que circulait en coulisses la nouvelle de la paternité toute fraîche de l’ingénieur du son, McKenna fit celui qui n’avait rien entendu mais improvisa en seconde partie un pot-pourri de standards ayant tous « baby » dans le titre (I’ve Found a New Baby, Walking My Baby Back Home, Everybody Loves My Baby, etc.). C’était typique de sa manière. On se fera une idée agréable du talent de ce merveilleux bonhomme en faisant un tour sur Youtube, ou en piochant dans la série d’albums enregistrés pour Concord, notamment Giant Strides, Dancing in the Dark, Live at Maybeck, Shadows and Dreams et A Handful of Stars.
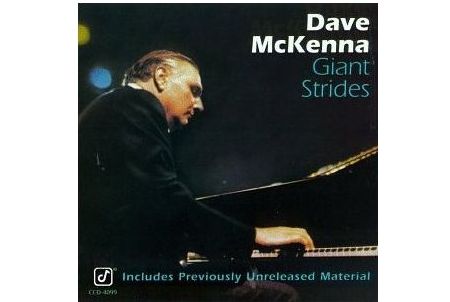
À Stockholm, au mitan des années 1960
 Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.
Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.
 Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.
Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.
Ken Vandermark
À moins de disposer de loisirs et de phynance illimités, suivre Ken Vandermark à la trace relève de la mission impossible. Fer de lance du renouveau de la scène chicagolaise, compositeur, poly-instrumentiste et chef de bande – mais bien moins leader en l’occurrence que meneur de jeu –, ce splendide quadragénaire anime ou participe à une quarantaine de groupes et de « projets » (c’est presque un gag) aux effectifs les plus variés : les uns ne connaissant qu’une existence ponctuelle, les autres à présent bien établis dans la durée, tel le Vandermark 5, sa formation la plus régulière, et peut-être le combo qu’on associera dans trente ans aux années 1990-2000, comme on associe les Jazz Messengers aux années 1950 et le second quintette de Miles à la décennie suivante.
Généreuse et tonique, la musique de Vandermark est un heureux carrefour dont la principale avenue reste le jazz, mais vers où convergent rock, rhythm’n’blues, free caressant ou torrentueux, et jusqu’aux contrepoints subtils de la West Coast, dans une synthèse hautement personnelle et jubilatoire. Un exemple parmi d’autres ? L’album 13 Cosmic Standards, qui alterne des compositions de Sun Ra et de George Funkadelic Clinton (il fallait y penser, et ça marche !). Là où d’autres refont le même disque chaque année, il est peu de musiciens aujourd’hui à proposer pareille variété de climats ; peu à couvrir un spectre d’une telle amplitude, depuis la composition la plus élaborée jusqu’à l’improvisation la plus radicale. Et l’on n’en voit pas d’autres pour fondre organiquement en un seul creuset le sérialisme d’un Evan Parker et la puissante assise rythmique d’un ténor musclé à la Eddie Lockjaw Davis. Vandermark, sans jeu de mots, connaît la musique. Cependant, la liste invraisemblable des dédicataires de ses pièces – qui va de Shelly Manne à Cecil Taylor en passant par Herbie Nichols et Pee Wee Russell, Stan Getz et Julius Hemphill, Albert Ayler et Witold Lutoslawski… – ne dessine ni un palmarès ni le programme d’études du parfait petit postmoderne. Elle est plus proche d’un inventaire festif à la Prévert, et témoigne qu’on peut payer un tribut paradoxal à la tradition sans cesser d’aller de l’avant.
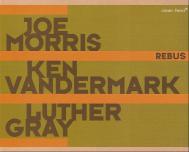 Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.
Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.
 Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).
Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).
1. Pour un avis plus favorable, lire la chronique du Grisli.
Discographie vandermarkienne très sélective :
Barrage Double Trio : Utility Hitter (Quinnah)
Vandermark 5 : Target or Flag ; Airport for Lights ; Simpatico ; Elements of Style, Exercices in Surprise (Atavistic)
School Days : In Our Time ; Crossing Division (Okkadisk)
NRG Ensemble : Bejazzo Gets a Face Lift (Atavistic)
Joe McPhee/Ken Vandermark : A Meeting in Chicago (Okkadisk).
Aaly Trio + Ken Vandermark : Stumble (Wobbly Rail)
Steelwool Trio : International Front (Okkadisk)
Spaceways Incorporated : 13 Cosmic Standards (Atavistic)
Sound in Action Trio : Design in Time (Delmark)
La griffe de Griffin

Un de mes premiers souvenirs radiophoniques de jazz, c’est un solo de ténor endiablé, phénoménal, sur un thème excitant de Gillespie, Wee ; emballé à toute allure mais imparablement tenu, et comme se consumant dans l’instant avec un brio étourdissant. Le pilote de ce bolide de course était un saxophoniste dont j’appris alors le nom, Johnny Griffin. Comme pour tant d’autres musiciens (Mal Waldron, Steve Lacy, Zoot Sims, Art Farmer,…) entendus à l’émission Jazz Soliloque de Gilles Archambault, qui aura constitué pour les gens de ma génération un cours du soir de jazz, il m’en est resté une affection durable qui est celle des premières découvertes.
Un des moments les plus drôles du film de Charlotte Zwerin, Straight, No Chaser, c’est une scène de coulisse d’un concert de Monk. On y voit Griffin entre deux sets se préparer un drink à sa façon : une bouteille de Coca dans une main, une topette de whisky dans l’autre, il se rince alternativement le gosier avec chacun de ces liquides en agitant la tête pour bien mélanger, avec une grimace irrésistible. Ailleurs, le film de Zwerin nous le montre très pro et concentré dans le travail, joyeux loustic le reste du temps – il faut le voir arborer fièrement un invraisemblable pantalon rayé sous l’œil goguenard de ses camarades de tournée.
Bref, le musicien débordait d’une vitalité contagieuse, tandis que l’homme inspirait une sympathie immédiate ; et si quatre-vingts ans est un âge respectable pour tirer sa révérence, c’est quand même avec un pincement au cœur qu’on apprend aujourd’hui la nouvelle de sa mort.
Griffin était un lion. Le hard-bopper par excellence, section Chicago, l’homme des duos-duels de ténors kolossaux avec Eddie Lockjaw Davis, mais aussi d’associations plus étonnantes (un disque en duo avec Martial Solal). Énergie, fougue et vélocité : ses meilleurs disques vous regonflent à bloc, on s’en sert une rasade au petit déjeuner et c’est une cure de vitamine C pour affronter les journées grises d’hiver.
Mais la puissance de feu, appuyée sur une technique à toute épreuve, dissimule à peine la finesse et l’humour d’un musicien bien plus futé qu’il n’y paraît. Elles en firent un partenaire de jeu aussi inattendu qu’idéal pour Thelonious Monk, «unperturbed by any idea that Monk’s music was difficult », écrivent joliment Cook et Morton. Sur les deux disques de leur concert au Five Spot, il s’empare des thèmes avec un panache flamboyant auquel s’ajoute une touche typique de malice et d’extravagance. J’ai toujours en mémoire ce moment délicieux où il transforme Evidence en ritournelle de garderie d’enfants, avant de repartir au quart de tour, en se jouant des passages d’accords anguleux de ce morceau particulièrement retors.
L’ami Tatum propose sur son blogue un superbe solo du Little Giant. Courez-y.
Valses pour Resnais
 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.
Pas de metteur en scène plus passionné de musique que Resnais ; pas de cinéaste plus musical non plus. C’est musique que les célèbres travellings envoûtants et le montage contrapuntique, les dialogues psalmodiés d’Hiroshima ou pulvérisés de Muriel, le récitatif obsédant de Marienbad, le goût des accents étrangers, les acteurs qui se mettent à chanter avec leur voix (Muriel, La vie est un roman, Pas sur la bouche) ou celle des autres (On connaît la chanson). Providence est un grand opéra fantasmatique, l’Amour à mort un opéra de chambre viennois ; Stavisky… ne fonctionne que si on le reçoit comme un musical onirique sans chorégraphies.
D’Hiroshima mon amour à Cœurs, ce Portrait musical d’Alain Resnais propose un panorama presque exhaustif de ses longs métrages (dommage qu’on n’ait pas fait une petite place à Kander, le tableau aurait été complet). Il dessine, en treize compositeurs, un paysage d’une grande variété et d’une surprenante cohérence, hanté par une certaine qualité de rêverie inquiète que résume idéalement le fox-trot lancinant de Sondheim pour Stavisky…, et dont témoigne aussi la récurrence de valses à la fois ironiques et vénéneuses. Car si la musique au cinéma, selon Resnais, a notamment pour fonction « de faire mieux sentir la construction du film », celle qu’il obtient de ses compositeurs a aussi pour vertu d’en laisser le sens ouvert, comme en suspens dans l’air — à l’image des méduses d’On connaît la chanson —, d’en épanouir et d’en prolonger la résonance en nous.
 Alain Resnais, portrait musical. Universal.
Alain Resnais, portrait musical. Universal.
1. Avec ce trait de monomanie sympathique révélé par Bruno Fontaine, où se reconnaîtront les complétistes acharnés : « [Resnais] m’a aussi avoué son grand problème : ne pouvoir appréhender un compositeur que dans sa stricte intégralité. S’il commence à écouter Honegger, il lui faut acheter tout Honegger. Il a ce fonctionnement encyclopédique avec tous les sujets qui l’intéressent. »
 Chanté par la soprano Measha Brueggergosman sur un disque épatant, Surprise (airs et cabaret songs de William Bolcom, Schoenberg et Satie ; Deutsche Grammophon, 2007). Recension ici.
Chanté par la soprano Measha Brueggergosman sur un disque épatant, Surprise (airs et cabaret songs de William Bolcom, Schoenberg et Satie ; Deutsche Grammophon, 2007). Recension ici.





 La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une
La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une 
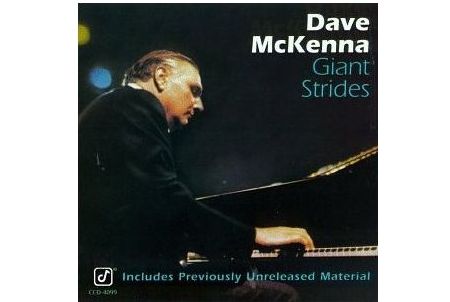
 Toujours actif en club et en studio,
Toujours actif en club et en studio, 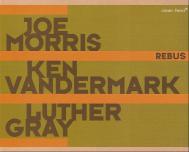 Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une
Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une 
 Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale
Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale