Ganelin Trio
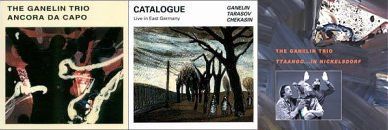
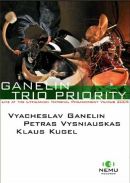 Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois - en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, - Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois - en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, - Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
 Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.
Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.
Simulacre
De la goujaterie médiatique. Rien ne remplace, dit-on, l’expérience du concert. Alors, foin de musique en conserve, bougeons nos fesses et allons voir le sextet de Machin au festival de Brol (pour lequel je me refuse à faire la moindre réclame même indirecte). Et là, juste avant l’entrée des musiciens en scène, un monsieur pincé de l’équipe du festival, aux allures de quinca branché travaillant dans la pub, vient nous informer que le concert sera filmé pour la télé et qu’en conséquence :
- le public est prié de remplir les places vacantes au devant du parterre pour que la salle n’ait pas l’air clairsemée, ça ferait mauvaise impression.
- les gens qui veulent quitter la salle (plusieurs concerts ont lieu simultanément et pas mal de gens « zappent » d’un concert à l’autre, c’est d’ailleurs désagréable) sont priés de ne pas le faire pendant les applaudissements parce qu’à ce moment-là les caméras seront tournées vers la salle et que ça ferait désordre aussi (genre : ce concert est nul, tout le monde se barre). Si vous voulez sortir, faites-le pendant les morceaux (là, ce sont les musiciens que ça risque de perturber, mais quelle importance ?)
Tout cela énoncé sans amabilité, sur un ton agacé d’une morgue invraisemblable. On croit rêver. En somme j’ai payé ma place pour faire de la figuration intelligente à la télé. Public, tu n’es pour ces gens-là que du bétail (heureusement, ledit bétail n’en fera qu’à sa tête). Et les musiciens sont logés à la même enseigne.
Durant toute la durée du concert, une caméra-robot posée sur rails se promène dans la fosse en balayant la scène d’un mouvement pendulaire hypnotisant. Une autre caméra montée sur grue plane au-dessus de nos têtes comme un oiseau de proie menaçant. Ambiance très Big Brother. Et quand le pianiste entame son solo, un caméraman se plante devant pour cadrer ses mains et bien nous boucher la vue. On aura quand même le plaisir de voir Machin s’énerver sur le deuxième caméraman accroupi dans le chemin, qui l’empêchait de revenir prendre à temps son solo au centre de la scène. N’empêche que ce déploiement technologique aura volé, par son parasitisme intempestif, la vedette de la soirée, et avec un côté : « ôtez-vous de là que je m’y mette, foutus musicos qui m’empêchez de faire mon travail. » Si bien que je n’aurai pas eu l’impression d’assister en direct à un concert, mais d’être déjà en différé, dans la diffusion future de la soirée à la télé - en somme, de participer à un simulacre. Un « live » déréalisé en temps réel, il fallait le faire. Eh bien merci beaucoup. La prochaine fois je resterai chez moi à écouter de la musique en conserve, ça nous fera gagner du temps.
Monk’s Casino
 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
 Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Alexander von SCHLIPPENBACH, Monk’s Casino. Rudi Mahall (clb), Axel Dörner (tp), Jan Roder (cb), Uli Jennessen (bt). Intakt Records 100 (2003-2004).
Tina May
 A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux - alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté - jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture - à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux - alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté - jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture - à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
 Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).
Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).
Lennie’s Pennies
 Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Le concert est filmé comme ils devraient toujours l’être. Quelques angles bien choisis, le visage, les mains, des plans longs et le plus souvent fixes, entièrement au service de la musique qui n’en devient que plus captivante.
 Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Lennie TRISTANO solo, The Copenhagen Concert (1965). DVD Storyville Films 3360603.
Anita O’Day (1919-2006)

Bien sûr il y a Ella, Billie, Sarah, sans oublier notre chère Helen Merrill… mais dans notre coeur il y avait, il y aura toujours une place spéciale pour Anita : sa classe et sa gouaille de délurée, ses scats acrobatiques, le grain sensuel de sa voix à tomber raide amoureux, sa science éblouissante du phrasé qui savait vous faire chavirer rien qu’en plaçant une note altérée en bout de phrase, son caractère en acier trempé: il fallait ça pour débuter adolescente dans les marathons dansants façon On achève bien les chevaux, avant de rejoindre le big band de Gene Krupa (elle refuse la robe du soir qui était alors l’apanage des chanteuses pour se produire en veston et jupe courte); et pour affronter bravement des parterres de crétins qui la sifflèrent et l’insultèrent grossièrement à Comblain-la-Tour en 1966 et Paris en 1970 parce qu’elle était blanche.
Elle resta étiquetée chanteuse de big band, et Verve la fit souvent enregistrer avec grand orchestre et arrangements profus, mais elle préférait le travail en petite formation et c’est dans ce contexte qu’elle aura donné le meilleur d’elle-même.
High Times, Hard Times, le titre de son autobiographie résume parfaitement une carrière en dents de scie. Mais cette battante aura survécu aux coups durs, à l’alcool et à la drogue, et continuait, à quatre-vingts ans passés, à se produire sur scène et à donner des interviews de grande dame indigne, réjouissantes d’humour et d’esprit.
Sa discographie disponible reste lacunaire, Verve ayant préféré, à quelques exceptions près, la saucissonner en compils (d’ailleurs bien composées) plutôt que rééditer les albums originaux (plusieurs d’entre eux furent repressés au Japon, mais sont à présent introuvables). Dans l’état actuel du catalogue, on se fera une bonne idée de l’étendue de son art en fréquentant les disques Anita Sings The Winners, Pick Yourself Up, Anita Sings the Most, Jazz Masters 1949 et Anita O’Day’s Finest Hour.
On peut enfin la voir dans Jazz on a Summer’s Day (festival de Newport, 1958), film aussi passionnant qu’agaçant en raison d’un montage absurde qui privilégie les vignettes d’ambiance sur les plaisanciers et les badauds mangeurs d’esquimaux glacés au lieu de se concentrer sur les musiciens. Mais enfin, Anita est là, en robe noire et sous un chapeau extravagant, qui détaille avec une gourmandise narquoise un Sweet Georgia Brown en crescendo avant d’emballer Tea for Two à toute vibure, jusqu’à une finale gag irrésistible. Quelle femme !
***
Addendum (mars 2008). Depuis que ces lignes furent écrites, certains Verve japonais sont à nouveau sporadiquement disponibles sous nos cieux. This Is Anita, Trav’lin’ Light, Waiter, Make mine Blues et Cool Heat (superbement arrangé par Jimmy Giuffre) sont tous d’excellents disques. Sous le titre Anita Sings for Oscar, Lonehill Jazz a réuni sur une seule galette Pick Yourself Up et Anita Sings the Most : excellente affaire (quoi qu’on pense des pratiques peu scrupuleuses de ce label). Néanmoins, il serait grand temps que Verve fasse à Anita l’honneur d’une intégrale soignée, sur le modèle de celles de Lester Young et de Billie Holiday.
Destination… Out !
Sous cet intitulé emprunté à l’un des meilleurs Blue Note de Jackie McLean se cache un excellent blogue consacré au free jazz, avec nombreux extraits en èmme-pé-trois de disques rares ou épuisés, qui restent accessibles une quinzaine de jours.
À ne pas manquer pendant que c’est en ligne, une pièce aussi brève que volcanique de Pharoah Sanders avec le Jazz Composers Orchestra, Preview, d’une montée en puissance impitoyable. On dirait la bande-son d’un de ces rêves où un désastre imminent va nous foudroyer sur place et qu’on reste paralysé, incapable d’arracher les pieds du sol.

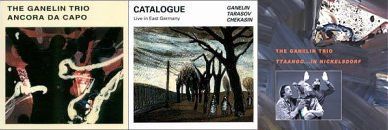
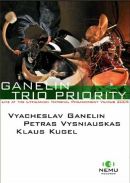 Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois - en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, - Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.
Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois - en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, - Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio. Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.
Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.





 Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman.
Toutes les compositions de Thelonious Monk. 71 morceaux ramassés sur trois CDs, en un programme conçu pour être éventuellement interprété en une fois au cours d’un concert-marathon, rarement disques auront autant mérité l’adjectif de compacts. Ç’aurait pu être un album concept à la noix, le type même de la fausse bonne idée. Sauf que pas du tout. D’abord parce que peu d’œuvres, dans l’histoire du jazz, sont justiciables d’une telle entreprise. Ensuite parce que celle-ci invite à méditer sur ce qu’est un compositeur de jazz, par opposition à un simple auteur de thèmes ; et encore sur le propre rapport mystérieux de Monk à son œuvre, puisqu’il aura passé sa vie à rejouer inlassablement une quinzaine de ses compositions, tandis qu’il n’en grava d’autres qu’à une ou deux reprises, et ce ne sont pas les moins belles (Erronel, Introspection ou Light Blue, parmi d’autres joyaux secrets). Enfin et surtout parce que l’exécution est un modèle d’intelligence et d’esprit, qui célèbre en Monk non point un monument qu’on visite avec déférence mais l’auteur d’une musique toujours vivante, énigmatique, excitante parce que déconcertante, avec ses pas de côté, ses dissonances calculées, ses traits d’humour exhilarants. Vétéran de la scène free européenne, partenaire de longue date d’Evan Parker, Schlippenbach a réuni autour de lui quatre jeunes musiciens avec, côté souffleurs, une trompette et une clarinette basse (miam !), dont le timbre boisé enrichit d’une couleur nouvelle des airs qu’on croyait connaître par cœur. Loin de l’hommage muséographique, le turbulent quintette nous entraîne, à l’image de la roulette qui orne les pochettes, dans un joyeux carrousel où les thèmes s’enchaînent rapidement, joués tantôt straight et tantôt free, en un éventail qui va du quasi-pastiche clin d’oeil à la déconstruction sauvage. La plus longue plage dure dix minutes, certaines moins de 60 secondes, la plupart de deux à quatre minutes. Ajouté à la pratique ponctuelle du medley, il en résulte un effet de collage ou de kaléidoscope, dont la joie étrange et dansante rappelle par endroits le premier quintette d’Ornette Coleman. A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux - alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté - jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture - à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !
A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux - alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté - jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture - à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
Ce n’est jamais sans émotion qu’on voit jouer Lennie Tristano. D’abord parce que ses prestations filmées sont rarissimes, Tristano s’étant très tôt retranché de la scène pour vivre en ermite dans son domicile new-yorkais, transformé en cours privé et en studio d’enregistrement. Ensuite parce que c’est un spectacle fascinant que celui de cet homme retiré dans son monde intérieur, cécité oblige, un sourire indéfinissable flottant sur les lèvres, le buste immobile tandis que les mains courent sur le clavier ; des mains incroyables, au doigté vertigineux, la gauche assurant la ligne de basse tandis que la droite, en parfaite indépendance, déconstruit-reconstruit inlassablement une poignée de standards en alternant block-chords et longues phrases serpentines. Il y a un mystère Tristano comme il y a un mystère Monk. Ces deux pianistes n’ont rien en commun, sinon d’être contemporains et d’avoir, en prenant appui sur le socle du be-bop pour mieux faire un pas de côté, élaboré un univers énigmatique et radicalement singulier, dont la beauté semble chue d’une autre planète. C’est pourquoi les voir jouer est si éclairant. Et tandis que le beau documentaire de Charlotte Zwerin consacré à Monk, Straight, No Chaser, montrait comment l’étrangeté du jeu monkien impliquait un engagement du corps tout entier, ce récital de Tristano donne à voir un pianiste à la fois concentré et détendu, chez qui le sens aigu de la structure et une motricité sans raideur concourent à l’éclosion d’un swing paradoxal. Tristano se montrait circonspect quant à l’évolution du jazz moderne (« all emotion and no feeling »). Sans être obligé de partager ce jugement, force est de reconnaître qu’il n’y a pas d’émotion facile ici, mais un feeling certain, et un plaisir de jouer, propres à démentir les qualificatifs qui s’accrochèrent longtemps comme des casseroles à sa musique (intellectuel, froid, cérébral…).
