Guerre de succession
Diffusé mardi dernier sur Arte, The Deal de Stephen Frears apparaît après coup comme un prologue à The Queen, réalisé trois ans plus tard avec la même équipe (scénario : Peter Morgan ; montage : Lucia Zuchetti ; production : Christine Langan et Andy Harries). Le film dépeint la relation complexe entre Tony Blair et Gordon Brown, depuis leur première rencontre en 1983 — alors que, jeunes députés de l’opposition, ils partagent un bureau exigu à Westminster — jusqu’à la course à la chefferie du parti travailliste en 1994, ouverte par la mort de son leader John Smith, qui transforme les deux « amis de quinze ans » en frères ennemis.
Il n’y a semble-t-il qu’au pays de Shakespeare et de Channel Four qu’on peut voir ça: la recréation d’un épisode récent de l’Histoire dont les protagonistes sont toujours en poste. The Deal est un modèle du genre, qui unifie en un tout narratif et visuel cohérent les faits avérés et les spéculations plausibles (étayées par une solide base documentaire), les déclarations publiques et les tractations de couloir, les scènes reconstituées et les images d’archives télévisuelles. Le regard, sans complaisance, est dénué de cynisme facile comme de fausse candeur moraliste. Entre le blanc-bec pragmatique au sourire de premier communiant, expert au maniement des médias, et l’idéologue intègre et pugnace mais assez mal embouché, le film ne tranche pas, mais nuance avec finesse le contraste de leurs caractères, en même temps qu’il appréhende avec une grande intelligence la dynamique des rapports de force et l’importance cruciale du timing dans la conquête du pouvoir. Toute considération morale à part, savoir anticiper un basculement d’alliance et saisir le moment opportun pour avancer ses pions constitue l’un des fondements de l’action politique — avantage ici à Blair1.
Une telle réussite passe nécessairement par la force de l’incarnation (l’une des pierres d’achoppement des fictions françaises dans la représentation du pouvoir), la manière dont les corps, les voix et les regards donnent épaisseur et chair au drame. Michael Sheen est parfait dans le rôle de Blair (qu’il a repris depuis dans The Queen), David Morrissey impressionne dans la peau de Gordon Brown, bouillant taureau taillé tout d’un bloc (on se fera une idée de l’étendue de sa palette en comparant sa prestation avec son rôle de député veule dans State of Play).

1 On se souvient par contraste de cette scène de 1974, une partie de campagne de Depardon, où Giscard donne à ses conseillers une magistrale leçon d’inaction : à ce stade de la campagne, explique-t-il en substance, la meilleure tactique est de ne rien faire.
Avant-dernières nouvelles du 87e
Cinquante-cinquième et cinquante-sixième épisodes de la saga du 87e district d’Isola, le Frumieux Bandagrippe et Jeux de mots confirment l’intérêt d’Ed McBain pour les jeux de langage (cf. par exemple le Dément à lunettes). Cet ingrédient fait d’ailleurs l’attrait principal de ces deux romans qui m’ont paru dans l’ensemble assez plats.
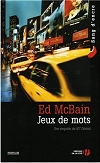 Onze ans après Poissons d’avril, Jeux de mots voit le retour du Sourdingue, qui est aux flics du 87e ce que Moriarty fut à Sherlock Holmes. Ce plaisant psychopathe aime, à la façon du Riddler de Batman, annoncer les coups qu’il mijote par l’envoi d’une série de messages sibyllins. Fidèle à sa tactique, il engage ici une nouvelle guerre des nerfs avec Steve Carella et ses collègues en les bombardant de citations tirées du théâtre de Shakespeare et de messages cryptés à base d’anagrammes et de palindromes – obligeant les inspecteurs du 87e à se muer en déchiffreurs d’énigmes d’autant plus retorses qu’elles pointent vers plusieurs pistes à la fois. Le spectacle de ces flics très inégalement futés confrontés à des devinettes littéraires de haut vol est plutôt réjouissant ; par ailleurs j’ai toujours eu un faible pour le Sourdingue, que McBain parvient à rendre réellement inquiétant sans forcer la note (on sent que ce type est capable de tout). Et, comme disait Hitchcock, « plus réussi est le méchant…» Reste que ce roman sans climax s’effiloche insensiblement – peut-être parce que Carella y est le plus souvent condamné à l’attente et à l’inaction.
Onze ans après Poissons d’avril, Jeux de mots voit le retour du Sourdingue, qui est aux flics du 87e ce que Moriarty fut à Sherlock Holmes. Ce plaisant psychopathe aime, à la façon du Riddler de Batman, annoncer les coups qu’il mijote par l’envoi d’une série de messages sibyllins. Fidèle à sa tactique, il engage ici une nouvelle guerre des nerfs avec Steve Carella et ses collègues en les bombardant de citations tirées du théâtre de Shakespeare et de messages cryptés à base d’anagrammes et de palindromes – obligeant les inspecteurs du 87e à se muer en déchiffreurs d’énigmes d’autant plus retorses qu’elles pointent vers plusieurs pistes à la fois. Le spectacle de ces flics très inégalement futés confrontés à des devinettes littéraires de haut vol est plutôt réjouissant ; par ailleurs j’ai toujours eu un faible pour le Sourdingue, que McBain parvient à rendre réellement inquiétant sans forcer la note (on sent que ce type est capable de tout). Et, comme disait Hitchcock, « plus réussi est le méchant…» Reste que ce roman sans climax s’effiloche insensiblement – peut-être parce que Carella y est le plus souvent condamné à l’attente et à l’inaction.
Quant au Frumieux Bandagrippe, il narre le kidnapping de la jeune chanteuse Tamar Valparaiso, enlevée devant cent personnes sur le yacht où se déroule la soirée de lancement de son premier disque – dont la chanson-titre n’est rien autre que le poème Jabberwocky de Lewis Carroll :
Il briguait ; slictueux, les tôves
Giraient et gimblaient sur les loignes ;
Mimeux étaient les borogoves,
Et la molmerase horgripait 1
…
 Un rapt, c’est tout bon pour la promo ça, coco. Aussi, tandis que Carella et les autres mènent l’enquête (avant de se faire piquer l’affaire par le FBI), le producteur de Bison Records se frotte les mains. Bien sûr il craint pour la vie de sa prometteuse découverte, mais enfin : les JT font leurs choux gras du kidnapping, les radios diffusent Bandagrippe à satiété, les disques s’arrachent comme des petits pains. La chanson devient un fait de société et chaque « expert » y va de son exégèse. Des militants de la cause des Noirs jugent le clip raciste. Pour les féministes, il ne fait aucun doute que le texte de ce monsieur « Lewis qui ? » est une apologie du viol. McBain prend un malin plaisir à railler le cynisme du marketing show-business, la fabrication de la célébrité, les emballements médiatiques et la sottise politiquement correcte.
Un rapt, c’est tout bon pour la promo ça, coco. Aussi, tandis que Carella et les autres mènent l’enquête (avant de se faire piquer l’affaire par le FBI), le producteur de Bison Records se frotte les mains. Bien sûr il craint pour la vie de sa prometteuse découverte, mais enfin : les JT font leurs choux gras du kidnapping, les radios diffusent Bandagrippe à satiété, les disques s’arrachent comme des petits pains. La chanson devient un fait de société et chaque « expert » y va de son exégèse. Des militants de la cause des Noirs jugent le clip raciste. Pour les féministes, il ne fait aucun doute que le texte de ce monsieur « Lewis qui ? » est une apologie du viol. McBain prend un malin plaisir à railler le cynisme du marketing show-business, la fabrication de la célébrité, les emballements médiatiques et la sottise politiquement correcte.
Ce qui est amusant, c’est que la pratique carrollienne du mot-valise se met à contaminer la narration : « La brigade était plus que perturbée, on pouvait même dire qu’elle était totalement… éberlourdie. […] – Une petite brigade merdique du nord de la ville, grommela-t-il, visiblement ulgacé. » Ce qui est dommage, c’est que McBain emploie le procédé au petit bonheur de la chance, quand il y pense dirait-on – d’où le sentiment d’une belle idée mal exploitée. Cela dit, le parallèle entre l’histoire du bandagrippe et le destin de la chanteuse connaîtra un point d’orgue tragique (impossible d’en dire plus), avant un retournement final malheureusement prévisible.
Dans l’un et l’autre livre, McBain panache comme à son habitude l’enquête principale avec plusieurs sous-intrigues dévolues aux problèmes personnels des flics du 87e (qui présupposent une certaine familiarité avec la saga pour être pleinement goûtés). L’ennui est que ces fils parallèles restent parallèles, justement (il aurait été plus intéressant qu’ils recoupent la trame principale), que les personnages secondaires sont pour le moins schématiques, et que les déboires sentimentaux et familiaux des personnages récurrents de la saga relèvent ici d’une dramaturgie de téléroman. Enfin, l’arrière-plan social, qui fonde l’ambition balzacienne de ce vaste cycle romanesque édifié durant un demi-siècle, a pratiquement disparu. Bref, ça se laisse lire grâce au métier de l’auteur, mais on a globalement l’impression que la routine a pris le pas sur l’élan et l’invention.
1 Traduction de Robert Benayoun (Anthologie du nonsense. Pauvert, 1959). Le poème figure au premier chapitre de De l’autre côté du miroir.
 Ed McBAIN, le Frumieux Bandagrippe (The Frumious Bandersnatch) et Jeux de mots (Hark!). Traductions de Jacques Martinache. Presses de la Cité, 2005 et 2006, 319 et 326 p.
Ed McBAIN, le Frumieux Bandagrippe (The Frumious Bandersnatch) et Jeux de mots (Hark!). Traductions de Jacques Martinache. Presses de la Cité, 2005 et 2006, 319 et 326 p.
L’Apparition
 On crut d’abord à un faux bruit. Vain soupçon : car voici paru un digipack mirobolant produit par l’INA, groupant trois films du scriptor qui tant nous ravit, à quoi sont joints maints bonus roboratifs : intervious pour la TV, radiodiffusions, and tutti quanti. Attrayant fourbi – surtout pour nous qui n’avons jamais pu voir ni Narrations d’Island ni Locus d’un abandon -, butin dont, puisant sans souci à un magot pourtant fort riquiqui (tant pis s’il nous faut pour ça souffrir d’inanition durant un mois !), sacrifiant, oui, pour un coup, au goût d’aujourd’hui pour la consommation, nous accomplirons rapido l’acquisition. Nous voilà tout palpitant, dansant sur maint charbon brûlant !
On crut d’abord à un faux bruit. Vain soupçon : car voici paru un digipack mirobolant produit par l’INA, groupant trois films du scriptor qui tant nous ravit, à quoi sont joints maints bonus roboratifs : intervious pour la TV, radiodiffusions, and tutti quanti. Attrayant fourbi – surtout pour nous qui n’avons jamais pu voir ni Narrations d’Island ni Locus d’un abandon -, butin dont, puisant sans souci à un magot pourtant fort riquiqui (tant pis s’il nous faut pour ça souffrir d’inanition durant un mois !), sacrifiant, oui, pour un coup, au goût d’aujourd’hui pour la consommation, nous accomplirons rapido l’acquisition. Nous voilà tout palpitant, dansant sur maint charbon brûlant !
***
DVD 1
Récits d’Ellis Island, de Georges Perec et Robert Bober (1978-1980)
1ère partie : Traces (57’)
2e partie : Mémoires (60’)
De 1892 à 1924, près de seize millions d’émigrants en provenance d’Europe, chassés par la misère, la famine, l’oppression politique, religieuse ou raciale sont passés par Ellis Island, îlot de quelques hectares aménagé en centre de transit, près de la statue de la Liberté, à New York. Ellis Island représentait pour Perec, « le lieu même de l’exil, le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.»
DVD 2
Les Lieux d’une fugue, de Georges Perec ( 1978, 41’)
« C’était le 11 mai 1947. Il avait onze ans et deux mois. Il venait de s’enfuir de chez lui, 18 rue de l’Assomption, seizième arrondissement… » Georges Perec adapte lui-même cette histoire pour la série Caméra-je, produite par l’Ina.
Trois entretiens avec Georges Perec :
– Lectures pour tous (1965,12’, et 1967, 10’)
Georges Perec fut deux fois l’invité de Lectures pour tous, magazine littéraire animé par Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet, lors de la parution des Choses, et pour Un homme qui dort.
– Ciné Regards (1979, 12’)
Anne Andreu s’entretient avec Georges Perec sur son rapport au cinéma et sur le fait d’« écrire pour des images », à l’occasion de la sortie de Série noire (Alain Corneau), dont il a écrit les dialogues.
CD
Radioscopie, (1978, 54’)
En 1978, Jacques Chancel invite Georges Perec à parler de la Vie, mode d’emploi.
Cinquante choses que j’aimerais faire avant de mourir (1981, 16’)
En novembre 1981, Georges Perec fut l’un des premiers à se prêter au jeu proposé par cette émission et à établir cet inventaire, qu’il limita volontairement à 37 éléments.
P.-S. : Ce dimanche 22 avril à 16 heures sur France-Culture, l’émission Une vie, uneœuvre de Catherine Pont-Humbert sera consacrée à Perec. Avec Marcel Bénabou, Robert Bober, Bernard Magné, Paulette Perec et Jacques Roubaud. Textes lus par Jacques Spiesser (le comédien — muet — d’Un homme qui dort).
Le monde du silence

Patrick Tourneboeuf est aussi bien attiré par les univers clos sur eux-mêmes (du monde des bureaux à l’école de la Marine nationale) que par les lieux vides et fantomatiques (abords incertains des villes, stations balnéaires hors saison touristique). Fasciné par les traces que les hommes laissent derrière eux, « les espaces qu’ils investissent et parfois abandonnent », il a notamment promené son appareil photo le long du tracé du mur de Berlin et sur les plages du débarquement. Son récent travail sur les Archives nationales de France conjoint comme à plaisir ces diverses obsessions – et peut-être n’est-ce pas un hasard si c’est à la veille de leur déménagement partiel à Pierrefitte-sur-Seine qu’il a photographié ces trois hectares de galeries et de salles encloses au cœur de Paris. Ces photos furent exposées aux Archives mêmes au début de l’année, dans d’impressionnants très grands formats accrochés en des salles dont le silence faisait un troublant écho à leur propre silence. Labyrinthe des corridors, des salles de consultation et des magasins en sous-sol, kilomètres de rayonnages où s’alignent les volumes reliés, les classeurs aux numérotations ésotériques ; château de la Belle au bois dormant où les registres, censiers, minutiers des conseils du roi et procès-verbaux des assemblées révolutionnaires, ensevelis dans un profond sommeil, semblent attendre l’historien qui viendra les réveiller pour les faire parler à nouveau. Fascinant univers, entre Borges et le Resnais de Toute la mémoire du monde, à la fois vertigineux et légèrement oppressant, vide de présence humaine, à une seule exception qui semble incarner la solitude du chercheur.

 Patrick TOURNEBOEUF, le Temps suspendu. Préface de Pierre Nora. Filigranes, 2007.
Patrick TOURNEBOEUF, le Temps suspendu. Préface de Pierre Nora. Filigranes, 2007.







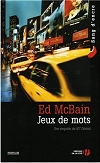 Onze ans après Poissons d’avril, Jeux de mots voit le retour du Sourdingue, qui est aux flics du 87e ce que Moriarty fut à Sherlock Holmes. Ce plaisant psychopathe aime, à la façon du Riddler de Batman, annoncer les coups qu’il mijote par l’envoi d’une série de messages sibyllins. Fidèle à sa tactique, il engage ici une nouvelle guerre des nerfs avec Steve Carella et ses collègues en les bombardant de citations tirées du théâtre de Shakespeare et de messages cryptés à base d’anagrammes et de palindromes – obligeant les inspecteurs du 87e à se muer en déchiffreurs d’énigmes d’autant plus retorses qu’elles pointent vers plusieurs pistes à la fois. Le spectacle de ces flics très inégalement futés confrontés à des devinettes littéraires de haut vol est plutôt réjouissant ; par ailleurs j’ai toujours eu un faible pour le Sourdingue, que McBain parvient à rendre réellement inquiétant sans forcer la note (on sent que ce type est capable de tout). Et, comme disait Hitchcock, « plus réussi est le méchant…» Reste que ce roman sans climax s’effiloche insensiblement – peut-être parce que Carella y est le plus souvent condamné à l’attente et à l’inaction.
Onze ans après Poissons d’avril, Jeux de mots voit le retour du Sourdingue, qui est aux flics du 87e ce que Moriarty fut à Sherlock Holmes. Ce plaisant psychopathe aime, à la façon du Riddler de Batman, annoncer les coups qu’il mijote par l’envoi d’une série de messages sibyllins. Fidèle à sa tactique, il engage ici une nouvelle guerre des nerfs avec Steve Carella et ses collègues en les bombardant de citations tirées du théâtre de Shakespeare et de messages cryptés à base d’anagrammes et de palindromes – obligeant les inspecteurs du 87e à se muer en déchiffreurs d’énigmes d’autant plus retorses qu’elles pointent vers plusieurs pistes à la fois. Le spectacle de ces flics très inégalement futés confrontés à des devinettes littéraires de haut vol est plutôt réjouissant ; par ailleurs j’ai toujours eu un faible pour le Sourdingue, que McBain parvient à rendre réellement inquiétant sans forcer la note (on sent que ce type est capable de tout). Et, comme disait Hitchcock, « plus réussi est le méchant…» Reste que ce roman sans climax s’effiloche insensiblement – peut-être parce que Carella y est le plus souvent condamné à l’attente et à l’inaction. Un rapt, c’est tout bon pour la promo ça, coco. Aussi, tandis que Carella et les autres mènent l’enquête (avant de se faire piquer l’affaire par le FBI), le producteur de Bison Records se frotte les mains. Bien sûr il craint pour la vie de sa prometteuse découverte, mais enfin : les JT font leurs choux gras du kidnapping, les radios diffusent Bandagrippe à satiété, les disques s’arrachent comme des petits pains. La chanson devient un fait de société et chaque « expert » y va de son exégèse. Des militants de la cause des Noirs jugent le clip raciste. Pour les féministes, il ne fait aucun doute que le texte de ce monsieur « Lewis qui ? » est une apologie du viol. McBain prend un malin plaisir à railler le cynisme du marketing show-business, la fabrication de la célébrité, les emballements médiatiques et la sottise politiquement correcte.
Un rapt, c’est tout bon pour la promo ça, coco. Aussi, tandis que Carella et les autres mènent l’enquête (avant de se faire piquer l’affaire par le FBI), le producteur de Bison Records se frotte les mains. Bien sûr il craint pour la vie de sa prometteuse découverte, mais enfin : les JT font leurs choux gras du kidnapping, les radios diffusent Bandagrippe à satiété, les disques s’arrachent comme des petits pains. La chanson devient un fait de société et chaque « expert » y va de son exégèse. Des militants de la cause des Noirs jugent le clip raciste. Pour les féministes, il ne fait aucun doute que le texte de ce monsieur « Lewis qui ? » est une apologie du viol. McBain prend un malin plaisir à railler le cynisme du marketing show-business, la fabrication de la célébrité, les emballements médiatiques et la sottise politiquement correcte. Ed McBAIN, le Frumieux Bandagrippe (The Frumious Bandersnatch) et Jeux de mots (Hark!). Traductions de Jacques Martinache. Presses de la Cité, 2005 et 2006, 319 et 326 p.
Ed McBAIN, le Frumieux Bandagrippe (The Frumious Bandersnatch) et Jeux de mots (Hark!). Traductions de Jacques Martinache. Presses de la Cité, 2005 et 2006, 319 et 326 p. On crut d’abord à un faux bruit. Vain soupçon : car voici paru un digipack mirobolant produit par l’
On crut d’abord à un faux bruit. Vain soupçon : car voici paru un digipack mirobolant produit par l’
