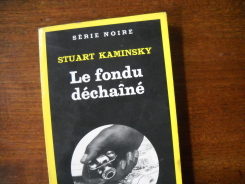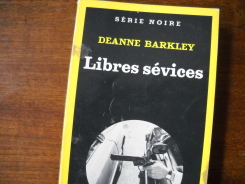Treehorn et ses ennuis


Treehorn rapetisse. Ses vêtements deviennent trop grands. À l’heure des repas, il arrive tout juste à voir au-dessus de la table. Ses efforts pour attirer l’attention sur cette embarrassante situation se heurtent à l’indifférence ou à l’incompréhension de son entourage, et tournent immanquablement au dialogue de sourds. Ses parents trouvent que Treehorn n’est pas raisonnable et qu’il devrait cesser de faire son intéressant ; et puis, qu’en diront les voisins ? Au surplus, ils ont des soucis d’adultes autrement plus importants : faire des économies (l’économie est le secret d’un ménage bien tenu, ne l’oublie pas mon garçon), surveiller la cuisson des gâteaux ou choisir un nouveau tissu d’ameublement. L’institutrice de son école tance gentiment Treehorn : ce n’est pas parce qu’on rapetisse qu’il faut se croire tout permis, et faire des bonds de cabri pour tenter d’atteindre l’abreuvoir. Le proviseur le félicite d’être venu le trouver : n’est-il pas là pour ça ? Puis il se lance dans un grand discours sur sa mission pédagogique avant d’inviter le garçon à repasser le voir si jamais il avait un problème. Les camarades de Treehorn ne lui sont d’aucune aide non plus et trouvent qu’il faut vraiment être débile pour en arriver là.
Parce que le personnage est aux prises avec un problème de taille (qu’il finira par résoudre de lui-même, au prix d’un nouvel inconvénient dont on vous laisse la surprise), on n’est pas loin de Lewis Carroll. Comme chez l’auteur d’Alice, l’humour nonsensique de l’argument et l’ironie understated de la narration se fortifient de satire sociale et d’une réflexion plus fondamentale sur le langage. « Avec les mots, disait Humpty Dumpty, l’important est de savoir qui est le maître. » Or, le maître, c’est le langage lui-même. Car avant même d’être inféodés aux convenances ou à leur position sociale, les proches de Treehorn sont prisonniers de discours tout faits qui les rassurent quant à leur existence et leur permettent de continuer à vivre les yeux fermés. C’est le secret des meilleurs livres anglo-saxons pour la jeunesse (on songe aussi à Winnie l’ourson d’A.A. Milne) que de pouvoir, en suggérant plusieurs niveaux d’interprétation, être lus à tout âge avec un enchantement égal.
Florence Parry Heide est née en 1919. Depuis Maximilien (1967), elle a publié une centaine d’ouvrages pour la jeunesse. Sa trilogie de Treehorn (dont le Rapetissement de Treehorn constitue le premier volet) est devenue un classique outre-Atlantique. Elle est illustrée, ce qui ne gâte rien, par l’aimable excentrique Edward Gorey, auteur de superbes romans graphiques cruels et macabres qui, malgré les efforts répétés de Patrick Mauriès aux éditions du Promeneur, semble voué à un succès de happy fews auprès du public francophone. Merci donc aux éditions Attila d’avoir pris le relais. Le second volet de la trilogie, le Trésor de Treehorn, vient de paraître (le troisième est annoncé pour le second semestre de cette année). Le point de départ en est moins original, mais le regard en coin de Florence Parry Heide et d’Edward Gorey, toujours aussi savoureux.
 Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.
Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.
 Attila, 2009 et 2010.
Attila, 2009 et 2010.
Dimanche en jazz 4
On découvre que le saxophoniste anglais John Butcher se produira en solo le 24 avril à 20 heures à la Chapelle Saint-Roch-en-Volière (19, rue Volière, 4000 Liège). En seconde partie, récital de Tomoko Sauvage, joueuse de jalatarangam, dont on apprend du même coup qu’il s’agit d’un « instrument indien constitué de bols de porcelaine accordés suivant la quantité d’eau dont ils sont remplis ».

Concert organisé par la Médiathèque et l’asbl Épiphonie.
Portrait de John Butcher, par Philippe Delvosalle.
Addendum : John Butcher est coincé au Texas pour cause d’aéroflotte clouée au sol, nous apprend-on en commentaire. Son concert sera remplacé par un duo entre le tromboniste Paul Hubweber et le batteur Paul Lytton.
Glycophilie
À neuf heures moins le quart, je retrouvais Gourmont au Café Véron. Vu là pour la première fois la nouvelle mode du sucre enveloppé dans un petit sac en papier couvert de réclames. Une nouvelle forme de publicité, et pas bête, et qui fera gagner de l’argent à son inventeur. Car ce n’est bien qu’une petite industrie nouvelle, sous le couvert de l’hygiène.
Paul Léautaud, Journal littéraire, tome II, 1er octobre 1908.
Mercure de France, 1955, p. 305.
On peut donc dater de 1908 l’apparition, en France, des premiers sachets de sucre. On mourra moins bête ce soir. Sérieusement, ce genre de notations « intactes et minuscules » enchante toujours1. Rien de tel pour retrouver dans un éclair le grain d’une époque. Car tandis que les livres d’histoire nous font voyager dans un passé reconstruit, qu’ils nous font éprouver comme passé, elles nous font ressentir ce passé comme ayant été un jour du présent. C’est peu de choses, évidemment, mais c’est pourtant vrai qu’il a bien fallu qu’apparaissent un jour les premiers sachets de sucre, et qu’il se trouve des gens pour s’en étonner. Et d’un coup, par la magie de cette capsule témoin, nous voici téléportés au Café Véron et considérant à notre tour ces petits sachets en méditant sur l’industrieuse ingéniosité des hommes et l’empire croissant de la publicité.

1. Et celle-ci m’a d’autant plus frappé qu’elles sont rares sous la plume de Léautaud. Par contraste, le cinématographe suscite à peine sa curiosité, et il s’étonne — nous pas — de ce que Gourmont se passionne pour cette attraction nouvelle et fréquente assidûment les premières salles obscures.
Titreurs d’élite
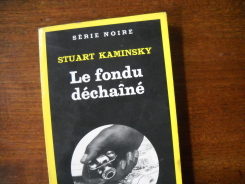
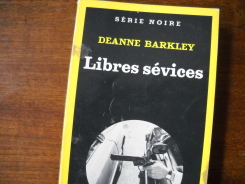
Ne mollissant jamais devant le plus mauvais calembour — pour reprendre la formule impérissable de Losfeld —, on aurait aimé être une petite souris pour assister aux brainstormings de la Série noire à la grande époque de Marcel Duhamel et de Robert Soulat. Combien de fous rires et de litres de bière furent-ils nécessaires pour accoucher de titres aussi merveilleusement navrants que Tu mens Beth ! ou Mon cadavre au Canada ? A contrario, le Fondu déchaîné (acquis ce matin pour cinquante centimes à la brocante) est une excellente trouvaille verbale, l’une des meilleures de la tranche 1700 de la collection, avec le Mur du sang de Kenneth Royce (pas lu) et Libres Sévices de Deanne Barkley (un bon cru, celui-ci : chronique unanimiste ordonnée autour d’une autoroute sillonnée par un tueur fou). Le titre original n’a rien à voir comme d’habitude, puisqu’il s’agit de The Howard Hughes Affair.
Babel en solde


À l’attention des Parisiens et des visiteurs de passage, signalons qu’un soldeur bien connu de la rue Saint-Martin liquide à six euros pièce quatre volumes de (la réédition chez Panama de) la très belle « Bibliothèque de Babel » (prix d’origine : dix-neuf et vingt et un euros suivant les volumes). Créée en 1977 sur l’initiative de l’éditeur Franco Maria Ricci, ce fut la seule collection littéraire dirigée par Jorge Luis Borges. Elle réunit des perles de la littérature fantastique chères au cœur du Sphinx de Buenos Aires, préfacées par lui avec sa concision habituelle.
Rappelons que la nouvelle « la Statue de sel » de Leopoldo Lugones — l’un des volumes projetés mais finalement non publiés en français pour cause de faillite de l’éditeur, si j’ai bien compris — est disponible, avec « la Pluie de feu » du même auteur, dans le numéro 15 du Visage vert, et que ces deux textes valent diablement le détour.
« La Bibliothèque de Babel » fut l’une des dernières occurrences1 de ce format oblong (sauf que c’est le contraire) qui eut durant les années 1960 et 1970 les faveurs de certains éditeurs, notamment Éric Losfeld et Jean-Jacques Pauvert, avant de passer de mode. Le plus souvent dévolu à de courts textes pamphlétaires (l’Extricable de Raymond Borde et Lettre aux gens malheureux et qui ont bien raison de l’être de Jacques Sternberg chez Losfeld, Plaidoyer contre la censure de Maurice Garçon et l’Homme et son âme devant la société d’Oscar Wilde chez Pauvert, sans oublier la fameuse collection «Liberté » de Pauvert et la collection « Le Désordre » de Losfeld, toutes deux maquettées par Pierre Faucheux), il servit plus rarement d’écrin précieux à des textes littéraires qui ne l’étaient pas moins (les Chasseurs d’André Hardellet chez Pauvert, la Cafarde de Bona de Mandiargues et le Marronnier d’André Pieyre de Mandiargues au Mercure de France).




1. À l’exception notable d’Actes Sud, vil étourdi que je suis. Les ajouts en bleu font suite aux remarques de mes aimables lecteurs.
Typo des villes (3)

Rue des Gobelins, Paris.
J’ai un faible pour ces enseignes en relief. Les boutiques poussiéreuses qu’elles surmontent sont le plus souvent fermées ou désertes. En se dévissant le cou, on aperçoit parfois le patron dans son arrière-boutique ; mais jamais un client. On se demande par quel mystère elles survivent.
Ce qu’ils lisent
Paris (suite)
25 mars
— À Pasteur, direction Étoile, une dame en imper de privé, apostée tout au bord du quai (décidément, c’est une manie), lit la Conspiration de Paul Nizan. Assis dans la position du penseur de Rodin, un quadragénaire est plongé dans les romans de Walter Scott, dans l’édition de la Pléiade. Le volume est ouvert sur son genou.
— Gare Saint-Lazare, une jeune femme en manteau d’esquimau a elle aussi adopté la pose du penseur de Rodin pour lire les Femmes du braconnier de Claude Pujade-Renaud.
— À Miromesnil, direction Mairie de Montreuil, deux jeunes filles discutent vivement au bout du quai. La brunette en bleu agite un exemplaire de Syngué Sabour d’Atiq Rahimi sous le nez de sa copine.
— À Chaussée d’Antin, direction Mairie d’Ivry, une jeune femme surgit sur le quai, qui lit en marchant le Lys dans la vallée de Balzac. Une ado tout en noir a ouvert le Gang des mégères inapprivoisées de Tom Sharpe.
— Dans le wagon, une dame plongée dans un roman de Christian Jacq, et deux autres lectrices en vis-à-vis, dont une quinquagénaire permanentée, l’air très pincé, lisant un volume du Séminaire de Lacan.
— Sur le quai des Gobelins, une femme en veston cintré sur jeans pattes d’eph’ lit le Septième Voile de Juan-Manuel de Prada. Elle monte dans un wagon où se trouve une lectrice de Shutter Island de Dennis Lehane — c’est une blonde menue vêtue de gris et de noir.
— Métro Place d’Italie, un homme en veste de cuir, au crâne entièrement rasé à l’exception d’une longue queue de cheval, s’absorbe dans le Tailleur de pierre de Camilla Läckberg. Plus loin, un jeune homme a le nez dans l’Espace de la révélation d’Alastair Reynolds. Une demi-douzaine d’autres lecteurs des deux sexes sur le quai bondé.
— À Pasteur, direction Mairie d’Issy, paraît une autre lectrice de Shutter Island — cheveux châtain ondulés, manteau olive sur pantalon noir.
— Dans le wagon, une dame tout en noir lisant la Nostalgie de l’ange d’Alice Sebold. Un trentenaire déplumé au nez pointu vêtu d’un pull violet s’initie à la Tactique générale de l’armée de terre (préface du général de corps d’armée Antoine Lecerf).
— À Vaugirard, le croiriez-vous ? monte une troisième lectrice de Dennis Lehane. Cheveux cendrés, long manteau vert sur jupe grise, elle ne lit pas Shutter Island mais Prières pour la pluie.
— Et nous voici porte de Versailles, à deux pas du Salon du livre. Deux lectrices sont adossées à deux lampadaires distants de quelques mètres. Le manteau rouge lit Spin de Robert Charles Wilson ; le manteau noir, Trinités de Nick Tosches.
26 mars
— Dans un wagon de métro encore, mais sur quelle ligne ? Mes notes sont illisibles. En tout cas, il y avait une femme en noir un peu sorcière — cheveux aile de corbeau, fard turquoise aux paupières — lisant Maléfices de Maxime Chattam. En face d’elle, un jeune homme en veste à carreaux s’absorbant dans le Règne de la quantité et les signes du temps de René Guénon. Et plus loin, assis sur un strapontin, un type rougeaud et mal réveillé lisant le Petit Saint de Simenon. Enfin, sur le quai d’une station, une jeune femme tenant en main la Clinique du docteur H de Mary Higgins Clark.
29 mars
— Métro Sèvres-Babylone, direction Gare d’Austerlitz, une grande blonde assise est plongée dans D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère.
— Dans le wagon, un monsieur ressemblant à Guy Vaes avec un nez aquilin savoure un dialogue de Platon dans un vieux fascicule jauni. Debout, une nouvelle lectrice, rousse, de la Nostalgie de l’ange, et une quadragénaire lisant Chaleur et Poussière de Ruth Prawer Jhabvala.
Beaucoup, beaucoup de lecteurs (et surtout de lectrices, comme toujours) dans la rue et les transports en commun ce printemps à Paris. J’en ai loupé une bonne trentaine, trop loin ou s’obstinant à dissimuler le titre de leur livre.


 Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.
Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe. Attila, 2009 et 2010.
Attila, 2009 et 2010.