Figures du mixte
Architectes, décorateurs, peintres, écrivains, amateurs. Dans le disparate essentiel de leur réunion, ces personnages auront eu en commun d’avoir eux-mêmes été, singulièrement, activement, disparates : mercuriels et versatiles, instables et touche-à-tout ; inaptes à se ranger sous une catégorie ou un genre consacré, peintres et littérateurs, décorateurs et architectes, mondains et excentriques ; figures du mixte ou du composite.
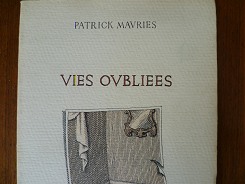 Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
À l’époque de ma première lecture, je ne connaissais que Filippo de Pisis (via Mandiargues), Mario Praz et Christian Bérard. Point d’internet alors. Aussi notait-on, en vue d’une recherche future, les autres noms sur un pense-bête, qu’on oubliait d’emporter à la bibliothèque et qu’on finissait par égarer. Aujourd’hui, un simple clic permet de découvrir les polaroids érotiques de Carlo Mollino ou encore la réalisation qu’on dit la plus célèbre de Gio Ponti, l’étonnante tour Pirelli à Milan (1956) — laquelle semble de face une HLM massive et sans grâce mais de profil prend soudain l’allure d’un monolithe kubrickien, moderne cousin des immeubles plats du XVe qu’affectionnait Roger Caillois et que son imagination se plaisait à peupler de fantômes.

 Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Une secte impossible

Peut-être d’ailleurs Fornasetti a-t-il d’abord été positivement, substantiellement, un collectionneur. Sa maison milanaise — constellée de séries d’assiettes anglaises — proclamait avec force cette passion : le mur de façade en avait été percé pour installer une collection de verres en cristal taillé et coloré. L’espace des pièces était dévoré par le témoignage d’une autre obsession : celle de l’imprimé, sous toutes ses formes, du livre à la revue et à l’image, aberration ravageuse — et assez répandue — dont Fornasetti ne manquait jamais de se moquer ironiquement. Héros de cette secte impossible des dévorateurs de papier qui, de loin en loin sur la planète, absorbent quotidiennement catalogues et magazines, livres de mode et ouvrages d’architecture, histoire du design et chroniques de tous ordres ; secte dont les membres se ressembleraient tous, se jetant sur les mêmes livres, adulant les mêmes auteurs, tout en s’ignorant les uns les autres, prêts à se jalouser, courant à l’unique ou à l’inédit, aspirés vers l’absolu de leur obsession ; monomanes ballottés de catalogue en catalogue, de notice en bulletin, n’ayant de cesse d’avoir, tel De Quincey, rendu impraticables chambres et couloirs, oxygénés qu’ils sont chaque jour par le renouvellement salvateur des publications, poussés à franchir le barrage des langues et des cultures, ne pouvant rapidement se contenter d’une langue propre, tel, donc, Fornasetti qui avouait ne plus avoir accès à sa propre archive.
Patrick Mauriès, Fornasetti, designer de la fantaisie,
Thames & Hudson, 2006.
Fin de phrase contredite dix pages plus loin, tant le démon de l’accumulation n’exclut pas l’obsession d’un ordre impossible :
Jusqu’à la fin de sa vie, il pouvait ainsi désigner sans erreur la place du moindre de ses treize mille projets, dûment étiquetés et catalogués.
Fornasetti est-il ce F. dont parle Mauriès dans les Lieux parallèles (Plon, 1989), et dont l’image m’a longtemps hanté ? (On suppose que oui, l’initiale B. correspondant au prénom de son fils, Barnaba.)
F. mort, sa femme avoue qu’elle n’a qu’une hâte: fare ordine, débarrasser tables, sols et divans des magazines, quotidiens, livres et tracts en toutes langues amoncelés par son mari soixante ans durant, et dont il interdisait farouchement qu’on déplaçât le moindre atome. Elle peut enfin, après cette longue attente, s’approprier un espace : en le vidant. Son fils, quant à lui, se décide à franchir le tabou : il me conduit dans les pièces que F. condamnait jalousement, de peur de se livrer d’une manière ou d’une autre ; et le petit pavillon urbain se révèle alors donner, fantastiquement, sur un dédale d’ateliers et de couloirs aux murs implacablement saturés d’objets et de collections de tous ordres (dont des maquettes sous verre exécutées en filaments de fromage ; certaines, me dit B., grouillant de vers…), quand il ne s’agit pas d’imprimés de tous formats, âges ou couleurs.
Collectionneur exemplaire, c’est-à-dire effrayant, F. était aussi méthodique : pas une collection de Vogue ou de Maison et Jardin qui ne soit étiquetée, répertoriée, analysée — tout en étant impraticable, étouffée sous la poussière d’un demi-siècle. Spectacle toujours poignant — mais prévisible, naturel pour qui connaissait F. — que cette moisissure gagnant jusqu’au moindre centimètre possible. Et son fils — qui avait eu des velléités d’évasion, était parti plusieurs années avant de revenir — me montre fièrement sa chambre tout là-haut, qui aurait pu être un jardin suspendu, et où seul un mauvais sommier et un réchaud se détachent sur un fond noirci d’Illustrazione italiana et de vieux livres, dont certains rarissimes. Il n’en a assurément pas ouvert un seul, se contente de savoir qu’ils peuvent avoir de la valeur, se satisfait maintenant de vivre dans le voisinage enveloppant de ce gigantesque cadavre.
André Schiffrin à Liège

Communiqué : « Fils du créateur de la Bibliothèque de la Pléiade Jacques Schiffrin, André Schiffrin s’est d’abord illustré à la direction, pendant trente ans, des éditions Pantheon à New York. Suite à un renouvellement de l’actionnariat, il s’est retiré de cette maison pour fonder The New Press en 1991 et instaurer un nouveau mode d’édition sans but lucratif et porteur de hautes exigences intellectuelles.
De l’Édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999) à l’Argent et les Mots (2010) en passant par le Contrôle de la parole (2005), sans compter de nombreuses publications dans diverses revues de sciences littéraires et sociales, André Schiffrin s’est signalé aussi comme un des meilleurs spécialistes des rouages de l’édition contemporaine et des contraintes diverses qui, émanant de l’État ou du marché, sont susceptibles de s’exercer sur les industries culturelles et la production du savoir. »

Chambres


Paris, Hôtel Jean Bart, avril 2011.
La ville imaginaire de Tomaso Buzzi

Un nom qui a piqué ma curiosité parmi ceux cités par Patrick Mauriès. En 1956, l’architecte et designer milanais Tomaso Buzzi (1900-1981) acquiert la Scarzuola, ensemble conventuel franciscain datant du XIIIe siècle et situé en Ombrie, non loin d’Orvieto. Il va consacrer vingt ans de sa vie à y édifier sa cité idéale.
« Autobiographie en pierre » selon ses mots, parcours initiatique, lieu de rencontre entre nature et culture, la Città Buzziana est un complexe de sept théâtres dominé par une Acropole. D’esprit néo-maniériste (coexistence des styles, ruptures d’échelle, abondance de symboles et de citations), ce monde en miniature juxtapose en un labyrinthe composite de ruelles et d’escaliers les monuments visités par l’architecte au cours de ses voyages, des souvenirs de l’antiquité grecque et romaine, des sculptures de monstres et de figures mythologiques, et jusqu’à la tour de Babel. Un lieu magique comme on les aime (voir, dans un autre esprit, le musée Robert Tatin), et qu’on espère visiter un jour.






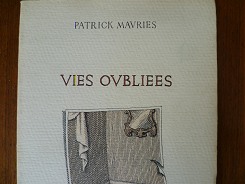 Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.
 Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.
Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.


























