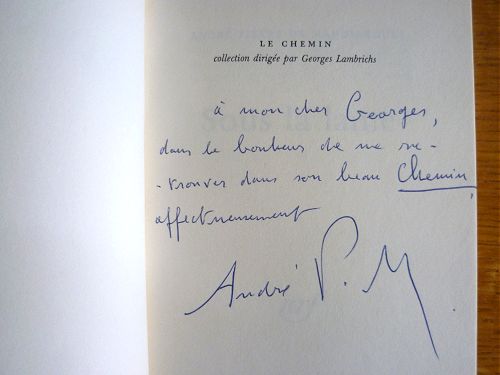L’histoire de la papauté du IXe au XIe siècle racontée par Stendhal, c’est aussi fou que du Monty Python. Un défilé accéléré de complots, de corruption, d’usurpations de pouvoir, de torture, d’empoisonnements et de dépravation. J’en recopie quelques extraits ; il y a en ainsi quinze pages auxquelles le style télégraphique de Stendhal imprime un tempo allègre, irrésistible.
Pendant qu’on lui nommait un successeur, Jean XII ne restait pas oisif. Othon, pour être moins à charge à la ville de Rome, avait eu l’imprudence de renvoyer une partie de ses troupes allemandes. Jean XII corrompit, à force d’argent, la populace de Rome, qui essaya d’assassiner l’empereur et le nouveau pape Léon VIII. Le peuple fut repoussé par la garde impériale, qui tua beaucoup de Romains, et le carnage ne cessa que lorsque les larmes de Léon VIII parvinrent à toucher l’empereur. Ce prince quitta Rome. Léon VIII n’étant plus soutenu par la présence des Allemands, tout le peuple se souleva contre lui et rappela Jean XII. Ce pape signala sa rentrée dans Rome par les cruautés d’usage en pareille circonstance. Il fit couper le bout de la langue, deux doigts et le nez au malheureux Léon VIII.
[…]
Othon le Grand mourut ; à Jean XIII avait succédé Benoît VI. Le cardinal Boniface s’empara de la personne du pape, le fit étrangler en prison, et se fit pape. Boniface siégeait à peine depuis un mois, quand il s’aperçut que la place n’était pas tenable. Il s’enfuit à Constantinople avec les dépouilles de la basilique du Vatican. Il eut pour successeur Benoît VII. À la mort de ce pape, Boniface partit de Constantinople pour venir tenter la fortune à Rome ; il y trouva un nouveau pape, nommé Jean XIV. Boniface l’emporta sur lui, et le premier usage de son pouvoir fut d’enfermer Jean XIV dans le tombeau d’Adrien et de l’y laisser mourir de faim. Pour intimider les partisans de Jean XIV, son cadavre fut exposé aux regards du peuple. Bientôt après, Boniface périt; son corps battu de verges et percé de coups fut traîné par le peuple devant la statue de Marc-Aurèle.
Il est évident que l’élection d’un souverain avait quelque chose de trop raisonnable pour ce siècle barbare.
[…]
L’Église romaine jouit du calme pendant une vingtaine d’années. L’an 1024, le pape Benoît VIII étant venu à mourir, Jean XIX, son frère, qui était encore laïque, acquit le pontificat à prix d’argent. Neuf ans plus tard, le frère de ces deux papes acheta la papauté très cher pour son fils, qui n’était alors âgé que de dix ans.
Le sort de cet enfant est singulier. Benoît IX, c’est son nom, n’avait encore que quinze ans quand il fut chassé, pour la première fois, par les principaux seigneurs de Rome ; il s’adressa, comme à l’ordinaire, à l’empereur d’Allemagne, qui le replaça par la force sur son siège. Mais ce pape de seize ans était fort libertin ; il faisait mettre à mort les maris dont les femmes lui plaisaient. Les grands seigneurs de Rome prirent la résolution de nommer un autre pape. Un évêque, qui prit le nom de Sylvestre III, les paya fort cher, et fut intronisé.
Trois mois après, Benoît IX, soutenu par ses parents, remonta sur le trône ; mais il était accoutumé à une vie voluptueuse ; il se voyait des ennemis puissants ; il prit le parti de vendre le pontificat à un prêtre romain, plus militaire qu’ecclésiastique, qui se fit appeler Grégoire VI. Grégoire prit un adjoint appelé Clément. Ainsi il y eut trois papes, et même cinq, si l’on veut compter Benoît IX et Sylvestre III, qui n’étaient point morts.
Grégoire VI, Sylvestre III et Benoît IX s’étaient partagé la ville de Rome. Grégoire siégeait à Saint-Pierre, Sylvestre à Sainte-Marie-Majeure, et Benoît à Saint-Jean-de-Latran.
L’empereur Henri III tint un concile à Sutri, en 1046. Les pères déclarèrent nulles les élections de Benoît, de Sylvestre et de Grégoire. L’empereur engagea les Romains à nommer un pape ; ils s’y refusèrent. Henri convoqua à Rome les évêques qui avaient composé le concile de Sutri ; enfin, comme il était aisé de prévoir, le choix tomba sur un Allemand.
À peine une année s’était-elle écoulée, que ce pauvre homme fut empoisonné par Benoît IX, qui réussit ainsi à remonter, pour la troisième fois, sur le siège de saint Pierre.
Stendhal, Promenades dans Rome (1829).