Un monde instable
Ruptures d’échelle et distorsion de l’espace, deux constantes visuelles des séries britanniques des années 1960 : le Prisonnier, Chapeau melon et bottes de cuir, les Champions. Ces effets, obtenus à l’aide d’objectifs à courte focale, contribuent au sentiment d’instabilité, à l’ambiance semi-onirique des meilleurs moments de ces séries.





The Champions (1968-1969)
Prénovellisation
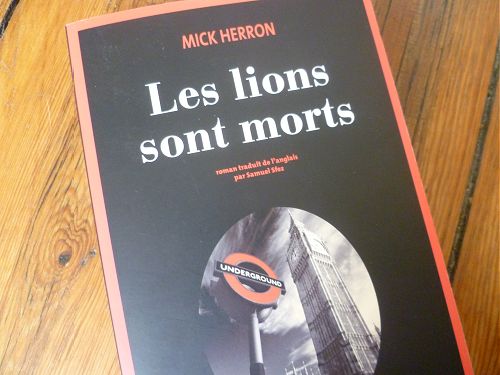
Un film inspiré d’un roman est une adaptation. Un roman tiré d’un film est une novellisation. Les lions sont morts de Mick Herron ressortit à un genre qu’on pourrait baptiser la prénovellisation : soit la novellisation d’un film qui n’existe pas (ou pas encore). Ce thriller plus scénarisé qu’écrit – malgré un effort de style qui sent l’effort – semble avoir été conçu en vue de sa future adaptation à l’écran. Depuis la construction en séquences, imitant le montage parallèle des actions, jusqu’au final spectaculaire au sommet du plus haut gratte-ciel de Londres, on éprouve à le lire le sentiment de visionner une minisérie d’espionnage anglaise en six épisodes.
C’est une impression qu’on ressent plus en plus souvent à la lecture de thrillers, soit que leur auteur soit aussi scénariste (par exemple, Tout se paye de George Pelecanos, qui m’était tombé des mains), soit qu’il soit manifestement nourri de séries télé plus que de littérature.
Mick Herron n’est tout de même pas dénué de talent. L’aspect le plus intéressant de son livre tient à son côté John le Carré (sans la profondeur, l’épaisseur romanesque, la qualité d’écriture des meilleurs le Carré) : 1. La peinture des luttes de pouvoir au sein des services secrets britanniques. 2. La description de la « maison des tocards » (slough house), immeuble insalubre où sont mis au placard divers spécimens d’incompétence : nerds, cas sociaux, agents ayant foiré leur mission, qu’on espère dégoûter et pousser à la démission en leur confiant des travaux fastidieux d’analyse et d’archivage ; à la tête de cette équipe de bras cassés, un espion de la vieille école extraordinairement mal embouché. 3. Le retour inattendu des fantômes de la guerre froide dans le monde contemporain de la lutte contre le terrorisme.
 Mick HERRON, Les lions sont morts (Dead Lions, 2013). Traduction de Samuel Sfez. Actes Sud, 2017.
Mick HERRON, Les lions sont morts (Dead Lions, 2013). Traduction de Samuel Sfez. Actes Sud, 2017.
Simulacre

Peu de récits font ressentir avec une telle force l’absurdité de la débâcle de 1940 : la succession des ordres incohérents et contradictoires, dépourvus de toute intelligence stratégique, les jours et les nuits de marche exténuante qui ramènent une section à son point de départ, la débandade de Dunkerque, l’impression d’une mascarade généralisée. Chez Gracq (ou peut-être faut-il dire : chez le lieutenant Louis Poirier), l’abondance des détails concrets, l’attention vive aux paysages côtoient à tout moment un sentiment profond d’irréalité (malgré la réalité irrécusable de la mitraille et des bombardements).
Et c’est là ce qu’il y a d’infernal dans notre situation, déjà matériellement si pénible. Tout est faux, chacun le sent, tout est simulacre, — chacun fait « comme si ». Imite les gestes, les ordres qu’il est décent de faire d’après la tradition dans une « défense héroïque ». Donne l’ordre de se faire tuer sur place, d’exécuter telle mission impossible (elles le sont presque toutes, maintenant) — avec le même gonflement d’âme qu’il éprouverait à signer des paperasses dans son bureau de caserne. Puis se rendra gentiment aux Allemands dans Dunkerque, quand tous les gestes de la « défense héroïque » auront été exécutés, dans l’ordre le plus académique. Est-ce que je calomnie ? Allons donc : c’est tellement vrai que pour ne rien oublier on commence, avec une hâte indécente, par ceux-là même de ces gestes qui sont les plus faux, les plus inutiles, les plus convenus (comme de brûler le drapeau avec cérémonie) mais qui du moins « font décor » et marquent le coup. C’est la même gêne horrible qu’à une messe dite par un prêtre athée.
Rien d’authentique ne sera sorti de cette guerre que le grotesque aigu de singer jusqu’au détail 1870 et 1914. […]
On a étouffé, dans ces derniers jours de Dunkerque, — bien plus que de l’angoisse — du désespoir de ne pouvoir entendre, jusqu’au bout, une parole vraie — une émission de sentiments garantie par une encaisse. J’ai lu après mon retour dans le « Solstice de Juin » les impressions de Montherlant écoutant à la radio le dernier discours de Reynaud. Vous êtes trop dur pour les civils, M. de Montherlant. Presque tous les chefs que j’ai vus à Dunkerque, on aurait cru des discours de Reynaud galonnés, culottés, bottés. Je n’ai jamais pu y penser depuis sans rire, — mais j’admets qu’au moment même j’en riais amèrement.
Julien Gracq, Manuscrits de guerre. José Corti, 2011.
Ah le petit vin noir
Pire que le gros bleu qui tache. Le 15 mai 1940, au cours d’une halte au bord de l’Escaut, Julien Gracq note que
Les hommes appellent le pinard « du mazout ».
Manuscrits de guerre. José Corti, 2011.
La vie en société
— Ma chère Charlotte, je n’aurais pas survécu en société pendant deux années entières si je n’avais pas appris à parler de tout, sauf de ce que je pense réellement.
*
— Il n’y a pas grand-chose à raconter, commença Christina aussitôt. Les jardiniers creusaient la terre pour planter une espèce d’arbuste quand ils ont découvert ces cadavres de bébés. Naturellement, ils ont appelé la police.
— Comment le savez-vous ? s’enquit Emily.
— Mais par les domestiques, ma chère ! Comment se tient-on informé de ce qui se passe en général ?
*
Augusta soupira.
— Quelquefois, Brandon, j’ai l’impression que vous affectez d’être obtus uniquement pour me contrarier.
*
Un instant, elle craignit qu’il ne recoure à la flatterie. […] Il ne semblait manifester aucun penchant pour la tromperie, ce qui était déjà singulier en soi. La vie en société voulait qu’on se dupe mutuellement, d’un commun accord.
*
— Ne soyez pas ridicule, s’exclama Emily. Ça n’a rien à voir avec son physique, c’est sa langue. On ne peut l’emmener nulle part : elle dit toujours ce qui lui passe par la tête. Demandez-lui son opinion sur un sujet et, au lieu de choisir une réponse appropriée, elle vous dira ce qu’elle pense réellement. Sans le vouloir, elle se saborderait au bout d’un mois, et ne parlons pas de nous ! Et puis Pitt n’est pas un gentleman. Il est beaucoup trop intelligent, pour commencer.
— Je ne vois pas pourquoi un gentleman ne serait pas intelligent, Emily, répliqua-t-il, acerbe.
— Mais tout à fait, mon cher, fit-elle avec un sourire. Seulement, il devrait avoir le bon goût de ne pas le montrer. Vous le savez très bien. Ça indispose les gens et ça implique un effort. Or il ne faut jamais avoir l’air d’accomplir un effort.
Anne Perry, le Mystère de Callander Square
(Callander Square, 1980).
Traduction de Roxane Azimi. 10/18, 1997.











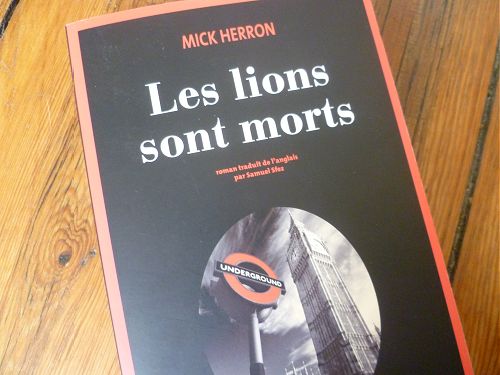
 Mick HERRON, Les lions sont morts (Dead Lions, 2013). Traduction de Samuel Sfez. Actes Sud, 2017.
Mick HERRON, Les lions sont morts (Dead Lions, 2013). Traduction de Samuel Sfez. Actes Sud, 2017.