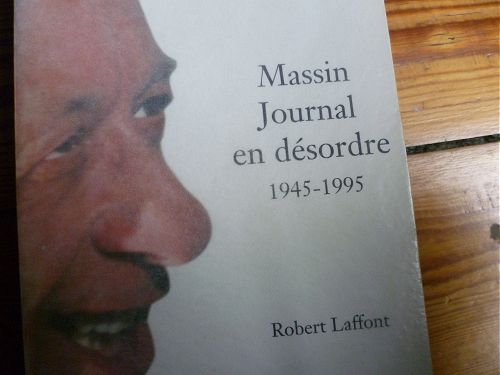Sharon Tandy
Grâce à Sheila Burgel, férue de chanteuses et de groupes féminins des années 1960 interviewée dans Dust & Grooves, on découvre quelques pépites du genre : Scratch my Back de Jan Panter, Good Woman de Barbara Lynn, You Just Gotta Know my Mind de Dana Gillespie… et surtout les singles de Sharon Tandy, notre chouchou du moment.
Tandy (1943-2015) est née en Afrique du Sud où elle a rencontré toute jeune son mentor-producteur-Svengali et futur époux Frank Fenter, avec qui elle s’est envolée en Angleterre en 1964. Elle a eu son petit succès d’estime durant quelques années sans parvenir à effectuer une percée majeure. Le talent était là, la voix et l’énergie ; n’a manqué que le coup de pouce de la chance qui permet de décrocher la timbale. À écouter ses singles dont plusieurs valent bien des hits de l’époque, on se dit que c’est injuste. Il est vrai que la concurrence était vive dans le monde de la pop vocale féminine.
Tandy a enregistré pour Pye, Atlantic et Stax (avec Booker T & the M.G.’s et Isaac Hayes, à l’occasion d’un séjour à Memphis en 1966), et s’est fréquemment produite avec le groupe Les Fleur de Lys (sic). En 1970, son mariage en miettes et sa carrière battant de l’aile, elle est rentrée en Afrique du Sud où elle a encore enregistré quelques titres qui furent des succès locaux, avant de se ranger des voitures.
On se fera une idée agréable de son talent en écoutant Our Day Will Come et Daughter of the Sun. Les gourmands iront tout droit à l’anthologie You Gotta Believe It’s… Sharon Tandy (Big Beat CDWIKD 233), qu’on peut ouïr intégralement ici.

Vie des fantômes
La biographie est une passion anglaise. En témoignent l’abondance de la production éditoriale et la place qui lui est accordée dans les librairies d’outre-Manche ; les quelques chefs-d’œuvre du genre, de la Vie de Samuel Johnson aux Victoriens éminents, appartiennent de plein droit à l’histoire de la littérature anglaise, au même titre que des œuvres d’imagination. En fait foi aussi l’importance des rubriques nécrologiques des journaux. À titre de comparaison, la riche section Obituaries du Guardian est sans commune mesure avec la maigre page Disparitions du Monde.
Dans les pages de Choses anglaises qu’il consacre au phénomène, Patrick Mauriès épingle, entre autres aspects du biographisme britannique, son caractère qu’on pourrait dire « démocratique » : « Il s’attaque ou s’applique également à tous les sujets, de la figure royale aux acteurs, via le politique, le meurtrier, l’économiste obscur – et l’homme de lettres. […] Nul acteur, fût-il des plus mineurs, qui ne soit susceptible de récit et de reconstitution. »
L’intérêt des rubriques nécrologiques du Guardian, du Times ou du Telegraph est précisément qu’on y rencontre, à côté des disparus célèbres, quantité de figures de moindre renommée, sinon franchement obscures, portraiturées avec le même sérieux, la même attention bienveillante, un luxe égal de détails. Voici, par exemple, Elisabeth Davis (1923-2016), linguiste qui travailla durant la Deuxième Guerre au centre de décryptage secret de Bletchley Park. Ou encore Desmond Carrington (1926-2017), acteur de second rang de théâtre et de télévision, réputé pour avoir animé trente-cinq ans durant une émission de radio dominicale, en direct de sa ferme du Perthshire où il s’était aménagé un petit studio, entouré de sa collection de quatre-vingt mille disques.
Une chose rend étrange la lecture de la vie de ce sympathique monsieur. Nul n’ignore que les nécrologies des grands quotidiens sont rédigées à l’avance et régulièrement mises à jour jusqu’à la mort effective du sujet. Un service nécrologique bien tenu n’est jamais pris au dépourvu 1. La nécrologie de Desmond Carrington avait ainsi été écrite par le journaliste Dennis Barker. Or, ce dernier, découvre-t-on en post-scriptum, est lui-même décédé en 2015, deux ans avant le sujet de son article. Un léger vertige nous gagne : c’est un fantôme qui nous entretient d’un autre fantôme.
1 A contrario, on se rappelle la bourde célèbre du Soir publiant, le jour de la mort d’Audrey Hepburn, la nécrologie toute prête de Katharine. Erreur qui fut rectifiée au second tirage.
Sillons et poussière

Tout a commencé comme un projet du dimanche, sans dessein particulier : quelques photos prises au vol chez un disquaire new-yorkais, d’autres chez des particuliers entourés de leurs trésors. Au fil de ses voyages, de l’Afrique au Japon, Eilon Paz a continué de rencontrer des collectionneurs de vinyles et de les portraiturer. De fil en aiguille, cet ensemble de photos a alimenté un site qui a connu un succès de bouche à oreille dans le landernau des vinylophiles, avant de devenir ce splendide coffee table book qui ravira les amateurs.
Cent trente fanatiques y sont photographiés dans leur intérieur débordant de 33, de 45 ou de 78 tours, cordés en rangs serrés du plancher jusqu’au plafond. Chacun présente une pièce de sa collection – album de chevet, rareté ou curiosité incongrue. En complément à ce copieux portfolio, de longs entretiens nous font faire plus ample connaissance avec une douzaine de collectionneurs, leur histoire, leurs goûts, leurs trouvailles, leur méthode de classement.
L’échantillon n’a aucune prétention sociologique. La tranche d’âge des trente-cinquante ans prédomine. On y croise beaucoup de gens appartenant au monde de la musique, producteurs, DJ, musiciens ou disquaires, férus le plus souvent de musique pop anglo-saxonne, au sens le plus large. Il y a peu d’amateurs de jazz (hormis une passionnée de Jackie McLean) et pas du tout d’amateurs de musique classique, population qui compte pourtant pas mal de bêtes curieuses. Il y a beaucoup d’hommes et quelques femmes, comme toujours en matière de collectionnite. Les uns se disciplinent pour maintenir leur collection dans des limites raisonnables, les autres se laissent inexorablement envahir : Ahmir Thompson avoue posséder soixante-quinze mille vinyles et ne pas pouvoir envisager de se départir d’un seul. Mais bien entendu, l’accumulation n’est pas une fin en soi, plutôt une conséquence annexe de ce qui est avant tout une passion pour la musique (il va sans dire qu’aucune de ces personnes ne collectionne dans un but de spéculation). Passion indissociable de votre vie et qui peut la transformer : fan de groupes féminins des années 1960, Sheila Burgel a appris le japonais durant cinq ans et vécu un an à Tokyo pour mieux comprendre le monde de la pop féminine nippone de cette décennie.
Les excentriques abondent : un ancien routier fan de rock progressif turc, photographié dans son domicile de la banlieue d’Istanbul ; un jeune nerd de Philadelphie, à la limite de l’autisme, collectionnant les disques de Sesame Street (il y en a beaucoup plus que vous imaginez) ; un Anglais BCBG attiré par les galettes les plus improbables : disques de prévention du suicide, B.O. de films pornos allemands, albums de « musique d’ameublement » (ces disques de musique d’ambiance aquatique ou spatiale ou ce qu’on veut, servant à illustrer reportages et documentaires télévisés). Et, mind you, il les écoute ! On retrouve enfin une vieille connaissance, déjà rencontrée dans le livre d’Amanda Petrusich, Do Not Sell at Any Price, consacré aux collectionneurs de 78 tours de blues (voir entretien ici) : Joe Bussard, octogénaire bourru pour qui l’âge d’or de la musique enregistrée se situe entre 1929 et 1933. Après, comprenez-vous, le son a changé, et ça n’a plus jamais été pareil.
 Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.
Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.

Geoffrey Weiss

Sheila Burgel

Joe Bussard dans son sous-sol tapissé de 78 tours
Massin dans le désordre
Il y a à boire et à manger dans le gros Journal en désordre de Massin, pêle-mêle de souvenirs, d’anecdotes, de rencontres, de curiosités, d’aphorismes et de considérations sur l’air du temps. L’auteur nous amuse et nous instruit souvent, nous agace ou nous ennuie parfois ; c’est le lot de ce genre de livre. Il nous intéresse certainement davantage lorsqu’il parle de l’art de l’affiche, ou de la pratique de la photographie par Hugo et Zola, que lorsqu’il étale ses conquêtes féminines. Mais qu’on le lise dans l’ordre en sautant les longueurs ou qu’on y butine au hasard, on y trouvera de quoi faire son miel. Tout ce qui touche à l’histoire de l’écriture et du livre est évidemment de premier intérêt. On découvre aussi que le maquettiste-typographe a non seulement un œil hors pair mais l’oreille aux aguets, aussi bien pour épingler des tics de langage que pour parler de musique – des baroques à Schönberg –, Massin, en plus d’être lecteur, cinéphile et amateur d’art, se révélant mélomane et, par-dessus tout peut-être, épris de correspondances entre les arts.
Deux extraits presque au hasard, un court et un long ; on pourrait en citer bien d’autres.
Le lendemain du jour où j’ai montré à Claude Gallimard les prémaquettes de la collection «Folio», la plupart des «commerciaux» de la maison (des garçons jeunes, intelligents, cultivés) sont venus me voir l’un après l’autre pour me dire :
« Ce que tu as fait est très bien, c’est élégant…
— Mais ?
— Ça ne se vendra pas. »
*
J’ai rendez-vous avec Ionesco à mon bureau. (Nous nous connaissons à peine, à cette époque.) Or, promenant mon chien sur le boulevard du Montparnasse, je le vois qui sort de chez lui et s’apprête à monter dans un taxi. Je le hèle, il m’aperçoit :
« Excusez-moi, je suis pressé, j’ai rendez-vous avec Massin chez Gallimard. »
Une autre fois, c’était quelques années plus tard, nouvelle rencontre au même endroit, et au petit matin. Je le vois qui attend un autobus; puis regarder de tous les côtés, alors qu’il fait à peine jour, car on est en hiver, et les rues sont désertes. Il fait mine de chercher un taxi ; il hésite ; enfin, lentement, il descend les marches du métro Vavin ; et l’instant d’après, il refait surface en remontant de la station, de l’autre côté du boulevard ; d’un pas tranquille, il emprunte le passage pour piétons, et c’est alors seulement que je me découvre :
« Que cherchez-vous donc, Eugène ?
— Un taxi, mais il n’y en a pas. Des autobus, il n’y en a pas non plus. Quant au métro, c’est une autre histoire. (Il rit.) Je ne sais plus comment faire pour le prendre.
— Où allez-vous ?
— À Béziers, où l’on m’attend.
— Vous allez à Béziers.
— Oui, mais je n’y vais pas.
— Comment cela ?
— C’est-à-dire que je n’ai pas envie d’y aller.
— Eh bien ! n’y allez pas.
— Non, parce que ce ne serait pas bien. Le libraire a tout préparé, des invitations, des affiches, retenu une salle, que sais-je encore ? Alors, je fais semblant d’y aller. »
Nouveau rire.
Il me donne l’heure de son train à la gare de Lyon.
« Voyons, Eugène, votre train part dans cinq minutes. Quoi que vous fassiez, il est trop tard.
— Oui, mais j’y vais quand même. »
Puis il me quitte et se décide enfin à prendre le métro.
Et le voilà parti, pour aller rater son train.
Massin, Journal en désordre (1945-1995). Robert Laffont, 1996.
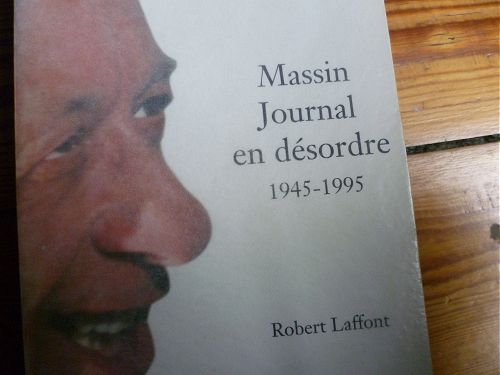
Le détail qui cloche
Hommage, souvenir involontaire ou pure coïncidence ? Voici un moment hitchcockien dans un roman qui ne l’est aucunement.
Dès le lendemain matin, et tous les jours suivants, Objat a entrepris d’arpenter la région, s’étant procuré des cartes IGN au 1/25 000e. Quelque chose lui disant que Constance, disparue de la ferme sans laisser aucune trace de sa présence, ne pouvait pas se trouver très loin, il a systématiquement exploré le périmètre, voie par voie, écart par écart, pendant près d’une semaine, cochant ces lieux l’un après l’autre, sans aucun résultat. Jusqu’au moment où ces investigations lui ont paru vaines, qu’il n’a pas été loin de se décourager – ni de se demander comment il allait expliquer les choses au général Bourgeaud.
Jusqu’au moment où, passant pour la dixième fois sur une départementale dont il avait prospecté chaque dérivation, il a longé un vaste pré au fond duquel, déjà, sa vision périphérique avait enregistré un champ d’éoliennes alignées, tournant paisiblement. Mais un déclic a dû se produire cette fois dans son organisation perceptive, comme la prise de conscience floue d’un détail qui clochait, car il a soudain freiné, s’est arrêté, repartant en marche arrière jusqu’à stopper encore en plein milieu de la route à hauteur de ces aérogénérateurs dont il a considéré plus attentivement le tableau, sous un beau soleil d’arrière-saison. Il lui a fallu peu de temps pour constater que l’hélice d’une des éoliennes tournait en sens inverse des autres et, à nouveau, il a souri.
Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Minuit, 2016.
Impossible de ne pas penser à la scène de Foreign Correspondent d’Hitchcock, située aux Pays-Bas, où Joel McCrea remarque un moulin dont les ailes tournent dans le sens contraire de la direction du vent – signal adressé à un avion espion. Motif hitchcockien par excellence du détail qui cloche, de l’anomalie qui fait accroc dans une réalité jusque-là stable et désigne la présence du mal au cœur de l’ordre naturel. C’est le grand mouvement d’appareil qui va isoler tout au fond de la salle de danse, comme on épingle un papillon, le visage du batteur de l’orchestre affecté d’un clignement anormal des yeux (Young and Innocent). C’est le point rouge d’une cigarette grésillant dans un appartement plongé dans l’obscurité, qui accuse l’assassin (Rear Window). C’est l’avion anodin survolant le désert dans North by Northwest, petit point qui grossit dans le ciel, jusqu’à ce que quelqu’un remarque : « C’est curieux, voilà un avion qui sulfate des cultures, et pourtant il n’y a pas de cultures. »
D’où l’importance, pour Hitchcock, d’établir fermement au préalable le caractère conventionnel et rassurant de la réalité. L’un de ses trucs préférés, on le sait, consiste à recourir sans vergogne aux clichés touristiques nationaux. En Suisse, ils font du chocolat, alors le repaire des espions sera une chocolaterie (Secret Agent). Aux Pays-Bas, il y a des moulins et, confie Hitchcock à Truffaut, si Foreign Correspondent avait été filmé en couleur, il aurait ajouté une scène de meurtre dans un champ de tulipes qui se serait conclue par des gouttes de sang tombant sur des fleurs rouges. Et qu’est-ce que North by Northwest, sinon un travelogue nous baladant dans un certain nombre de lieux emblématiques des États-Unis, depuis le siège de l’ONU à New York jusqu’aux têtes géantes du mont Rushmore, en passant par une maison à la Frank Lloyd Wright ?
Je me demande si Joe Dante ne s’est pas souvenu de la leçon hitchcockienne dans la scène de la cuisine de Gremlins où les diablotins verts attaquent sauvagement une mère de famille. Quoi de plus rassurant, de plus domestique qu’une cuisine ? Mais voici que les appareils électroménagers, le grille-pain, le broyeur à légumes, le couteau électrique, se changent en instruments de mort, comme l’avion sulfateur de North by Northwest. Le confort du foyer se retourne contre lui-même.

Foreign Correspondent
L’auberge des pirates

Réalisé en 1939, Jamaica Inn est la dernière production anglaise d’Alfred Hitchcock avant son départ pour Hollywood, et la première de ses trois adaptations de Daphné du Maurier. Dans ses entretiens avec Truffaut, Hitchcock n’est pas tendre pour le film. Il s’entendit mal avec Charles Laughton et juge le scénario absurde et mal construit. On peut trouver cette sévérité excessive. Le côté Moonfleet du film est séduisant 1 ; la tenancière de l’auberge, obstinément loyale à son brigand de mari, est un beau personnage ; la sûreté de la mise en scène fait passer le dialogue verbeux et les incohérences de la trame. Bel emploi signifiant du décor, opposant deux intérieurs – et, à travers eux, deux classes sociales –, la demeure patricienne du juge dévoyé et l’auberge des pirates. L’espace à deux niveaux de l’auberge, ordonné autour d’un escalier (un de plus dans la filmographie hitchcockienne), avec ses paliers, ses corridors, ses chambres closes, ses percées (fenêtres et vasistas), ses secrets derrière la porte, est particulièrement bien exploité. Le motif du voyeurisme y circule discrètement. Maureen O’Hara passe son temps à écouter en cachette des conversations qui ne lui sont pas destinées et surprend, à travers un trou ménagé dans le mur de sa chambre, une tentative de meurtre. Ce plan est en quelque sorte le double inversé de celui de Psycho où Anthony Perkins épie Janet Leigh : Mary Yellard empêchera un meurtre tandis que Norman Bates en prépare un.


On pourrait citer bien d’autres détails d’exécution : le couteau qu’un tueur essuie en sifflotant (ce meurtrier qui sifflote est-il un souvenir de M le maudit ?) ; le feu accidentel qui, en se substituant à une lanterne éteinte, sauvera un navire du naufrage. Jamaica Inn est typiquement le genre de film où l’invention visuelle est plus riche que le scénario, sans pour autant se faire valoir à ses dépens. Hitchcock se montrait légitimement fier des prouesses techniques du tournage, à savoir les scènes de tempête et de naufrage entièrement reconstituées en studio. Elles sont effectivement impressionnantes et crédibles. Mais ce qui m’a le plus étonné, ce sont les premiers plans, qui paraissent sortis d’un film muet et ont presque un air de Murnau. Cet effet « cinéma muet allemand » reparaît ponctuellement par la suite et met en évidence le savoir-faire acquis par Hitchcock lors de son passage dans les studios de la U.F.A. Jamaica Inn – qui n’est pas pour rien coproduit par Erich Pommer – est finalement l’un de ses films où l’on aperçoit le mieux l’empreinte de l’esthétique expressionniste sur son cinéma.
1 À l’instar du jeune John Mohune dans le film de Fritz Lang, Mary Yellard est une orpheline initiée à l’existence du mal dans un repaire de pirates, tenu par des parents qui voient son arrivée d’un mauvais œil.


Hitchcock ou Murnau ?



















 Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.
Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.