Plombier dézingueur
 Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
En témoigne un travail serré sur la langue, faussement orale mais en réalité très écrite : la phrase claque, c’est admirablement scandé. En fait foi aussi la manière dont la narration est soutenue par une abondance de détails techniques sur la pose des conduites sanitaires, la soudure sur cuivre, les raccords trois pièces et les joints de dilatation, que l’habileté d’écriture de l’auteur réussit à rendre passionnants. Cet aspect documentaire n’est pas là pour faire pittoresque. C’est par l’accumulation de détails concrets et de faits saignants (le chantier ubuesque de la BNF) que le livre finit par en dire long sur la réalité quotidienne du capitalisme sauvage – dont les combines du bâtiment ne sont qu’un des nombreux visages -, et plus largement sur la servitude volontaire et la dégradation générale des conditions de l’existence. Vous croyez que Dan (le narrateur) explique les mérites relatifs des perceuses chinoises et des mèches en tungstène allemandes, mais en réalité il décrit l’âge de la falsification dont parlait Paul Lafargue et qui, au-delà du monde de la marchandise, pourrit les relations humaines et atteint jusqu’au coeur même du langage.
C’est en cela que, si l’aspect polar de l’intrigue reste très embryonnaire, Bleu de chauffe se rapproche malgré tout du roman noir. On regrettera d’autant plus la fin décevante, en porte-à-faux, du livre. À ce bémol près, c’est épatant.
Bibliothèques
Dis-moi comment tu classes ta bibliothèque et je te dirai qui tu es. Par ordre alphabétique ou chronologique, par genres, par collections ou par affinités, ou en panachant ces divers modes de classement – en sachant qu’aucune solution n’est entièrement satisfaisante, que tout classement est destiné à bouger, sous le signe d’un provisoire qui se perpétue.
Depuis toujours curieux des bibliothèques des autres, de la manière dont chacun résout pour son propre compte l’insoluble équation de l’ordre et du désordre, des ruses qu’il s’invente pour contourner l’épineux problème du manque de place.





Une bibliothèque montréalaise, au début des années 1990
Ronde infernale
Avez-vous déjà été réveillé par un mot ? Ce matin vers cinq heures, le mot bougnat s’est invité dans mon sommeil avec sa pelle à charbon. Aussitôt, il s’est acoquiné avec des expressions toutes faites vêtues de robes de collégiennes, qui se sont mises à faire la ronde en scandant : Prenez garde au bougnat — Touchez pas au bougnat — Le bougnat vous salue bien — « Bougnat, apporte-nous du vin / Celui des noces et des festins », etc. Ça y est, ce salopard m’a réveillé. Et il m’a vissé la chanson de Brel dans la tête. Et puis d’abord, pourquoi bougnat ? Je n’ai jamais aimé ce mot.
La course du rat
 Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.
Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.
À la limite, l’intrigue peut se passer de violence et de meurtre sans cesser d’être «noire». En témoigne le remarquable la Tête sur le billot de l’excellent John D. MacDonald (A Key to the Suite, 1962), polar sans crime ou presque (pas de mort avant la page 150, l’enquête aussitôt étouffée au soulagement général), situé dans l’univers impitoyable d’un congrès de grosse société (soûlographie, intrigues de couloir et chantages divers), où le tueur n’en est un qu’au sens figuré : il s’agit d’un inspecteur délégué par la direction pour restructurer les branches provinciales de la compagnie et faire tomber les têtes superflues. Mais si notre homme accomplit cette sale besogne sans état d’âme apparent, cet épisode le déniaisera moralement et lui laissera un goût amer dans la bouche. À l’orée des années 1960, le monde du travail se modernise et se déshumanise sous la houlette d’une nouvelle génération de cadres obsédés de rendement et de rationalité aveugle. Moralité : tous des rats dans un labyrinthe. Toute ressemblance avec notre époque n’est pas le fruit du hasard.
Walsh et la femme
Nancy Olson et Dorothy Malone dans Battle Cry, archétypes de la femme walshienne. Tout aussi libres d’allure que la femme hawksienne, mais avec une sensualité plus «nature», sans la part de jeu et de compétition dans l’insolence qui caractérise la guerre des sexes chez Hawks.

Aldo Ray et Nancy Olson dans Battle Cry
Paludes
« On peut dire de Paludes que c’est au roman ce que le Critique de Sheridan est au théâtre, une analyse spirituelle et une dénonciation satirique de toute entreprise littéraire sans dessein, de toute attitude littéraire dérisoire », écrit Larbaud dans Lettres de Paris. On peut même aller plus loin : Paludes sape toute entreprise littéraire, quelle qu’elle soit, y compris bien entendu… Paludes lui-même. En s’y prenant de manière telle qu’on peut lire et relire ce réjouissant petit livre avec le même plaisir et le sentiment qu’au bout du compte, son « sens ultime » nous glisse entre les doigts — soit que son secret toujours se dérobe en paraissant s’offrir, soit que le secret en question, « c’est qu’il n’y en a pas ». Gide nous a à tous les coups.
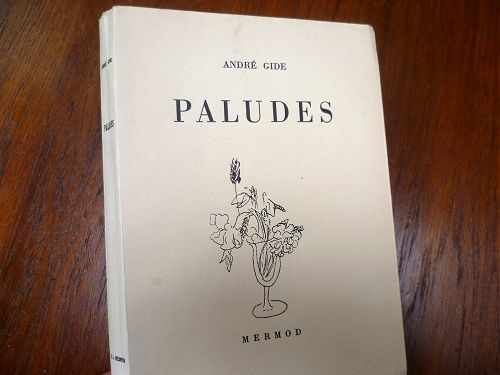
Air de Paris
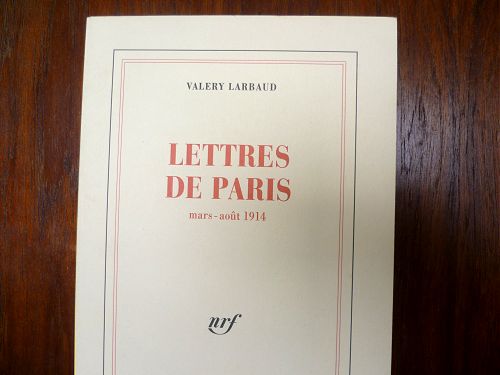
Écrivain et lecteur cosmopolite par excellence, Valery Larbaud a joué un rôle essentiel d’intercesseur dans la vie littéraire de son temps. Grand découvreur et porte-parole des lettres étrangères en France, il a contribué à y faire connaître, par son activisme inlassable, ses essais, ses traductions, ses préfaces, ses conférences ou son rôle officieux de conseiller auprès des éditeurs et des directeurs de revue, Joyce, Borges, Unamuno, Italo Svevo, Eugenio Montale, Samuel Butler, Ramón Gomez de la Serna, Faulkner, Walt Whitman, William Carlos Williams, Logan Pearsall Smith, Alfonso Reyes, Ricardo Guirades et l’on en passe, excusez du peu. En sens inverse, par ses articles écrits directement en anglais pour le New Weekly de Londres ou en espagnol pour la Nación de Buenos Aires, il s’est employé à présenter aux lecteurs étrangers la littérature française classique et contemporaine. Le plurilinguisme de Larbaud et sa connaissance approfondie des autres cultures en faisaient un correspondant idéal, capable d’effectuer, en comparatiste né, des rapprochements avec le propre environnement culturel de son lectorat pour mieux lui faire appréhender une œuvre étrangère. Un « passeur », dirait-on aujourd’hui.
Lettres de Paris réunit ses chroniques parues dans le New Weekly de mars à août 1914. Il y est bien entendu question de littérature (Barrès et Péguy discutés, Anatole France éreinté, Gide loué pour les Caves du Vatican, Fargue, Perse), mais aussi de la vie des revues, de musique (Ravel, les premières auditions du Sacre du printemps de Stravinsky), de théâtre (Copeau, Claudel), de peinture (Monet, Carrière, Valloton et les post-impressionnistes), et encore de mode ou d’une exposition d’insectes et d’oiseaux tropicaux au Jardin d’acclimatation. En somme, c’est toute la vie culturelle de l’immédiat avant-guerre, avec ses querelles et ses débats, qui revit en ces pages dans ses aspects durables ou périssables, rapportée par un témoin de premier plan ; témoin curieux de tout, réceptif et ouvert, mais néanmoins engagé dans la défense éclairée de l’esprit rive gauche, par opposition au vieil esprit rive droite — dichotomie qui vient tout juste d’apparaître dans le débat culturel et que Larbaud s’empresse d’expliquer à ses lecteurs anglais. À lire ces billets, on respire l’air de Paris, millésime 1914.
 Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
 Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.
Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.










 Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un
Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un 
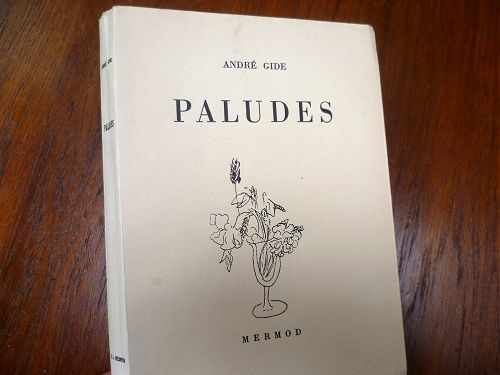
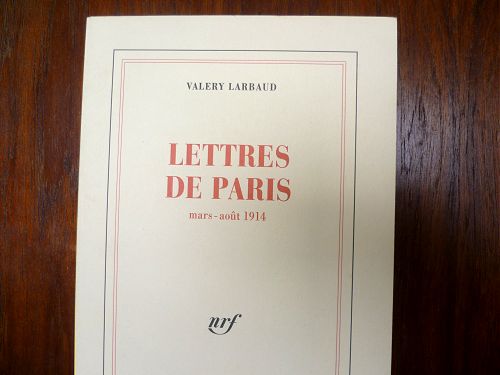
 Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.
Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.