Jarry en réduction
Et revoici le demi-étage de Jarry dont on avait parlé ici. L’immeuble en question, nous avait alors appris Roland de Chaudenay, se trouve rue Cassette et abrite la librairie Bruno Sépulchre.
– Monsieur Alfred Jarry ?
– Au troisième et demi.
Cette réponse de la concierge m’étonna. Je montai chez Alfred Jarry qui effectivement habitait au troisième et demi. Les étages de la maison ayant paru trop élevés de plafond au propriétaire, il les avait dédoublés. Cette maison, qui existe toujours, a de cette façon une quinzaine d’étages, mais comme, en définitive, elle n’est pas plus élevée que les autres, elle n’est qu’une réduction de gratte-ciel.
Au demeurant, les réductions abondaient dans la demeure d’Alfred Jarry. Ce troisième et demi n’était qu’une réduction d’étage, où, debout, le locataire se tenait à l’aise, tandis que, plus grand que lui, j’étais obligé de me courber. Le lit n’était qu’une réduction de lit, c’est-à-dire un grabat : les lits bas étant à la mode, me dit Jarry. La table à écrire n’était qu’une réduction de table, car Jarry écrivait couché à plat ventre sur le plancher. Le mobilier n’était qu’une réduction de mobilier qui ne se composait que du lit. Au mur était suspendue une réduction de tableau. C’était un portrait de Jarry dont il avait brûlé la plus grande partie, ne laissant que la tête qui le montrait semblable au Balzac d’une certaine lithographie que je connais. La bibliothèque n’était qu’une réduction de bibliothèque, et c’est beaucoup dire. Elle se composait d’une édition populaire de Rabelais et de deux ou trois volumes de Bibliothèque rose. Sur la cheminée se dressait un grand phalle de pierre, travail japonais, don de Félicien Rops à Jarry, qui tenait le chibre plus grand que nature toujours recouvert d’une calotte de velours violet, depuis le jour où le monolithe exotique avait effrayée une dame de lettres tout essoufflée d’avoir monté au troisième et demi et dépaysée par cette grande chamblerie démeublée.
– C’est un moulage ? avait demandé la dame.
– Non, répondit Jarry, c’est une réduction.
Guillaume Apollinaire, le Flâneur des deux rives.
Petits plaisirs du catalogue
Depuis l’inventaire de la librairie de Sainct-Victor établi par Rabelais dans Pantagruel, le catalogue de bibliothèque imaginaire est devenu un genre littéraire en soi, qui a donné naissance à un sous-genre : le catalogue de vente publique fictive. L’exemple le plus notoire en est le catalogue de la vente des livres de feu M. le comte de Fortsas, extraordinaire mystification montée par le collectionneur belge Renier Chalon, qui mit en émoi le landerneau bibliophilique en 1840. Vincent Puente a narré l’affaire en détail dans une plaquette parue aux éditions des Cendres, et le blog du bibliophile la résume ici.
Dans le Flâneur des deux rives, Apollinaire en cite un autre, plutôt savoureux.
Un jour, je rencontrai sur les quais M. Ed Guénoud, qui était gérant d’immeubles à Montparnasse, et consacrait ses loisirs à la bibliophilie. Il me donna une petite brochure amusante dont il était l’auteur.
C’est une plaquette illustrée par Carlègle. Elle est inconnue et par la suite deviendra sans doute célèbre parmi les bibliophiles qui recherchent les catalogues fantaisistes.
En voici le titre :
CATALOGUE DES LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE DE M. ED. C., qui seront vendus le 1er avril prochain à la Salle des Bons-Enfants.
Voici quelques mentions de ce catalogue facétieux :
ABEILARD. Incomplet, coupé.
ALEXIS (P.). Celles qu’on n’épouse pas. Nombr. taches.
ALLAIS (A.). Le Parapluie de l’escouade. Percale rouge.
ANGE BENIGNE. Perdi, le couturier de ces dames. Av. notes.
ARISTOPHANE. Les Grenouilles. Papier du Marais.
AURIAC. Théâtre de la foire. Papier pot.
BALZAC (H. DE). La Peau de chagrin. Rel. id.
BEAUMONT (A.). Le Beau Colonel. Parf. état de conservation.
BOISGOBEY 5F. DE). Décapitée. En 2 parties, tête rognée, tranches rouges.
BOREL (PETRUS). Madame Putiphar. Se vend sous le manteau.
CARLEGLE ET GUENOUD. L’Automobile 217-U U. Beau whatman.
CLARETIE. La Cigarette. Papier de riz.
COULON. La mort de ma femme. Demi-chagrin.
COURTELINE. Un client sérieux. Rare, recherché.
DUBUT DE LAFORET. Le Gaga. Très défraîchi.
DUFFERIN (lord). Lettres écrites dans les régions polaires. Papier glacé.
DUMAS (A.). Napoléon. Un grand tome.
DUMAS FILS (A.). L’Ami des femmes. Complètement épuisé.
FLEURIOT (Z.). Un fruit sec. Couronné par l’Acad. franç.
GAIGNET. Bossuet. Pap. grand-aigle.
GAZIER. Port-Royal des champs. Rel. janséniste.
GRANDMOUGIN. Le Coffre-fort. Ouvr. à clef.
GRAYE (TH. DE). Le Rastaquouère. Av. son faux titre.
GUIMBAL. Les Morphinomanes. Nombr. piqûres.
HAUPTMANN. Les Tisserands. Toile pleine.
HAVARD (H.). Amsterdam et Venise. Petites capitales.
HERVILLY (E. D’). Mal aux cheveux. Une jolie fig.
KARR (A.). Les Guêpes. Piq.
KOCK (P. DE). Histoire des cocus célèbres. Nombr. cornes.
LA FONTAINE. L’Anneau d’Hans Carvel. Mis à l’index.
LA FONTAINE. Les Deux Pigeons. Format colombier.
Livre d’heures. In-18 Jésus.
MAETERLINCK. La Vie des abeilles. Qques bourdons.
MAINDRON. Les Armes. Grav. sur acier.
MATTEY. Le Billet de mille. Très rare.
MAURY (L.). Abd-el-Aziz. Maroq. écrasé.
MONTBART. Le Melon. Tranches coupées.
REMUSAT (P. DE). Monsieur Thiers. Un petit tome.
THIERRY (G.-A.). Le Capitaine sans façon. Basane.
VIGNY. Cinq-Mars. Tête coupée.
VILMORIN. Les Oignons. Pap. pelure.
VOLTAIRE. Le Siècle de Louis XIV. Magnif. ill. en tous genres, etc., etc.
Traduttore, traditore
Deux bibliophiles s’étaient attardés dans sa boutique, tandis qu’il traduisait un ouvrage anglais, et ils le dérangeaient fort par leur bavardage. Ils en vinrent à parler de la guerre de 70 et de la trahison de Bazaine.
– Messieurs, leur dit Liseux, on ne parle pas de corde dans la maison d’un pendu, ni d’un traître dans celle d’un traducteur.
Guillaume Apollinaire, le Flâneur des deux rives.
Éditeur fameux qui remit en circulation une centaine de textes rares – classiques latins, textes italiens de la Renaissance, curiosa – réédités en d’élégants petits volumes, Isidore Liseux (1835-1894) tint un temps librairie dans le passage Choiseul. Il mourut dans la misère dans une mansarde de la rue Bonaparte, avec neuf sous en poche.

Poétique de Louÿs
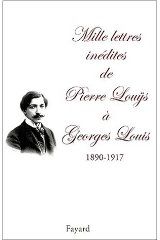 Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.
Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.
Il y a alors dix ans que Louÿs n’a rien publié d’important. L’écriture de son roman Psyché s’enlise, il ne le terminera jamais. À cette paralysie, plusieurs raisons : le perfectionnisme associé à un tempérament velléitaire qui lui fait abandonner en cours de route la plupart de ses projets, et dieu sait s’il en eut ; un mariage raté et des difficultés financières chroniques qui encouragent sa neurasthénie ; une passion de plus en plus vive pour les travaux d’érudition qui occupent désormais toutes ses nuits (car Louÿs, qui vit en reclus, lit et travaille la nuit et se couche à l’aurore) ; plus fondamentalement enfin, le dégoût croissant des mœurs éditoriales : de Mallarmé, l’auteur de Bilitis a hérité une extrême exigence ainsi qu’une « certaine conception de l’effacement de l’écrivain » peu en phase avec son temps, qui voit l’essor de la grande presse et la naissance du vedettariat littéraire 1.
Et en 1916, c’est le sursaut. Louÿs compose avec une rapidité surprenante le poème Ishti — qui paraîtra significativement sans nom d’auteur, tiré à un petit nombre d’exemplaires. Il s’attelle à formuler les principes de sa Poëtique, en quelques pages limpides et denses qui comptent plus que tout à ses yeux. À la même époque, un vers revient le hanter : « Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres… ». Il en cherche en vain la trace dans sa bibliothèque… pour découvrir avec stupéfaction qu’il en est l’auteur. C’est l’incipit d’un poème de jeunesse oublié, Pervigilium Mortis, qui magnifie son amour pour Marie de Régnier. Ce poème, il va le reprendre, l’amplifier et le retravailler sans relâche, sans se résoudre à y mettre le point final (le texte ne sera publié qu’après sa mort).
Les lettres quotidiennes qu’il envoie alors à son frère forment un journal de création où l’on suit pas à pas la genèse de ces œuvres, en particulier celle de Poëtique. C’est non seulement passionnant mais extraordinairement émouvant — à vrai dire, je ne me souviens pas d’avoir lu document aussi intense sur la lente élaboration d’une œuvre. Jour après jour, et quelquefois plusieurs fois par jour, Louÿs fait part à Georges de ses hésitations et de ses avancées, du scrupule infini avec lequel il pèse le choix de chaque mot, la place de chaque virgule. « Placer le mot : c’est écrire. » Parallèlement, il se ressource en relisant encore et toujours ses poètes de chevet, Virgile, Ronsard, Corneille, Racine, Hugo, Mallarmé — et cela donne des commentaires aussi lumineux que pénétrants sur le mouvement interne d’une tirade de Bérénice ou de Booz endormi, la scansion du vers dans les Bucoliques, la nécessité d’un rejet ou d’une allitération dans tel ou tel vers… Son oreille est imparable. On a le sentiment d’entrer avec lui au cœur du texte, dont le sens et la beauté s’éclairent et se déplient sous nos yeux. Le créateur, chez Louÿs, est indissociable du grand lecteur qu’il n’a cessé d’être (précurseur à bien des égards de ce que l’Université a baptisé depuis micro-lecture et critique interne des œuvres).
Les dix proses brèves de Poëtique tiennent en quelques pages. Elle lui auront demandé quatre cents heures de travail ; on ne compte pas moins de vingt-deux états successifs pour le seul fragment VII, qui est composé de huit phrases. C’est que, revenant à l’idéal symboliste de sa jeunesse, Louÿs a conscience de rédiger son testament spirituel. Ordonnés suivant une progression musicale, les dix morceaux de Poëtique condensent tout à la fois une technique et une morale de créateur, une réflexion, nourrie par la pratique, sur l’acte d’écrire et le fonctionnement de l’imagination poétique, énoncée en des termes qui retiendront l’attention de Segalen et de Breton. Celui-ci ne pouvait qu’être sensible à la foi réitérée de Louÿs en l’écoute du songe intérieur et en l’idée que « la trouvaille est poésie ». Çà et là, on jurerait même que Louÿs, tout attaché qu’il reste à la prosodie classique, annonce l’écriture automatique : « Qu’au murmure perceptible se penche l’esprit. Astreindre la volonté. Museler la raison. Prendre conscience de la voix supérieure. Écouter longtemps… Sans répondre. Découvrir que la Muse peut suggérer le son avant le mot, le rhythme avant la phrase ; et que sa dernière parole est sa première pensée. »
Poëtique parut dans le Mercure de France en juin 1916. Louÿs retoucha encore son texte pour le tiré à part, puis pour l’édition en plaquette chez Crès l’année suivante. Bien que dans une misère noire, il refusa tout droit d’auteur. « Le Mercure de France a triplé ses droits d’auteur à cette occasion. Je n’ai pas le sou, mais j’ai tout refusé. Je ne veux pas un centime pour ces pages-là. Je les offre à un éditeur en lui disant d’avance que ce sera « pour rien ». Tout ce qui m’émeut le plus est là-dedans. Je ne passe pas à la caisse après avoir dit Credo » (lettre du 3 juin 1916).
 Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.
Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.
 Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.
Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.
1. Qu’il répugne à se faire imprimer ne veut pas dire qu’il ne noircit pas du papier, au contraire. « Je ne pense que la plume à la main. » De fait, il accumule des notes et des dossiers sur les sujets les plus variés, car ses curiosités sont innombrables. Par ailleurs, la rédaction de lettres à des correspondants venus de tous les horizons, de même que la production clandestine de textes érotiques en nombre incalculable, relèvent chez lui d’une pratique quotidienne, aussi indispensable que la respiration. À sa mort, ce sont des quintaux de manuscrits qui seront jetés sur le pavé et vendus quasiment au poids par des héritiers indélicats.
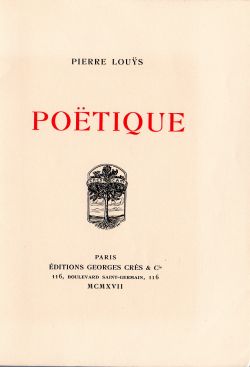
Un si doux visage

Claudine Roland (Claudine Steenackers, dite), comédienne (1891-1920)
19 janvier 1916
Ce qui intéresse le plus Claudine dans ma bibliothèque, ce sont les Œuvres de peintres, les recueils complets de photos, publiés en Allemagne. Tu sais qu’elle dessine très bien et qu’elle aurait pu facilement s’orienter de ce côté-là.
Un soir où je lui présentais le recueil de Botticelli, elle me dit :
« Je vais retrouver mon portrait là-dedans.
— Ton portrait ? tu n’es pourtant guère Botticelli.
— Si. Quand j’étais à Florence, les personnes qui me connaissaient allaient aux Offices pour y voir un Ange de Botticelli qui me ressemblait… Le voilà. »
Je regarde… et je trouve un portrait exact de Claudine. Le front, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, la forme du visage, tout était identique, jusqu’à un détail curieux : des sourcils minces, mais arqués et démesurément longs, faisant tout le tour de l’œil à une grande distance.
Et cette figure est la principale d’un groupe de trois anges dont j’avais en 1890 une photo de grandeur naturelle, encadrée, dans mon cabinet de la rue Vineuse ! Et j’en ai été amoureux à cette époque, deux ans avant la naissance de Claudine !
— de sorte que notre petite liaison actuelle s’explique par un « déjà vu », un souvenir de ma première jeunesse que je n’aurais pas songé à identifier moi-même si elle ne me l’avait inconsciemment rappelé.
Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917.
Bulletin météo
Great storm over Channel. Continent isolated.
The Daily Telegraph, 1929.
Cité hier soir dans l’émission de Stephen Fry, QI.
Thurber est de retour
 Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et Robert Benchley, un des piliers du New Yorker. À vrai dire, je le préfère même à Benchley. Des nouvelles comme « M. Preble se débarrasse de sa femme », « le Mystère du meurtre de Macbeth » et « Imprudents Voyageurs » sont des petits chefs-d’œuvre. Et Thurber, à l’égal de D. Parker, est un observateur incisif de la vie de couple chez les classes moyennes, avec une oreille pour le dialogue et le sens du détail absurde monté en épingle. Plus d’excuse si ce livre manque à votre bibliothèque. Foncez.
Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et Robert Benchley, un des piliers du New Yorker. À vrai dire, je le préfère même à Benchley. Des nouvelles comme « M. Preble se débarrasse de sa femme », « le Mystère du meurtre de Macbeth » et « Imprudents Voyageurs » sont des petits chefs-d’œuvre. Et Thurber, à l’égal de D. Parker, est un observateur incisif de la vie de couple chez les classes moyennes, avec une oreille pour le dialogue et le sens du détail absurde monté en épingle. Plus d’excuse si ce livre manque à votre bibliothèque. Foncez.







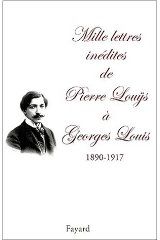 Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.
Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire. Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.
Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon. Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.
Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.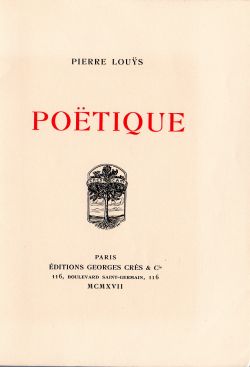

 Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et
Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et