
Chez Franquin, il y a toujours un détail qu’on ne remarque qu’à la vingtième relecture. Par exemple, ce dictionnaire faisant l’objet d’un gag de Gaston, mais oui ! C’est le Littré de Pauvert.
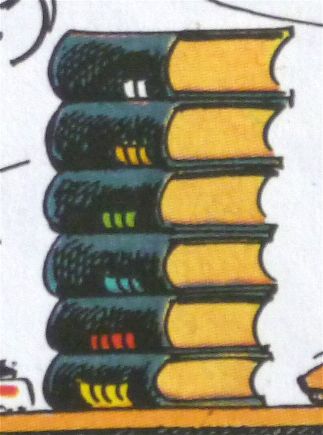
Franquin, le Gang des gaffeurs, Dupuis, 1974.

Chez Franquin, il y a toujours un détail qu’on ne remarque qu’à la vingtième relecture. Par exemple, ce dictionnaire faisant l’objet d’un gag de Gaston, mais oui ! C’est le Littré de Pauvert.
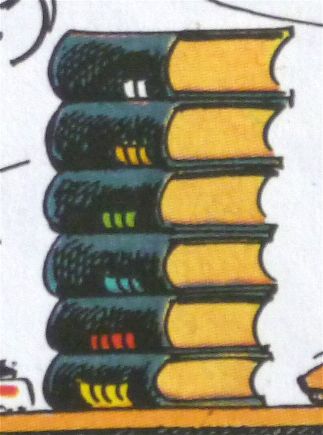
Franquin, le Gang des gaffeurs, Dupuis, 1974.
« Il y a plus de quarante ans, Claudio Parmiggiani (né en 1943 en Italie) a inventé un procédé qu’il a baptisé delocazione. Le principe est le suivant : l’artiste crée une installation — dans le cas présent, une bibliothèque — dans un espace auquel il met le feu. Une fois la combustion terminée, il retire les livres. Les traces de fumée et de suie révèlent alors les silhouettes épargnées en négatif, c’est-à-dire l’empreinte ou le souvenir de ce qui a disparu. »
L’œuvre ci-dessus (6,40 x 2,40 m) occupe jusqu’au 22 septembre un vaste pan de mur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à l’entrée de la belle exposition Giorgio Morandi dont Parmiggiani fréquenta l’atelier dans les années 1960. Les deux autres, ci-dessous, ont été piochées sur le net.


On retombe, dans l’excellente petite anthologie de Michel Nuridsany Précieux et Libertins 1, sur deux rondeaux délicieux et discrètement virtuoses de Vincent Voiture (1597-1648). Le rondeau, tel quel codifié par Clément Marot, compte treize vers construits sur deux rimes, l’incipit du poème revenant à deux reprises comme un refrain (dit aussi « rentrement »). Finesse supplémentaire chez Voiture : le sens du syntagme initial se trouve subtilement modifié lorsqu’il revient sous forme de refrain. Le premier des deux rondeaux est en outre un exemple remarquablement précoce de texte autoréférentiel, qui liquide par avance bien des pesants exercices textuels qui seront en vogue trois siècles plus tard (le poème qui parle du poème, le texte qui s’écrit sous vos yeux en vous disant qu’il est en train de le faire).
Ma foi, c’est fait de moi : car Isabeau
M’a conjuré de lui faire un rondeau.
Cela me met en une peine extrême.
Quoi ! Treize vers, huit en eau, cinq en ème !
Je lui ferais aussitôt un bateau.En voilà cinq pourtant en un monceau.
Faisons en huit, en invoquant Brodeau,
Et puis mettons par quelque stratagème :
Ma foi, c’est fait.
Si je pouvais encor de mon cerveau
Tirer cinq vers, l’ouvrage serait beau.
Mais cependant, je suis dedans l’onzième,
Et si je crois que je fais le douzième,
En voilà treize ajustés au niveau :
Ma foi, c’est fait !
Ou vous savez tromper bien finement,
Ou vous m’aimez assez fidèlement :
Lequel des deux, je ne saurais le dire ;
Mais cependant je pleure et je soupire,
Et ne reçois aucun soulagement.Pour votre amour j’ai quitté franchement
Ce que j’avais acquis bien sûrement :
Car on m’aimait, et j’avais quelque empire
Où vous savez.
Je n’attends pas tout le consentement
Qu’on peut donner aux peines d’un amant,
Et qui pourrait me tirer du martyre :
À si grand bien mon courage n’aspire :
Mais laissez-moi vous toucher seulement
Où vous savez.
Né à Amiens, fils d’un marchand de vin, Voiture enchanta son temps par son brillant esprit, son art de la conversation, son talent à improviser « des poèmes sur tous les événements de la vie mondaine, même les plus minimes. […] Sa poésie légère, badine, raffinée, impertinente, manifeste soif de liberté, goût du jeu et distance ironique vis-à-vis d’elle-même qui caractérisent la société qu’il fréquente. À son époque sa renommée est immense et même le grand La Fontaine proclame hautement ce qu’il lui doit. » (Michel Nuridsany.)
1 La Différence, « Orphée », 1990.

Portrait de Voiture par Philippe de Champaigne. Musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand.
Les faits sont connus. En 1957, Françoise Sagan se flanque dans le fossé avec son Aston Martin, et avec Bernard Frank par la même occasion. Elle sera hospitalisée dans un état critique, avec des fractures multiples du crâne, du thorax et du bassin. Frank raconte l’épisode vingt ans plus tard dans Solde. Quiconque a vécu un accident de voiture s’y reconnaîtra : le temps qui passe très vite et très lentement à la fois, le curieux détachement qui vous sépare de vous-même, les pensées terre-à-terre qui vous traversent l’esprit. Sachant l’importance considérable qu’auront tenue les repas dans la vie du chroniqueur, on adore la chute.
En avril 1957, étant venu oublier un mois d’hôpital dans le moulin de Dior à Milly-la-Forêt, le lendemain de mon arrivée je me retrouvai sur l’étroite banquette arrière d’une Aston Martin qui alla culbuter capricieusement dans un fossé avant d’aller finir sa course dans un champ, roues tournées vers le ciel. Ce qui me frappa alors, c’est le temps incroyable que met un accident avant de se coaguler : au moins quinze secondes. Cette lourde voiture dérapa d’abord vers le côté gauche de la route où se trouvaient les poteaux télégraphiques et des monticules de cailloux, le changement de vitesse tenu par une main que, de ma place, j’avais le loisir de regarder en toute tranquillité la fit revenir vers le côté droit qu’elle n’aurait jamais dû quitter. J’eus le temps de me dire d’une façon toute banale — mais la sensation ne l’était pas — que ça y était, que j’allais entrer dans ce qui n’arrive jamais qu’aux autres, et, comme nous étions secoués comme des pruniers, je me souvins de ces voitures tamponneuses où j’aimais aller enfant lors de la fête de Neuilly. Il me fallait, comme en ce temps-là, serrer les mâchoires, rester imperturbable sous le choc, et rien ne m’arriverait : effectivement, la voiture avait beau tressauter, mon crâne tenait bon, mes bras, mes jambes, ma poitrine tenaient bon, je ne sentais rien, je ne sentais plus rien et, quand la voiture eut fini ses galipettes, je trouvai sans difficulté une issue à travers toile et roue. Je regardai mon Sagan qui semblait coincée sous le volant, qu’y pouvais-je ? et j’allai me coucher dans le fossé comme le prince André après la bataille. Quoique Sagan eût des chances raisonnables de mourir étouffée, que moi-même j’avais un de mes os qui s’était pulvérisé dans le col de l’humérus, trois ou quatre côtes fêlées, un visage qui allait peu à peu devenir celui d’un boxeur qui ne remontera pas de sitôt sur le ring, mes pensées n’arrivaient pas à dépasser le stade du : le déjeuner n’aurait pas lieu !
Bernard Frank, Solde, Flammarion, 1980.

Raymond Queneau avait la gentillesse de me recevoir le samedi. Souvent, au début de l’après-midi, de Neuilly nous revenions tous deux sur la rive gauche. Il me parlait d’une promenade qu’il avait faite avec Boris Vian jusqu’à une impasse que presque personne ne connaît, tout au fond du XIIIe arrondissement, entre le quai de la Gare et la voie ferrée d’Austerlitz : rue de la Croix-Jarry. Il me conseillait d’y aller. J’ai lu que les moments où Queneau a été le plus heureux, c’était quand il se promenait l’après-midi parce qu’il devait écrire des articles sur Paris pour l’Intransigeant. Je me demande si ces années mortes que j’évoque ici en valaient la peine. Comme Queneau, je n’étais vraiment moi-même que lorsque je me retrouvais seul dans les rues, à la recherche des chiens d’Asnières. J’avais deux chiens en ce temps-là. Ils s’appelaient Jacques et Paul. À Jouy-en-Josas, en 1952, nous avions une chienne, mon frère et moi, qui s’appelait Peggy et qui s’est fait écraser, un après-midi, rue du Docteur-Kurzenne. Queneau aimait beaucoup les chiens.
Il m’avait parlé d’un western au cours duquel on assistait à une lutte sans merci entre des Indiens et des Basques. La présence des Basques l’avait beaucoup intrigué et l’avait fait rire. J’ai fini par découvrir quel était ce film : Caravane vers le soleil. Le résumé indique bien : les Indiens contre les Basques. J’aimerais voir ce film en souvenir de Queneau dans un cinéma que l’on aurait oublié de détruire, au fond d’un quartier perdu. Le rire de Queneau. Moitié geyser, moitié crécelle. Mais je ne suis pas doué pour les métaphores. C’était tout simplement le rire de Queneau.
Patrick Modiano, Un pedigree, Gallimard, 2005.
La jeunesse de Modiano, telle qu’il la raconte dans Un pedigree comme pour s’en défaire une fois pour toutes, ressemble à l’un de ses romans. On le voit grandir dans un monde interlope et ne rien comprendre à ce qui lui arrive, balloté entre des parents qui ne songent qu’à se débarrasser de son encombrante personne — tantôt en le confiant à des connaissances de province, tantôt en l’enterrant dans des pensionnats lugubres —, ou bien à le taper dès qu’il a trois francs en poche. Le père, qui a vécu de marché noir pendant la guerre, brasse des affaires mystérieuses et louches, la mère fait une petite carrière de comédienne de théâtre. Un frère meurt très jeune, de maladie ou d’un accident, on ne sait — cette perte l’affecte profondément, mais Modiano ne s’appesantit là-dessus pas plus que sur le reste. Des personnages épisodiques, dont ne subsistent qu’un nom, une silhouette et une adresse, apparaissent et disparaissent comme des fantômes. Bientôt viendra le temps de l’errance et des fugues, une échappée à Vienne où il fête ses vingt ans, les séjours dans des hôtels miteux. Modiano traverse ces épisodes avec le sentiment d’être le passager clandestin de sa propre existence : « Les événements que j’ai vécus jusqu’à ma vingt et unième année, je les ai vécus en transparence — ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages, alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d’autres ont ressentie avant moi : tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie. » On songe parfois, avec une tonalité différente, aux premiers chapitres du Tout sur le tout d’Henri Calet. Je ne mords pas toujours, loin de là, aux romans de Modiano, mais ses récits (voir aussi Dora Bruder) sont décidément admirables.
